Actualité
Kanaky du loyer, Kanaky de la lutte
“La France occupe, donc elle paie.” En une phrase, tout le pays s’est trahi. Voici comment la Kanaky de la lutte est devenue la Kanaky du loyer. Eclairage.
Sur les réseaux, les phrases circulent désormais de façon totalement assumée. “La France occupe, elle paie.” Ou encore : “Elle règle son loyer au propriétaire.” Quelques mots, postés sous une publication anodine sur la dette de la Province des Îles Loyauté. Et pourtant, tout est là. Tout ce que la Calédonie vit, tout ce qu’elle subit, tout ce qu’elle ne veut plus voir.
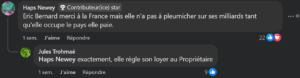
![]()
Le renversement
Autrefois, le Kanak revendiquait la dignité par la lutte. Aujourd’hui, il revendique la rente par le titre. Autrefois, la révolte disait : “Nous ne voulons plus être des dépendants.” Aujourd’hui, elle dit : “Vous occupez, donc vous payez.”
C’est un renversement silencieux, presque indolore. La décolonisation s’est muée en relation de bail. Et la fierté d’un peuple s’est transformée en quittance mensuelle.
Le colonialisme budgétaire
Chaque année, la France transfère vers la Nouvelle-Calédonie environ 320 milliards de francs — salaires publics, prestations, subventions, dotations. Ces chiffres sont connus, mais ce qu’on ne dit jamais, c’est ce qu’ils produisent : une dépendance morale.
Ce n’est plus la France qui colonise par la force, c’est la Nouvelle-Calédonie qui se colonise par la demande. La tutelle ne s’exerce plus depuis Paris : elle se reproduit ici, dans les mentalités, par le réflexe du chèque. Nous avons inventé le colonialisme budgétaire : une société qui dénonce sa domination tout en vivant de sa prolongation.
La Kanaky du loyer
C’est la Kanaky des transferts automatiques, des budgets votés à l’unanimité parce que “l’argent vient de l’État”. C’est la Kanaky du “nous sommes propriétaires du pays”, mais qui ne paie jamais son propre toit. Celle qui transforme la dépendance en revendication, le déficit en droit coutumier.
Dans cette logique, la France n’est plus perçue comme un partenaire, mais comme un locataire condamné à payer pour avoir le droit de rester. C’est la même phrase, répétée dans chaque conversation : “Tant qu’elle occupe, elle paie.”
Mais si la France paye, qui travaille ? Et si la France s’en va, que devient ce pays sans revenus, sans base productive, sans autonomie réelle ?
La Kanaky de la lutte
Face à cela, il reste une autre Kanaky — plus silencieuse, plus pauvre peut-être, mais vivante : celle des terres cultivées, des jeunes qui refusent la dépendance, des coutumiers qui savent encore que “le respect vient du travail”.
C’est la Kanaky des mains, pas des comptes. Celle qui ne réclame pas un loyer, mais une place dans l’avenir. Elle n’a pas besoin de haine, ni de tutelle. Elle sait que la liberté ne se paie pas : elle se gagne.
Le divorce moral
Entre ces deux Kanaky, le fossé s’élargit :
- d’un côté, la Kanaky du loyer, qui s’accommode du confort budgétaire et du discours victimaire ;
- de l’autre, la Kanaky de la lutte, qui comprend que la vraie souveraineté ne se signe pas à Paris mais se bâtit ici, dans les champs, les écoles, les ateliers.
Et ce fossé, c’est aussi celui de la Calédonie tout entière. Nous sommes devenus un pays schizophrène : souverain dans les mots, assisté dans les faits.
L’épreuve qui vient
Quand les transferts cesseront — et ils cesseront — le pays sera nu. Ce jour-là, la Kanaky du loyer disparaîtra avec la République qui la nourrissait. Mais la Kanaky de la lutte, elle, restera debout. Parce qu’elle sait que l’avenir ne se mendie pas : il se mérite.
Le colonialisme militaire a produit des révoltes. Le colonialisme budgétaire produira des ruines.
Entre les deux, il y aura peut-être une renaissance — celle d’un peuple qui aura compris que la dignité ne s’achète pas au guichet de la CAFAT, mais se conquiert, jour après jour, sur sa propre terre. La dépendance n’est pas un état politique : c’est une habitude morale.





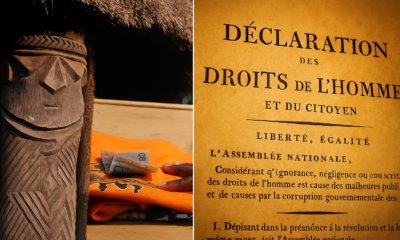
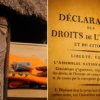


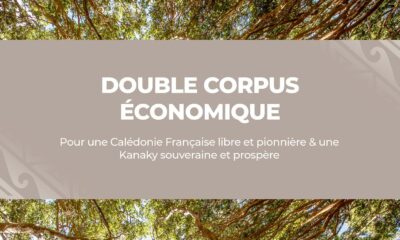









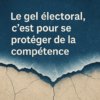





















Test
Il aurait fallu écrire le titre inversement : Kanaky de la lutte, Kanaky du loyer.
“Autrefois, le Kanak revendiquait la dignité par la lutte.
Aujourd’hui, il revendique la rente par le titre./…
…/ C’est un renversement silencieux, presque indolore. La décolonisation s’est muée en relation de bail. Et la fierté d’un peuple s’est transformée en quittance mensuelle.”
Excellent !
De la quête légitime de la dignité à la fainéantise intellectuelle des slogans…
Mais, il est vrai que ce “renversement silencieux” a commencé en chanson, il y a près de 20 ans :
“C’est qui, c’est qui qui paie ? C’est la France qui paie !” (Gurejele)
Il faut lire entre les lignes, ils sont en train de nous dire que depuis qu’ils ont eu “les compétences”, la provincialisation etc, et qu’ils voulaient « gérer leur pays », ils ont été incapables de produire un projet viable pour cette île et donc devant l’incapacité pour le pays de s’auto-financer, la revendication se mue, se travestie en l’idée une occupation qui doit être financée par la France. Si c’est pour être arrivé à ce stade là dans le discours indépendantiste en 2025, les « leaders indépendantistes confirment qu’ils ne sont que des incapables devenus des manipulateurs pour dissimuler leur incapacité.… Lire la suite »
C’est pas forcément une mauvaise nouvelle cette approche.
C’est un aveu d’impuissance face à cette indépendance chérie et le raccrochage à une autre porte de sortie.
Les masques tombent, on voit se révéler la mentalité du kanak indépendantiste de base, cet idéal d’une Kanaky d’où les non-kanaks, et surtout les blancs, seraient partis, sauf quelques uns qui resteraient pour travailler… pour les kanaks, à la place des kanaks… Vivre sans travailler, grâce au nickel entre autres, ce vieux fantasme… Mais tout ça procède en fait du mode de vie féodal kanak, à la tribu les clans esclaves (les “clans du bois et de l’eau”) travaillent pour les clans suzerains, et tout le monde trouve ça normal… sauf ceux qui finissent par s’en aller de la tribu,… Lire la suite »
Que de clichés et de lieux communs. ! Façon “récit d’ethnologues” du siècle précédent! Tu n’aurais pas loupé de nombreux épisodes, “l’expert” de l’évolution de la société néo – calédonienne, comme la désertification démographique des zones rurales, les bouleversements des relations à l’environnement , le mode de vie en zones urbaines en particulier dans des immeubles, induisant une verticalité des relations sociales différente des relations sociales traditionnelles chez les océaniens , les squats, les modifications alimentaires, l’alcool,la drogue , l’accès ou pas aux biens de consommation de la globalisation , les effets de la mondialisation et la question de l’accès… Lire la suite »
Correction: Combien de fois avec un s et la foi il faut l’avoir pour continuer à poster des commentaires sur Calédosphère .
Si tu l’as perdue casse toi.
“Si tu l’ as perdue ,casse-toi”?
Non seulement je n’ai pas perdu la foi mais je la tiens bien, c’est pourquoi j’ai dit ” la foi il faut l’avoir ” …
…” casse -toi .”?
Parle pour toi , casse – noisette!
Booooooonjoouuuur Coconne la quarteronne…
Râââh punaise j’en rigole encore… j’avais vu juste, tu es une woinrue…
Maintenant je comprends mieux notre petit problème de communication: D’ordinaire j’écris, pour me foutre de ta gueule, tout en soulignant ta propension à vouloir virer tout le monde*: “Staki le blog?”
Alors qu’en fait je devrais écrire “Staki le m’blog?”😁😆
*Façon CCAT, pardon de le faire remarquer… 😁
” Je comprends mieux notre petit problème de communication” ” MOUHAHAHAHA!🤣 “Notre” petit problème? En particulier avec moi ( on le comprend vu le niveau de “mon “langage soutenu et celui de ton ” idiolecte”, il y un effet de ta part un ” petit ” – doux euphémisme- problème et pas que de ” communication”🤣) ou TON GROS PROBLEME en général avec tout le monde et surtout de “comprenette? ” “D’ordinaire j’écris pour me foutre de ta gueule tout en soulignant ta propension à vouloir virer tout le monde ” MOUHAHAHAHA! D’ordinaire , te foutre de ma g…le? Ben… Lire la suite »
Merci de compléter mes propos Coconne… tu vois moi je ne suis pas comme toi, je fais dans la concision, toi tu étales ta diarrhée sur des lignes et des lignes. Ravale ta hargne et ta frustration Coconne, et reste dans le sujet, on n’a pas besoin de ton analyse holistique des problématiques “canaquo-kanaks”… on parle SEULEMENT de la propension qu’on certains kanaks au racket. Et moi j’expliquais seulement que dans le monde kanak le racket est institutionnalisé par la coutume. Toi la petite bourge de Nouméa, tu en as fréquenté beaucoup, des kanaks? Depuis longtemps? Tu as vécu en… Lire la suite »
“Merci de compléter mes propos” MOUHAHAHAHA! T’es sûr que t’as compris mon analyse ” holistique” ? “Toi, la petite bourge de Nouméa, tu en as fréquenté beaucoup des Kanaks? Depuis longtemps ?” HAHAHAHAHA On va demander à feu un de mes grands – pères, celui métisse d’un clan du Nord du côté de Koumac d’expliquer ses et mes ascendances bourgeoises de Nouméa! C’est pas toi qui parles de “croisée cochon d’Inde ” ? Y a des cochons d’Inde “bourgeois de Nouméa”? 🤣On se connaît, j’ai gardé le tien de cochon d’Inde au fait? “Parce que moi oui ,et pas dans… Lire la suite »
Allez reprend les phrases pour meubler un peu casse burnes
Ah Aaaaah!!…. Donc j’avais raison, tu es une taoui(e)… de fougère ou du bord de mer?😆😂🤣
Donc ton côté “staki le blog” c’est tout simplement de l’atavisme…😁😆
Et si, comme tu dis si bien moi je descends d’un singe, toi tu descends tout juste de l’arbre… 😁😆😂 D’où cette propension que tu as à pratiquer l’accrobranche…. 😁😆😂😂🤣🤣
Punaise tu m’as fait ma soirée, là…😆😂😂🤣
“Staki le blog ” c’est tout simplement de l’atavisme”? “…j’avais raison “? Hahahahaha!🤣!Ben oui , TON atavisme car comme tous les lecteurs effectifs ou potentiels de TES “commentaires” (?) l’ont ou peuvent le lire et le constater, cette expression t’appartient bien, relève de “ta” propriété intellectuelle,littéraire et artistique ” et fait partie de”tes” barbarismes , ceux “de “l’idiolecte” de Rocky S. et non de celui de Minie.😂 On avait compris que c’était une histoire ” d’atavisme “chez toi le descendant non pas d’ “UN “singe mais “DES “singes de la famille des Alouates,singes hurleurs dont tu as hérité et fait… Lire la suite »
Mazette! Elle est en forme la Coconne…
Donc, comme d’habitude ça part dans tous les sens, c’est complètement décousu, ça dégoise pour rien dire… Rien qui ait un peu de profondeur en tout cas…
Ça reprend des éléments de langage en essayant de blaguer…. mais ça tombe pitoyablement à plat en faisant “blaf”…
L’atavisme de la taoui de fougère, quoi… ça parle, ça parle… et c’est tout… derrière y’a rien… comme avec les taouis/kahouins/pihouins… 😁😆
Rien de nouveau, donc…😒
“Rien de nouveau donc “? Un résumé conforme au contenu de ce commentaire que tu viens de pondre à l’instant : creux,vide, plat ,et à l’image de ce que tu réponds la plupart du temps quand tu ne sais plus quoi répondre , étant justement en panne “d’inspiration ” dans tes élucubrations ridicules , grotesques et souvent vulgaires. “Ça tombe pitoyablement à plat en faisant ” blaf ” … Voilà voilà,c’est tout à fait toi R.Siffredo le crado … Mais c’est plutôt en faisant, en ce qui te concerne, ” badaboum “!🤣 ” Mazette elle est en forme la Coconne… Lire la suite »
Dis donc, ça se précise, Coconne… tu vas aller faire des omelettes aux fines herbes à nos vaillants soldats en Ukraine?
Et si les russes attaquent tu vas contre-attaquer avec ton “fusil à plombs”, ou tu préfères le bibiche?😁😆😂
“Ça se précise” en effet ” gros ahuri ” de service du site”🤮 , la folie du criminel de guerre Poutine, avec la frappe russe du 29 octobre 25 , visant spécifiquement un hôpital pédiatrique de kherson , dans lequel se trouvait une centaine de personnes, parmi lesquelles 4 enfants ont été touchés. Selon un sondage , R.S alias” le timbré du bled de nulle part”, 100 % des internautes de Calédosphère souhaitent te faire dégager toi et ton pseudo crado pas rigolo. Tu préfères que ce soit avec “un coup de bambou japonais ” dans ta tronche “authentique “”de… Lire la suite »
“la folie du criminel de guerre Poutine, avec la frappe russe du 29 octobre 25 “
Et sur ce blog on a des dingues complets qui rêvent de vivre sous un régime du style poutinien, comment est-ce possible ?
(bon, de la part de Si Crado, on n’est pas étonné)
Calme toi Mémé… tu ne te rends donc pas compte à quel point tu peux avoir l’air conne, devant ton écran, à parler de violence??!!😁😆😂😂🤣
“Calme toi Mémé…tu ne te rends pas compte à quel point tu peux avoir l’air conne devant ton écran à parler de violence??!!” N’importe quoi le pépère gâteux! “Parler ” et “de ” violence et au singulier?De violence, de violences, de la violence, de qui que quoi dont où? A quel sujet ? de l’Ukraine ?CRÉÉÉÉTIN! Tu peux expliquer le ” concept”, “l’intello trèèèès cucultivé” ? Lequel ” intello” ne se rend pas compte à quel point ses ” déjections” stupides lui donnent l’air plus que “con”: totalement insane sur ce site. “Les “cherches merde ” sur les réseaux sociaux… Lire la suite »
Et bim! 20 lignes de “rah gna gna gnagna” “moi fin colère, moi sé taper la kèle pou’ toi”…
Fin colère Mémé Coconne…😆
Bein oui de violence, Coconne… “ coup de bambou japonais ” dans ta tronche “ … ” coups de pieds dans ton matricule arrière , histoire de te remonter ce qu’il te reste de cervelle au bon endroit“
C’est pas de la violence, ça, Coconne?
Heureusement, chien qui aboie ne mord pas…😁😆
“Coups de bambou japonais …etc. etc. “C’est pas de la violence ça Coconne”? Après ma réponse évoquant les bombardements des Russes visant un hôpital pour enfants , à ton commentaire intelligemment illustré qui m’était adressé et m’interrogeant sur la situation qui se précise en Ukraine et ta question sur mes intentions culinaires “? Oh si, de la très grande violence toutes ces menaces au pseudo R.S comme il dit je le cite de ” 20 lignes ( il a réussi à compter malgré les attaques) et je le cite toujours de ” rah gna gna moi sé taper la kèle… Lire la suite »
SHAABBAAAT SHALOOOOM MÉMÉÉÉ COOCOOONNE!!
Alors? Ça va? Elle s’est bien murgé la gueule hier soir, la vieille conne?
Alors comme ça c’est pas ton nez? C’est pas ton caca? Tu as toujours raison c’est ça?
Vingt lignes de “rahgnagna” pour essayer d’avoir le dernier mot, encore et toujours…😁😆
Extraordinaire…😁😆😂
“Elle est paf, la girafe!”
Oui, elle picole, la vieille cagole… 😁😆
Tiens regarde, on va essayer un truc:😁
“Tiens regarde ,on va essayer un truc ” Et bien on a vu , en effet ,l’étendue de ta ” propre propension à la picole,” vieille cagole” toi- même !🤣😂 ” Je ne sais pas trop quoi dire”? En effet , c’est bien ce que l’on a une fois de plus constaté ! 🤣Et ceci était la 1ère “PENSÉE DU JOUR ” du très intellectuel et fin lecteurRocky Siffredo le si crado qui a lu “fin plein de livres” et bien plus que tous les autres intervenants de Calédosphère dans sa riche bibliothèque “d’auteurs classiques “🤣 du net et qui… Lire la suite »
@Clarkounet Gaybeulounet Tu vois? …. Bon, je t’avoue, je m’attendais à mieux… Mais bon, quand même 12 lignes de “râhgnagna gna gna” “ouin ouin snif snouf snif”😁😆😆
@Coconne… non, je t’avais saluée avant ça… On n’a pas les yeux en face des trous le matin? La gueule dans le cul? Bein oui hein? N’a dit à toi de vider la bouteille hier soir…😆😆
“N’a dit à toi de vider la bouteille hier soir”? Rien reçu de ce genre comme message ! Par contre, “n’a dit à toi depuis longtemps de vider deux bonbonnes le soir”, ça c’est mon message récurrent , “vieux débris alcoolisé du net “. T’as vu ,t’arrives plus à bien compter les lignes ni à bien faire tes ” râhgnagna gna gna ouin ouin snif snouf snif “… “Coconne …non je t’avais saluée avant ça…”Plaît-il ?Tu as vu, tu ne sais même plus si et à qui tu as dit bonjour… Bon je t’avoue que je m’attendais à mieux, en… Lire la suite »
Il a parfaitement raison et il connaît mieux le pays que toi: Ta gueule Minie!
“Il a parfaitement raison et il connaît mieux le pays que toi: Ta gueule Minie!”
Clark méconnaissable.
J’ose espérer que c’est Si Crado lui-même qui a écrit ça ! Comment peut-on approuver un abruti pareil ?!!!!!!!!!!
Damned! i am démasqued! Oui, tu as tout compris, Monconrétif, Clark et moi sommes une seule et même personne…
Je suis également, comme Mémé Coconne l’avait deviné, Oups2 et Electron…
Tu devrais y aller un peu plus doucement avec le pastis, Coconnet… 😁😆
Tu veux que je te bifle un peu pour te calmer? 😁
“Mémé Coconne avait deviné..”.
Rien à cirer de qui tu es ou peux être, pour les lecteurs, tu es juste un très grave ” barge ” de plus en plus gâteux et en perte de ses facultés intellectuelles à la vitesse V, au vu de ses écrits!
Le modérateur nous mais surtout TE rendrait service en te bannissant de ce site public, l’internaute anonyme à la “coprolalie” envahissante qui finira par faire fermer définitivement ce blog.
“Il a parfaitement raison et il connaît mieux le pays que toi ? A quel sujet? De quel pays tu parles – toi ? En réponse à quoi? Un gugusse avec des éucubrations de guignol du niveau cm2- 6ème, dont le vocabulaire tourne autour du mot “con ” ? Et qui parle de ” sa vie en tribu” dans “pas le clan du chef” ? Avec des clichés remontant au temps du siècle dernier ? Avec des propos à la noix racistes anti toutes etnnies voire anti genre humain ? Sur des caldoches de fin de race ou des …… Lire la suite »
Corr : élucubrations, synonyme : délires du fêlé du casque R.S
Sinon la droite extrême rêvée par nos alcoolitres de calédo et tant vantée par Trump, et autres menteurs pathologiques du genre Orban et compagnie, c’est pas terrible terrible :
Italie : l’extrême-droite au pouvoir, les salaires réels s’effondrent
On imagine la cata d’une France gouvernée par la poissonnière…
C’est déjà la cata en France, tu n’as pas vu ?
“C’est déjà la cata en France, tu n’as pas vu ?”
Non, pas vu, la cata absolue c’est quand des démocraties sont remplacées par des dictatures comme tu les aimes tant, mon pauvre Electron !…
“La cata absolue c’est quand les démocraties …” Affirmatif ! En France on vient de la voir maintenant cette tentative ! Il ne l’a pas vu venir ce coup retors le porte -parole du site du parti qui parle au nom du peuple de la France qui se lève tôt? Surtout après la désatreuse et abjecte ” explication ” de Marine Le Pen de son vote lamentable à l’AN contre le report des élections provinciales en Nouvelle – Calédonie, osant même parler de ce report comme d’ un “déni de la démocratie”! Joignant ainsi sa voix à celles des branches… Lire la suite »
Parce que toi, Coconnet, tu penses que la France est une démocratie? 😁😆
Qui a financé la campagne électorale de Macron déjà?
Tu crois qu’il bosse pour qui le petit efféminé cocaïnomane?
” Qui a financé la campagne de Macron déjà “? Et le rapport avec la “voleuse de poules” , à qui les banques françaises ont refusé des prêts pour son parti le RN , comme avant celui de feu son père le FN ? La voleuse c’est qui, pour financer ses campagnes, et endettée en plus auprès de banques étrangères! Dont des sociétés et banques russes dont une tchéco -russe, la FCRB , en faillite en 2016, rachetée par diverses structures financières opaques proches du Kremlin et aux liens troubles avec Poutine, auprès desquelles l’ex Presidente du RN a contracté… Lire la suite »
Tu confonds “démocratie” et “état de droit”, Coconne.
Bon, tu fais partie de ces cons qui ont élu Macron… sans comprendre qu’il bosse pour ses patrons de la banque Rothschild. Trop conne pour ça…😁😆😂
Mentalité de larbin… le fameux “ruissellement”, tu l’as vu? 😁😆😂
Le reste…. “gnin gnin gnin ” sans intérêt, balek, je zappe…😁
Tu confonds ” démocratie et Etat de droit” Coconne ” MOUHAHAHA ! C’’est le clou du spectacle de l’Empereur des Kongs à vie sur Calédosphère ! Bravo champion. On a hâte que tu nous développes ta ” con- ception “! Une chose est sûre c’est que chez toi, confiture de figues et figure de con sont totalement confondues en une seule et même entité! T’as une petite idée de qui c’est? 🤣Comment peux tu savoir pour qui et même si j’ai voté pour quelqu’un ? Ou même si je suis allée voter ? Toi c’est pas le syndrome du larbin… Lire la suite »
“Macron… sans comprendre qu’il bosse pour ses patrons de la banque Rothschild.”
T’en rates pas une, fumier de Si Crado !
Carrément antisémite ! ! !
https://www.radiofrance.fr/franceinfo/podcasts/complorama/podcast-le-fantasme-complotiste-autour-de-la-dynastie-rothschild-3051444
” Carrément antisémite” Il tient le même discours que Giang Lųc Mĕ Láng Chõng! Le copain des dictateurs de toutes tendances y compris les terroristes du Hamas qui récupèrent des morceaux d’un même cadavre humain et les “renvoient ” à deux ans d’intervalle” à sa famille ” ! Faut demander à LedZep ,il doit avoir des liens au sujet de ” la République c’est moi” et de ce genre de comportement délinquant ! Vu que nous sommes le ” trio ” dans la ligne de mire de l’expert en rien sauf en insanités en tous genres. Il a raté aussi… Lire la suite »
Wow!! Un véritable feu d’artifice… ça part dans tous les sens, JeanKul Méchancon, Trump et son gendre juif, les terroristes du Hamas, les cadavres en puzzle, LeZob qui sait tout et “la république c’est moi”, les milliardaires juifs dans l’immobilier du New Jersey…😆😂😂🤣🤣
Tu prends de la coke, coconne?😳
我是共和国
Wǒ shì gònghéguó
Bein alors Concon? QUE deux lignes? Qu’est-ce qui t’arrive, tu es malade?😁😆
Tiens, j’ai cueilli quelques framboises ce matin en revenant de mon jardin, j’ai pensé à toi. 😉
RS [le musicologue du Net]
Ben tiens : https://www.youtube.com/watch?v=kQ2QoOs-WRo&list=RDkQ2QoOs-WRo&start_radio=1
Et oui et c’est pourtant certains candidats de son parti que la bonne bourgeoisie a fait élire à l’AN en faisant un barrage contre “le fascisme”…
Et oui et c’est pourtant certains candidats de son parti que la bonne bourgeoisie a fait élire à l’AN en faisant un barrage contre “le fascisme”…
Et pourtant, on sait ce qu’ils valent depuis le 7 octobre 2023, les islamo-gauchistes au service de Rima Hassan.
🤣🤟👌👍
Des mêmes auteurs :
https://www.radiofrance.fr/franceinfo/podcasts/complorama/mort-d-alexei-navalny-l-opposant-russe-dans-le-collimateur-des-complotistes-3038205
MOUHAHAHAHAHA! Bein alors Monconrétif? Tu t’en es encore mis une bonne ou quoi? 😁😆
Dire que Macron est à la botte des Rothschild (qui l’ont “fait”, qui lui ont financé sa campagne électorale, mine de rien) c’est être antisémite??? 😂😂🤣
Et dire qu’il est le laquais du lobby militaro-industriel c’est être quoi? Un communiste? 😁😆
Réveille toi mon con, on a changé de siècle… tu es gavé de propagande, tu ne t’en rends (évidemment) pas compte… 😂😂🤣
Réponse complètement con, comme d’hab. Mékilékonrétif, tu as vu l’état de la France ? l Effondrement des vocations à devenir enseignant, profs pas respectés, violentés, effondrement du niveau scolaire, baisse du nombre de lits d’hôpitaux, insécurité qui explose, les faits de violences, les refus d’obtempérer, les tentatives d’homicide, les agressions, les pompiers tabassés, les home-jacking et violences sur des personnes le soir du match de football le 31 mai, les femmes pour qui il est devenu difficile de circuler dans l’espace public (demande au Chancelier allemand il t’expliquera), la passoire migratoire, les OQTF coupables de faits de délinquance, de meurtres,… Lire la suite »
“En prenant un peu de recul, on s’aperçoit que le pessimisme est au cœur de l’idéologie des droites radicales et populistes en Europe. De nombreux auteurs décrivent, en effet, cette idéologie comme « réactionnaire et tournée vers le passé, reflétant un profond sentiment de nostalgie du bon vieux temps”
T’as essayé de te la péter intellectuel, hein ?
1-ce n’est pas du pessimisme, c’est du réalisme.
2-s’il y a un vote pour que ça change c’est bien par optimisme.
Commence à prendre du recul avec ta connerie, peut-être qu’on avancera.
Tiens, le RN a fait voter un texte contre l’accord de 1968 avec l’Algérie, avec donc une quarantaine de voix de la droite et du centre.
1-que penses-tu de ce vote ?
2-ceux qui ont voté dans ce sens mais ne sont pas RN, sont-ils des “fachos” ?
Vas-y, tortille du cul et fait nous une démonstration de ton “intellectualitude”.
Ou à minima et comme souvent une petite pirouette qui ne veut rien dire.
Chacun son style.
Absence remarquée de Gabriel Attal lors de ce vote, le poulain de Macron.
Toujours aussi débile mon pauvre Electron… Et sans mémoire aucune : combien de fois faudra-t-il que je t’écrive que je suis bien mieux informé que toi du danger pour notre culture et sécurité en Europe que constitue la surreprésentation, croissante en plus, des adeptes de la secte musulmane (la pire des “religions” à mes yeux, incompatible avec la démocratie quand elle est aussi aveugle chez bien trop de ses “fidèles”, Algériens revanchards notamment (après 3 guerres d’invasion allemandes massacrantes, aurait-on idée, nous Français, de poignarder des citoyens allemands dans la rue pour cela ?). Ce qui me donne des boutons,… Lire la suite »
Ce qui me donne des boutons, mon con, c’est que nos deux partis extrémistes opposés de France exploitent politiquement cet état de fait pour se faire des électeurs, peux-tu enfin mettre ça dans un coin de ta cervelle d’oiseau-mouche ? !
ça, c’est débile comme remarque: superficiel, simpliste, fallacieux, démago pure jus néomacroniste qui ne veut pas voir et affronter le problème, préférant dire “les autres ils sont méchants”.
J’ose espérer que tu ne considères pas ça comme de l’analyse politique… c’est la cervelle d’oiseau mouche qui te le dit.
Et sinon, une réponse à la question posée plus haut, histoire d’approfondir et consolider ta pensée ?
————————————————————-
Tiens, le RN a fait voter un texte contre l’accord de 1968 avec l’Algérie, avec donc une quarantaine de voix de la droite et du centre.
1-que penses-tu de ce vote ?
2-ceux qui ont voté dans ce sens mais ne sont pas RN, sont-ils des “fachos” ?
je suis bien mieux informé que toi du danger pour notre culture et sécurité en Europe que constitue la surreprésentation, croissante en plus, des adeptes de la secte musulmane (la pire des “religions” à mes yeux, incompatible avec la démocratie quand elle est aussi aveugle chez bien trop de ses “fidèles”, Algériens revanchards notamment Très bien ! Parles en à tes deux idoles, Macron et sa supérieure hiérarchique*, et demandes leur ce qu’ils pensent de ceux qui –comme moi– se sont levés politiquement pour sonner le tocsin et veulent inverser la tendance pour sauver notre civilisation ! Ils te répondront… Lire la suite »
” Sauver notre civilisation ” Ces propos outranciers sont un contre- exemple de notre civilisation occidentale moderne fondée sur le rationalisme. Il ne s’agit pas de prétendre qu’on vit dans le monde des Bisounours mais de raison garder,dans un contexte mondial de très graves tensions. Dans deux ans E.Macron ne sera plus le chef d’Etat de la République française et il y a peu de probabilités de voir en 2027 un monarque musulman diriger le “tout nouveau royaume islamique de France ” . C’est une insulte à l’intelligence et au bon sens français , hérités en particulier des grands philosophes… Lire la suite »
ça n’a rien d’outrancier crétine et si ça ne te plait pas j’en ai rien à battre.
Le reste : 50 lignes de conneries sans intérêt, qui mélangent tout et partent dans tous les sens, comme d’hab, punaise c’est un sacré bordel dans ta caboche.
C’est une insulte à l’intelligence et au bon sens français ,
punaise le niveau de connerie qui se fait passer pour de l’intelligence.
Si je réponds; avec outrance : tais-toi sinistre conne.
ps :
tu sais pour qui j’ai voté au prmier tour en 2022 ?
non, alors arrête de baver tes conneries sans fin.
“Tu sais pour qui j’ai voté au premier tour?” Pas du tout et je m’en contrefiche. En revanche tu as clairement et c’est ton droit dit que tu te positionnais pour le RN et tu reprends toute la doctrine de ce parti . Ce n’est pas le cas? Tout comme c’est mon droit de critiquer cette doctrine et son discours de propagande !Que tu reproduis à l’identique. C’est la vision de ce parti et la tienne de la situation de notre pays mais tout le monde ne partage pas ce catastrophisme … Pour ta réponse, elle est conforme à ma… Lire la suite »
C’EST AUJOURD’HUI DIMAAAANCHEEUUUH🎵🎶🎶
BONJOUR MÉMÉ COOCOOOONNE🎶🎶🎵🎶
ACCROCHONS NOOUUUS AUX M’BRAAANCHEEUUUS🎵🎶🎶
ET TÊTONS LAA BOONBOOOONNE…🎶🎶🎵🎶
Alors la ponoche? Pas trop fait la bamboche?
Tu veux vraiment savoir ce que Electron veut dire avec “” punaise le niveau de connerie qui se fait passer pour de l’intelligence ”??
Eh bein c’est le fameux “effet Dunning-Kruger” auquel tu refuses de croire parce qu’évidemment il remet tout en question autour de toi, Coconne…
Et il a raison, Elec, c’est un gros, gros bordel dans ta pauvre vieille caboche de ponoche pochetronne, Coconne…
Alors le 🐒, tu disais de très bon matin : “Tu veux vraiment savoir ce que ELectron veut dire avec “Punaise, le niveau de connerie qui se fait passer pour de l’intelligence ” ? Il s’est cassé la voix au concert de Patrick. l’Electron 🤣 ? C’est pour ça que tu parles pour lui ! Il aurait dû se méfier… 🤫 Ben sinon , selon la “syntaxe” 🤣de” sa phrase” ça veut strictement dire que c’est le niveau de connerie qui se fait passer pour de l’intelligence🤣 : le groupe nominal sujet du groupe verbal “se fait passer “…c’est ”… Lire la suite »
Mais qu’est-ce que tu es drôle !
Tu ne sais pas t’exprimer autrement, gougnafier, que par des mots grossiers ?
Re : retour aux fondamentaux, la troll jour les vierges effarouchées, ment et inverse les rôles.
Tu as abondamment usé de termes grossiers/rabaissant ( ça revient au même) à mon encontre par le passé et malgré mes demandes d’arrêter tu as continué.
BOUFFONE.
“Rabaissant ” Qualifier un pseudo de ” brêle , corniaud chapon, et autres civilités” c’est “rabaissant”? ” Et répondre systématiquement aux intervenants qu’ils sont ou un troll, ou sont hors sujets,ou n’y connaissent rien, ou ont des méthodes tordues, ou des pathologies qu’il a diagnostiquées etc. etc. c’est quoi , c’est intelligent ou c’est effectivement très stupide et qualifier le pseudo qui répond à des commentaires en réponse aux autres comlrntaires par ces considérations oiseuses c’est ” rabaissant ” ou rien de plus qu’une réponse à la hauteur des siennes… car totalement déplacé dans les sujets abordés? “Malgré mes demandes… Lire la suite »
Tu oublies crétin, connard, abruti. Tu avais ouvert le bal en la matière. Ta posture qui consiste aujourd’hui à jouer l’offusquée et faire la morale quand on te parle mal n’est que l’expression de ton hypocrisie perverse ( statut de troll confirmé ici) et Re : retour aux fondamentaux : le mensonge. Et répondre systématiquement aux intervenants qu’ils sont ou un troll, non, pas aux intervenants, à une seule : toi. Apporte la preuve de tes allégations et cite un pseudo que j’ai traité de troll. Et oui, je confirme, tu t’es mêlé de conversations, de sujets dont tu ne… Lire la suite »
Stupidd car même motif même punition
Correction : stupide
La plus stupide d’entre elles de tes réponses étant en effet ” se mêler de conversations”: sur des forums de discussions d’un blog public et gratuit, où les intervenants inscrits peuvent intervenir à tous moments, tu persistes à dire qu’il y a des conversations privées entre deux internautes et que rebondir sur leurs publications c’est “se mêler de leurs conversations”?
Je persiste et je confirme : ce n’est pas être un ABRUTI [IN]FINI que d’écrire une telle imbécilité ?
La question n’a pas été le fait de se mêler de la conversation entre deux autres pseudo; le sujet, c’est que tu es venu ouvrir ton petit bec sur un sujet dans lequel tu n’y connaissais absolument rien et je l’avais démontré. Re : retour aux fondamentaux : tu tords le sujet. Tu vois, je démontre une fois de plus que tu es un troll… parce que tu m’en donnes une fois de plus l’occasion. Voilà, “l’abruti” a perçu une nuance que tu n’as pas vue. Ou que tu fais exprès de ne pas voir pour tordre le sujet. Donc,… Lire la suite »
Quand la troll est mise au pied du mur et n’a pas d’argument pour se défendre, ne lui reste que la pirouette.
Et n’oublie pas la question que je t’ai posée: Quoi des “clichés” et des “slogans” : 1-ce qu’a écrit Inforétif je suis bien mieux informé que toi du danger pour notre culture et sécurité en Europe que constitue la surreprésentation, croissante en plus, des adeptes de la secte musulmane (la pire des “religions” à mes yeux, incompatible avec la démocratie quand elle est aussi aveugle chez bien trop de ses “fidèles”, Algériens revanchards notamment 2-ou l’image d’Electron ? Là, on sera sur un vrai sujet, un sujet de fond. Mais ce n’est pas ton fort, on l’a vu tant de… Lire la suite »
“Au pied du mur”? Si mur, celui de ton infinie sottise , comme les sottises récurrentes que tu viens encore de ressortir, dont l’énorme , à savoir idem, de se ” mêler des conversàtions ” entre deux internautes “? Et se “défendre”
Pourquoi et contre quoi ? Tes “délires “qui t’égarent loin des sujets de départ et qui n’intéressent que toi ?
Tu es indécrottable et incurable mon pauvre Electron! Tu radotes !
Le parfait exemple d’un individu qui n’a absolument rien compris ni au fonctionnement ni à l’usage du numérique . Et ça s’aggrave. Au détriment de ce site.
Au lieu d’écrire des conneries sans intérêt et faire de toi même un cliché, fais preuve de franchise et de courage et répond à la question : Quoi des “clichés” et des “slogans” : 1-ce qu’a écrit Inforétif je suis bien mieux informé que toi du danger pour notre culture et sécurité en Europe que constitue la surreprésentation, croissante en plus, des adeptes de la secte musulmane (la pire des “religions” à mes yeux, incompatible avec la démocratie quand elle est aussi aveugle chez bien trop de ses “fidèles”, Algériens revanchards notamment 2-ou l’image d’Electron ? J’attends ta réponse. Approuves… Lire la suite »
Non Coconne, “Et ça vote, ça…” c’est moi qui l’ai écrit… à ton sujet bien sûr…
Tu fais trop la bamboche la ponoche…😁😆
Tu tètes trop la bonbonne, Coconne…😁😆😂
Allez ziva Coconne, chie nous 30 lignes de “gna gna gna sé çui là qui la dikilé dabor…”
On s’en contrefout de ” tes konneries! “Ferme ton bec cacatoès stupide.
“propagande” ? le petit mot facile des faibles intellectuellement. Tiens crétine, cette image te mettra les yeux en face des trous. Et parlant de propagande, je te recopie ici ce qu’Inforétif a écrit. je suis bien mieux informé que toi du danger pour notre culture et sécurité en Europe que constitue la surreprésentation, croissante en plus, des adeptes de la secte musulmane (la pire des “religions” à mes yeux, incompatible avec la démocratie quand elle est aussi aveugle chez bien trop de ses “fidèles”, Algériens revanchards notamment Inforétif ferait-il de la propagande ? Non, il est lucide et surtout il… Lire la suite »
Nul ! Aucun intérêt ! Que des clichés. Et des slogans .
Quoi des clichés et des slogans :
:
ce qu’a écrit Inforétif
je suis bien mieux informé que toi du danger pour notre culture et sécurité en Europe que constitue la surreprésentation, croissante en plus, des adeptes de la secte musulmane (la pire des “religions” à mes yeux, incompatible avec la démocratie quand elle est aussi aveugle chez bien trop de ses “fidèles”, Algériens revanchards notamment
ou l’image d’Electron ?
Allez vas-y danse, un pied, l’autre pied ….
“et ça vote ça” ?
Y compris les sinistres connes de bourgeoise à qui tu peux mettre les choses sous les yeux… et elles ne veulent pas voir…. si c’est pas un cliché, ça… ne te plains pas, tu en es un.
Totalement idiot
Incapable de répondre à la question : aucune franchise, aucune honnêteté intellectuelle, se défiler, la petite troll à l’oeuvre.
“Le petit troll …etc” Ben voyons! Toujours pas compris la réponse? Complètement “bouché le gugusse”Tu as grillé tes derniers neurones? Tes analyses et syntèses des problématiques des migrants et de leurs conséquences en particulier en France , je répète que je pense qu’elles sont superficielles, fondées sur des poncifs et des slogans entendus et réentendus et que le tableau désastreux que tu en donnes est outrancier ! Pour toutes les raisons évoquées. A plus forte raison sl on s’y rend régulièrement pour y voir la famille. C’est mon avis,tu voulais le connaître , je le répète encore,qu’il te plaise ou… Lire la suite »
Hum!… dimanche soir, 20:13… elle doit bien en être à son cinquième verre de muscadet, la Coconne…
Donc, en France, tout va bien?
Tu iras expliquer ça aux parents de la petite Lola, sombre connasse…
Toi tu files dans ton terrier le ZINZIN perché du net avec tes radotages et toujours tes mêmes imbécilités .” Vieux débris gâteux ” de service du site . Tu vas nous ressortir toutes les histoires de meurtres d’enfants les plus sordides de France et de la Planète? Y compris les Cold case ! Fouille- 💩 c’est ton alias ? Prends un abonnement au tribunal de Nouméa, pauvre taré ,des histoires d’agressions sordides il y en a tous les jours et tu t’en es même amusé! Corniaud aux commentaires niveau 🚮et 🚾! Dégage du site et débarasse nous de ta… Lire la suite »
BONJOUR MÉMÉ COCONNE!!!🎵🎶
Tu vois les photos de ces gosses, vieille conne? Ce sont tous des victimes dans des affaires récentes, de pauvres gamins tués par des étrangers la plupart sous OQTF.
Et toi tu continues à dire que tout va très bien madame la marquise Brigitte…
Va expliquer ça aux parents de ces gamins, pour voir, mongolienne.
Et le barjot après une joyeuse introduction en fanfare publie les photos d’enfants victimes de meutres sordides ,sous le même pseudo que celui qui tient des propos obscènes, à caractères sexuels pornographiques, voire pédo pornographiques! Cherchez l’erreur!Photos captées sur le net et publiées et republiées et largement médiatisées dans la presse à sensation . Et vu comme il utilise la référence au handicap mental de certaines personnes avec une image souvent utilisée pour faire rire la galerie, il y a fort à parier que sa compassion est du même ordre pour étayer son indignation: totalement perchée ! “Va expliquer ça… Lire la suite »
Correction : aux assises
N’essaie pas de noyer le poisson, malfaisante Coconne.
On te dit qu’en France c’est le bordel, tu réponds “Woué sé même pas vré dabor, la preuve ya des touriss qui viennent…” (argument COMPLÈTEMENT CON!!!)😁😆😂😂🤣🤣
Et tu prétends que “tout va bien”… connasse.., la photo que j’ai publiée est LA PREUVE que tout ne va pas bien en France, Coconne…
Et tu peux nous chier des tartines autant que tu veux, tu es une grosse conne de suce boule à Macron avec de la pisse d’âne dans les yeux.
Abrutie…
Va délirer ailleurs, AHURI du net, et va faire soigner D’ABORD le “BORDEL” qu’il y a dans ce qu’il te reste de cervelle avant de ” parler du bordel qu’il y a en France” ! A supposer, la brêle qu’un neuropsychiâtre veuille s’occuper du courant d’air qui traverse ta tête de 🪢et qui te sert d’outil cognigif !
Dégage de lâ, toi, même en touriste on ne veut pas de toi sur le site! Va “pissser” (ton vocabulaire soutenu ) tes stupidités ailleurs, la BRÊLE INCONTINENTE de Calédosphère!
BOOOONJOOUUUR MÉÉMÉÉÉ COOOCOOOONNE!!
Le jour se lève, et les coconneries commencent…
Tu as vu, Coconne? En France un gamin de 19 tué par un chauffard sans permis qui refuse d’obtempérer… les policiers n’osent plus utiliser leurs armes de peur de se faire lyncher par la clique mélanchoniste…
C’est bien le résultat de toutes ces années de politique couillemollesque façon Macron, j’ai pas raison?
Et toi tu dis que tout va bien en France, Coconne?😠😡
Et le mec avait eu à faire à la justice 16 fois.
De toutes évidences, elle ne lui a jamais fait peur et donné envie de bien se tenir.
les policiers n’osent plus utiliser leurs armes de peur de se faire lyncher par la clique mélanchoniste…
Te souviens-tu de ce qu’a fait Macron le soir de la mort de Nahel ?
Du cinéma… comme d’hab, il n’y a qu’à ça qu’il est bon, ce bouffon… C’est pas pour rien qu’il a épousé sa vieille prof de théâtre…
il a qualifié le tir du policier ” inqualifiable et inexcusable”. 1-sans même attendre les résultats de l’enquête 2-il a d’emblée condamné les actes d’un policier 3-en prenant partie pour la racaille 4-parce qu’on sait qui elle est et de quels quartiers elle sort. 5-il a donc pris le parti de la racaille ( multirécidiviste, 116mk/h, 5 refus ) contre le parti de la police, de l’ordre républicain. Ce soir là, une fois de plus, j’ai compris qui était Macron… ou plutôt ce qu’il était; un petit mec ( pour rester poli). Mais bizarrement il n’est jamais critiqué sur ce… Lire la suite »
Si un policier avait tiré sur Chaoulia Abed E avant qu’il ne tue Mathis: 1/ Le policier serait en garde à vue et bientôt en prison. 2/ La famille du policier serait obligé de déménager. 3/ Jean-Luc Melenchon en larmes nous dirait que la police tue. 4/ K. Mbappe nous dirait qu’il a mal à sa France et qu’un ange est parti trop tôt. 5/ La famille de la « victime » organiserait une marche blanche de l’ange Chaoulia Abed malgré ses antécédents. 6/ Assa Traoré imprimerait de nouveaux T shirts. 7/ Macron trouverait ça “inexplicable” et “inexcusable”. 8/ Darmanin… Lire la suite »
Et Macron n’aurait pas les ouilles de faire un discours pour dire : force doit rester à la loi, l’ordre républicain et la sécurité des citoyens assurée par la police, les délinquants (routiers) agissent à leurs risques et périls et doivent assumer* les conséquences de leurs actes.
(*) en mode post-mortem, éventuellement.
Correction : meurtres
Toujours pas compris la réponse? Complètement “bouché le gugusse” y avait pas de réponses. Tes analyses et syntèses des problématiques des migrants et de leurs conséquences en particulier en France , je répète que je pense qu’elles sont superficielles, fondées sur des poncifs et des slogans entendus et réentendus et que le tableau désastreux que tu en donnes est outrancier ! Deux choses : 1.Tu confirmes : tu es bien une bourgeoise idiote. Parce que tu nies la réalité qui est sous tes yeux tous les jours. Ni poncifs, ni slogans, ni superficiels. un seul exemple : les prières de… Lire la suite »
Stupide : tu as besoind’images,en plus de mauvaise qualité graphique , pour exprimer ta ” pensée “? Enfin pensée…
Pure trollerie pour esquiver le sujet, pour ne pas assumer ta “pensée”…
Grande gueule mais petite troll sans envergure pas franche du collier qui se défile en pitrerie, rien de plus pour péter plus haut que son cul, c’est tout ce que tu es.
Et tu me parlais de “cliché” ?
Mais regarde toi pauvre petit être !
Je te tiens là.
Tu te positionnais pour le RN et tu reprends toute la doctrine de ce parti . Tu écris encore une connerie; mes idées… qui rejoignent celles du RN mais aussi de Français qui ne sont pas RN et qui veulent moins d’immigration illégale, le renvoi des criminels étrangers, plus de sévérité dans la justice, entre autres. Et c’est de “l’extrême drouate” ça, crétine ? Non, c’est constater un problème et faire preuve de bon sens pour y répondre. Tu es contre ces mesures ? Vas-y crache le morceau qu’on aille au bout des choses. Comme ça on verra ce que… Lire la suite »
Résume nous tout ce 💩 , du 🌰, en une ligne . Et parle en ton nom propre, pas au nom “des ” 68 millions de Français dont tu ne sais pas du tout combien ils ne sont pas ou sont du RN et s’ ils partagent tous ta vision apocalyptique à se flinguer ou à se ” barrer ” de la France hexagonale ni ton vécu ! D’ailleurs où, le tien , de vécu? Ton opinion et vision d’un internaute lambda ne valent pas moins mais pas plus que la mienne ou celles d’autres sur ce site. Ce n’est… Lire la suite »
Résumer ? Tu n’as qu’à t’informer, ouvrir les yeux et voir ce que tu refuses de voir. * Et la question n’est pas de savoir si les Français sont du RN ou pas, encore une fois tu écris des conneries. Faut être du RN pour subir l’insécurité, les agressions, les femmes qui subissent ? Faut être du RN pour subir les prières de rue, les femmes voilées qui veulent imposer leur religion partout ? Première connerie. Il ne s’agit pas non plus d’une vision apocalyptique ais réaliste, tu as écrit une connerie de plus, ça commence à faite beaucoup mais… Lire la suite »
” petite bourgeoise” T’as pas d’autres chose à nous ressortir que tes idem clichés des siècles derniers de Karl Marx à Georges Marchais…. La comprenette chez toi,c’est très fluctuant ! Et tu nous en rajoutes une couche avec ton lien à la ” noix ” style ” Closer ou People “oh mon Dieu, il a osé dire ça!” Et c’est pas parce que c’est dans “le Point ” que ça vaut le coup de réfléchir longuement sur cette phrase ” convenue ” du chancelier d’extrême droite allemand qui pour la première fois pour un candidat à ce poste depuis la… Lire la suite »
Mais qu’est-ce que c’est que ce gloubiboulga dans ta cervelle ?
ps :
cliché? tu l’auras vraiment voulu.
COOCOOOONNE! GROSSE SUCEUSE!!! 😁😆😂😂🤣
Tu as de la pisse d’âne dans les yeux, ma vieille… 😆😂😂
Bah, c’est son petit trouble psychologique, elle nie le factuel. Et elle fait une rechute de son petit trouble obsessionnel, elle te ramène tout à MLP et au RN, comme si ce sujet ne pouvait être abordé en lui-même. Alors tu comprends, hein ,c’est une dame bien, elle ne peut pas admettre les choses, elle voudrait pas passer pour quelqu’un ” d’extrême drouate”. Elle veut tellement être anti-RN qu’elle en est arrivé à être dans le déni, c’est dire si ça relève de la psychiatrie. Et puis surtout, hein, faut pas admettre les choses parce c’est aussi le bilan de… Lire la suite »
” Alors tu comprends… hein…” T’aurais pas un gros gros problème de dédoublement de personnalité mon pauvre Electron qui te ferait ” parler “de troubles psychiatriques avec ton “mème”? Tu ne sais plus qui est qui et qui ” parle” à qui ? Surtout vu la “coprolalie ” à laquelle se livre ce “mème ” avec lequel tu discutes et auquel tu fais des ” confidences”? Et dont le pseudo est tout un programme ? Ça devient de plus en plus glauque tes commentaires ! Sur Facebook Caledosphère les lecteurs vont finir par penser qu’il y un internaute totalement ”… Lire la suite »
Du grand n’importe quoi, des effets de langage, du vent, qui se font passer pour des arguments de fond, bref la soupe habituelle.
Par ailleurs, on attend toujours tes solutions sur les vrais problèmes (encore faudrait-il déjà que tu acceptes de les voir) au lieu de critiquer les autres et leur dire qu’ils n’en ont pas.
Là, au moins, il y aurait du fond dans tes élucubrations à rallonge.
“ C’est pas pour toi ni pour moi mon commentaire. C’est pour les néo – calédoniens qui entrevoient une lueur d’espoir dans ce chaos dirigé par une minorité agissante“😆😂😂🤣🤣
… soit à peu près douze personnes qui lisent régulièrement ce blog…😁😆 et environ deux qui prendront la peine de lire en entier (la punition!!😁) la logorrhée de Coconne… 😂😂🤣
Tu en étais à combien de bouteilles, là, Coconne?😂😂🤣
Wallah Coconne! Tout va bien en France…
“… soit à peu près douze personnes qui lisent régulièrement ce blog…” L’article auquel se rattachent ton commentaire et le mien, à ce jour, a fait l’objet de 4214 lectures depuis sa publication (*). Article publié le lundi 27 octobre dernier. Pas mal quand même. Je doute que ces plus de 4000 lectures soient le fruit de seulement une douzaine de lecteurs assidus de Caledosphere. Caledosphere est accessible à tous en lecture seule. Par contre, pour y poster des commentaires, y publier des articles là, il faut s’inscrire sur ce forum. L’article “Les fils de la colère” quant à lui, publié le… Lire la suite »
Reste à savoir si les personnes qui viennent lire les articles s’intéressent aux “commentaires”…
EL “Reste à savoir si les personnes qui viennent lire les articles s’intéressent aux “commentaires”…”
Autre débat affectivement.
Je n’ai fait allusion qu’aux nombres de fois que des internautes ont cliqué sur un article, pour en visualiser le contenu. Le lisent t’ils en entier, “en diagonale” ça, Dieu seul le sait. Quant aux commentaires… Mais, il me semble être évident pour tout internaute un tant soit peu curieux que ce dernier, consulte les commentaires qui sont postés à la suite des articles.
“affectivement“*, oui… ne laisse pas ton affect interférer, mon Concon… On sait que tu aimes ce blog, que tu t’y sens chez toi, que tu n’aimes pas que des étrangers aient l’audace d’intervenir… Surtout si c’est pour te contredire… 😁😆
Coconne aussi est comme ça, elle est du genre “territorial”, comme les crabes… ou les kahouins (et pour cause)… avec pas tellement plus de cervelle..
*Joli lapsus calami (si on peut dire ça comme ça 🙂 )
Par contre le R.S.il est du genre lunaire, et même très très lunaire, du genre audacieusement lunaire…😶🌫️ et tellement qu’il est parti en orbite et n’est pas près de redescendre vu la “gravité ” du phénomène !🤣
En résumé la cervelle du fada aux objets jamais retrouvés. Houston ne répond plus mais le perroquet continue d’émettre.
.
Il y a longtemps que les commentaires n’ont rien à voir avec l’article. Tu n’aurais pas remarqué ?
oups2 “Il y a longtemps que les commentaires n’ont rien à voir avec l’article. Tu n’aurais pas remarqué ?”
Et alors ?
C’est pas toi qui nous faisais la morale, François Pignole, sur le fait qu’on était sur un “blog-public-accessible-à-tous-abordant-des-sujets-de-société-gna-gna-gna”… et qu’on était des “chéplustroquoi” parce qu’on s’engueulait comme des chiffonniers sur des sujets n’ayant rien à voir avec la choucroute? Si si, c’est bien toi. 😁 À chaque fois que quelqu’un ici s’avise de donner son avis sur un sujet quelconque, il se fait tomber dessus par les trois trolls de service, Coconne, Concon et Coconnet… et ça dégénère… C’est ce qui a presque tué ce blog déjà moribond, et ce que déplorait Franck Thériaux, son créateur, il y a déjà… Lire la suite »
RS “C’est pas toi qui nous faisais la morale, François Pignole, sur le fait qu’on était sur un “blog-public-accessible-à-tous-abordant-des-sujets-de-société-gna-gna-gna”… et qu’on était des “chéplustroquoi” ??? “À chaque fois que quelqu’un ici s’avise de donner son avis sur un sujet quelconque, il se fait tomber dessus par les trois trolls de service.” Le Calimero ! Il me semble que tu es bien le seul à écrire n’importe quoi sur ce site avec une certaine abondance, à y déverser des dessins, des photos à connotation sexuelle, des propos du même type, à insulter dans l’anonymat le plus complet des internautes tous aussi… Lire la suite »
Pour le coup, pépé Concon c’est toi qui fais ton “Caliméro”…😁 (“Ouin ouin, sé pa vré dabor, sé pas nous sé toi”😆😂) Comme j’écrivais, donc, à chaque fois que quelqu’un donne un avis qui n’a pas l’heur de plaire au trio des connos il se fait agresser… et moi quand on m’agresse j’envoie chier… normal, on n’est pas tous des lopettes. Regarde le dernier article à avoir été posté: J’ai écrit un commentaire, l’autre méchante conne de “Mémé Coconne” m’est rentrée dans la gueule, à la limite du hors sujet, comme d’habitude. Et Calédosphère n’est pas un forum, c’est un… Lire la suite »
“Ce n’est pas un forum”
SI !
Un site avec des articles introduisant pour chacun un forum de discussions, sur lequel à chaque fois tu interviens avec des imbécilités comme celle-ci.
IGNARE QUAND VAS -TU FTGG et foutre le camp d’ici avec tes fausses vérités?
Comme dit le philosophe Karaté Kid, celui qui raconte des” konneries” comme celle de l’ahuri prétentieux R.S a un bel avenir de comique de service à ses heures perdues comme lui sur Calédosphère et à ses heures non perdues , comme lui ” monsieur ” le préposé aux 🚾.
Sur un forum tu pourrais publier tes articles, Calédosphère est un blog, Coconne.
RS “Et Calédosphère n’est pas un forum, c’est un blog” Fais-nous-en la démonstration éclatante. Néanmoins, tel qu’est organisé Caledosphere, nous pouvons raisonnablement penser qu’il se rapproche plus d’un forum de discussion que d’un blog. Nous avons bien affaire à une plateforme en ligne où, des internautes peuvent échanger des commentaires, des idées sur un sujet précis qui leurs est soumis sous forme d’article. A condition de s’y inscrire bien évidement (gratuitement de plus). Lesquels articles, avant d’être publiés sont [je n’en doute pas] contrôlés par le gestionnaire | le modérateur chargé de vérifier le respect des bonnes pratiques en matière… Lire la suite »
Sur un forum comme le “Forum de motards en Calédonie”, par exemple, tu pourrais poster tes tartines masturbatoires, François Pignole.
Quod erat demonstrandum.😁😆 (Pignolo)
RS “Sur un forum comme le “Forum de motards en Calédonie”, par exemple, tu pourrais poster tes tartines…”
En quoi ta réponse, qui n’a aucun sens, nous apporte la preuve irréfutable que Caledosphere serait bel et bien un Blog !
Idiot du village ! Tu ne fais encore une fois que nous confirmer que tu es bien ravagé, pauvre imbécile !
C’est à croire que tu as une bien piètre opinion de toi-même, pour publier, à tire–larigot, des commentaires aussi nuls les uns que les autres.
Et pourtant si, Monsieur le grand Conconnaisseur en tout… Sur un forum comme le très populaire “Forum de motards en Calédonie”, par exemple, n’importe quel membre peut poster un article. Forum de Motards en Nouvelle Calédonie – Portail (forumpro.fr) Or, sur Calédosphère, qui est un BLOG j’ai eu beau chercher je n’ai vu aucun article de pignolade tartinesque signé “LeZob”… Et pourquoi cela? Parce que sur un blog on peut commenter, mais on ne publie pas… (Sauf si on en est propriétaire, ou qu’on a le titre de rédacteur) Voilà, c’est tout, c’est comme ça, mon con, que tu le… Lire la suite »
Rocky [l’idiot utile] “Or, sur Calédosphère, qui est un BLOG j’ai eu beau chercher je n’ai vu aucun article de p… tartinesque signé “LeZob”…Et pourquoi cela? Parce que sur un blog on peut commenter, mais on ne publie pas… (Sauf si on en est propriétaire, ou qu’on a le titre de rédacteur)”.. On ne pourrait pas publier des articles sur Caledopshere ! C’est nouveau ça. Jette un œil sur les deux copies d’écran jointes à mon commentaire. Bien évidement qu’on peut le faire. Il suffit de remplir le formulaire fait pour. D’y joindre un fichier contenant l’article à soumettre au gestionnaire | au… Lire la suite »
Gnin gnin gnin… et ils sont où les nombreux articles sûrement fort intéressants que tu as publiés, mon Concon?
Et elle est où la deuxième copie d’écran?
Sur le FMNC tu postes ton article. Point. Pas besoin de demander quoi que ce soit. Si tu postes un truc non conforme à l’éthique du forum tu te fais recadrer par les modos, car il y a des modos… 😁 car c’est un forum, pas un blog… mon Concon…😁
Ferme la , usine à gaz !
Hélas !Professionnel de la “Konnerie” en titre du site R.S, alias le Si Crado alias le barjot de service de Calédosphère !” Tahu” ta tête! Et j’te dis pas toutes celles que tu as postées ! C’est un ” avis” que tu viens de publier à l’instant , “Dukong “? Tu penses que l’on peut prendre au sérieux les propos que tu colles à ton pseudo même si tu lui fait changer de style de commentaire , selon les destinataires ? Casse – toi et cache toi! C’est bien toi l’internaute anonyme qui pollue ce site sous ce pseudo avec… Lire la suite »
Corrrction : tu lui fais et c’est pas pour ta tête de 🪢 mais pour les potentiels lecteurs de Facebook Calédosphère
Re correction de corrrction .
Non non non non fallacieux Concon… Quand quelqu’un ouvre la page pour lire un commentaire, (celui ci par exemple) ça compte pour une “lecture” en plus… ça ne veut pas dire (comme sur la photo) que 4214 mecs ont lu l’article… Rien que moi, sur cet article ci, par exemple, j’ai déjà enfoncé au moins trente fois le nez de Coconne dans son caca (tiens, ça sonne bien, “le nez de Coconne dans son caca”)… et donc au moins trente fois elle m’a répondu “gna gna gna c’est pas mon nez c’est pas mon caca, j’ai rézondabor”… Si douze mecs… Lire la suite »
Tu peux nous le résumer en un mot ? 🤣
Ah non, désolé Coconne, c’est pas de ma faute si tu es bête à bouffer du foin…
À l’impossible nul n’est tenu, je préfèrerais encore apprendre à un cochon comment faire le “É” et le “È” sur un clavier d’ordinateur… 😁😆😂😂🤣
RS “Quand quelqu’un ouvre la page pour lire un commentaire, (celui ci par exemple) ça compte pour une “lecture” en plus… ça ne veut pas dire (comme sur la photo) que 4214 mecs ont lu l’article…” Ça c’est “l’approche par le commentaire” (du moins c’est ce que je crois comprendre de ta prose).Tu affiches la liste des commentaires et ensuite, tu cliques sur celui que tu veux lire entièrement. Pour y répondre éventuellement aussi. Ce commentaire étant dépendant d’un article donné auquel tu as désormais accès, fait que le compteur de lectures s’incrémente d’un point. Ensuite, le fait de visualiser… Lire la suite »
Eh bein écoute, Couilledelou Sulitzer, si ça te fait plaisir de penser que tes tartines masturbatoires sont lues par des milliers de gens*…😂😂
“Du coup” on va te donner un nouveau surnom tout à fait approprié: “François Pignole”…😁😆
*Qui lisent, mais sans jamais intervenir, of course… 😁😆😂
4000 qui l’ont lu, moins ceux qui y reviennent plusieurs fois par jour.
Et combien qui ont lu les deblaterations illisibles de la dénommée coconne.
En plus c’a baisse car dans une de tes réponses tu en donnais plusieurs dizaines ( de mille)
oups2 “4000 qui l’ont lu, moins ceux qui y reviennent plusieurs fois par jour.” ??? Penses-tu sincèrement que “ceux qui y reviennent plusieurs fois par jour” sont légion ? Parmi les quelques internautes qui fréquentent ce forum quotidiennement avec assiduité [je fais allusion ici à ceux inscrits sur Caledosphere qui peuvent poster des articles, des commentaires], je doute fortement qu’ils passent leur journée à tapoter sur leur clavier pour, soit consulter un article précis “x” fois [“x” pouvant varier de 1 à +l’♾️] soit, pour poster “n” commentaires [“n” pouvant varier là encore de 1 à + l’♾️]. Je le… Lire la suite »
Tais toi François Pignole, t’as pas raison. Écrase.
Regagne ta grotte” caldochienne” où l’on devrait t’enfermer virtuellement et définitivement, Rocky S. alias le vilain roquet alias le barjot du net , perdu dans sa déraison !
Hé la baveuse, j’attends toujours ta réponse, tu approuves ou pas ceci écrit par Inforétif :
Je suis bien mieux informé que toi du danger pour notre culture et sécurité en Europe que constitue la surreprésentation, croissante en plus, des adeptes de la secte musulmane (la pire des “religions” à mes yeux, incompatible avec la démocratie quand elle est aussi aveugle chez bien trop de ses “fidèles”, Algériens revanchards notamment
C’est des “clichés et des “slogans” ça aussi ?
Bien sûr que c’est un danger ces fanatiques commandités et fanatisés par des Etats totalitaires et ennemis du nôtre et du monde occidental et des démocraties, d’autant que le pouvoir algérien a mal digéré la prise de position de la France pour le Maroc contre elle pour la question litigieuse du Sahara ! Bien sûr que la vigilance s’impose d’où les mesures contre le terrorisme intégriste, la cyber criminalité et l’embrigadement sur internet et sur place (comme par exemple dans les prisons) et la coopération eurooéenne et internationale des Etats de droit dont tu n’as toujours pas compris l’intérêt majeur… Lire la suite »
Correction : Coopération européenne
“Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla…”
On t’a dit “EN MOINS DE 15 LIGNES”, Coconne!!!
De la concision, Coconne, de la con-ci-sion... tu essaies de compenser la vacuité de ton raisonnement par ta logorrhée amphigourique?😁😆😂
T’as prévu le nombre de rouleaux de papier 🚾 qu’il faut ? Parce qu’ au vu de la tienne de con- cision , ça en fait des bla bla bla ,trou de luc, et n’hésite pas sur la qualité, Dukong Dukong!Il y a des ” vacuités ” qui sont fragiles ! 🤣
T’es vraiment niais, mon pauvre petit Rocky …. Pauvre de toi ! 🤣
J’hésite entre -ce que tu eux écrire comme conneries et tout mélanger! -ce que tu peux être habile pour tordre les choses ! !Pas plus que tu n’as compris le sens du texte qu’Inforétif t’a fourni sur la vision et le narrarif de l’idéologie de l’extrême droite à ce sujet ! sans blague ? Inforétif fait du narratif d’extrême droite ? je suis bien mieux informé que toi du danger pour notre culture et sécurité en Europe que constitue la surreprésentation, croissante en plus, des adeptes de la secte musulmane (la pire des “religions” à mes yeux, incompatible avec la… Lire la suite »
Bien sûr que la vigilance s’impose d’où les mesures contre le terrorisme intégriste, la cyber criminalité et l’embrigadement sur internet et sur place (comme par exemple dans les prisons) et la coopération eurooéenne et internationale des Etats de droit dont tu n’as toujours pas compris l’intérêt majeur ! Conneries, hors-sujet: il s’agit de populations qui détestent l’Occident mais qui y immigrent en masse ( uniquement pour leur pomme), qui élèvent leur enfants dans la haine et le séparatisme, qui vivent dans la rancune de la colonisation, le rejet des valeurs du pays d’accueil. Les faits sont là et “la vigilance”… Lire la suite »
C’est la fameuse “méthode Coué” version Coconne: “Tout va bien en France, il n’y a aucun problème, la preuve les touristes viennent… Tout va bien en France, il n’y a aucun problème, la preuve les touristes viennent… Tout va bien en France, il n’y a aucun problème, la preuve les touristes viennent… Tout va bien en France, il n’y a aucun problème, la preuve les touristes viennent… Tout va bien en France, il n’y a aucun problème, la preuve les touristes viennent… Tout va bien en France, il n’y a aucun problème, la preuve les touristes viennent… Tout va bien… Lire la suite »
Elle va te répondre que c’est pas son caca, et que c’est pas son nez non plus. 😆😂
“Elle va te répondre … pas son caca ”
A toi, juste que non seulement que l’Etron que tu es n’as pas de nez mais pas de cervelle ! Car sinon tu sentirais l’odeur pestilentielle qui se dégage de tes propos sur ce site en permanence mais tu aurais conscience c’est l’ETRON que tu es qui en est la source!
Bein dis donc Coconne… on sent que tu as étudié la philosophie… on devine tout de suite chez toi la puissance de la rhétorique, on frémit en percevant ta maîtrise de la sémantique…
Ton grand père c’était une vieille femme indigène, c’est ça?
Tu as appris à m’palam’brer à la trim’bu?😁😆
Ferme ta bouche d’ égout, stupide ARÉNICOLE ! On se contrefiche de tes déjections .
Plaît-il ?” Pour certains comme moi , le langage soutenu a dit le Rocky, c’est du langage courant..” A lire sa ” sémantique ” on est plutôt dans le registre de “Bozo le clown ” 🤡 Ton grand – père c’était une souris ( mâle ) et ta grand – mère un campagnol( femelle) c’est ça? Mais comment en es – tu arrivé à hériter de l’atavisme des Alouates ? Le chaînon manquant ce sont tes parents , c’est ça ? Et en plus celui de la picole ! Et le muscadet ! C’est pour ça que tu es très… Lire la suite »
“Tout va bien en France ”
Du coup ” Youpi, dansons la Carioca”?
“Soit douze personnes ”
Nom , prénom. date de naissance, situation familiale, profession, adresse physique, email , numéro tel…
Tu es “extraordinairement “idiot mon pauvre R.S. 🤣
Tu en es à combien de bonbonnes ,hein, Dukong Dukong ? 🤣
Tu es une cause perdue , d’ailleurs on ne va pas chercher à te sauver 😇! Au contraire! 🤢
Bein oui Coconne, tout va bien en France😁😆, des étrangers indésirables (sous OQTF) poignardent, violent, dépouillent des enfants, des vieillards… Le patrimoine est pillé, le Louvre, les églises… Les infrastructures publiques sont pillées, on vole le cuivre qui transporte le courant… Tu entraves, gavali Coconne? Une juge affiliée LFI met SANS PREUVE un ancien président de la République en prison… Des vieux n’ont pas les moyens de se chauffer, des étudiants n’ont pas les moyens de se nourrir correctement… dans la plupart des familles de la classe moyenne les “fins de mois” difficiles commencent le 15 du mois… Des policiers,… Lire la suite »
” Bien oui etc. etc. tout va bien …etc” Tu as avalé la bande sonore des infos de toutes les chaînes de TV , AHURI INFINI ! C’est leur rôle d’informer sur les points de ce qu’on n’appelle pas pour rien les faits d’actualités locales,régionales,nationales et internationales du jour, du soir, de la semaine ,etc. ! Ils ne sont pas là pour informer ces journalistes uniquement – loin de là -🫢 sur ce qu’il se passe de “normal ” ,de bien ou de moins bien, chez Tartempion les bretelles, comme des millions de Français,comme ma famille de Caen ,de Bordeaux… Lire la suite »
J’en ai vu des suce-boules dans ma vie… mais tu es une CHAMPIONNE DU MÂÂÂNDE, Coconne…😁😆😂
Tout va bien en France, alors? Et Macron c’est un mec fin valab’, c’est ça? 😁😆😂😂🤣
“C’est ça?”
Ben non toujours pas ça , Dukong ! 🤯
Mais te décourage pas😇! A force de nous pondre des pensées du jour à la noix 🤪comme celle – ci tu finiras par réussir, un jour, peut – être, par penser tout court et te passer de tes images à la “Kong ” aussi “Kongs” que tes écrits ! 🤣
Bah, elle est rassasieé/gavée du danger Poutine, pour ses média “mainstream”, là, elle y croit, elle voit ! Une victime non pas de la mode mais des médias mainstream. Tu peux lui mettre tous les problèmes, insécurité, crimes commis par cette immigration massive et illégale, et les campements qui s’accumulent dans Paris, là elle voit pas, ou plutôt elle refuse de voir… parce que ceux qui voient ont des idées qui ne plaisent pas à Madame. Comme ce Soudanais, l’autre jour, 18 ans, arrivé en France il y a 3 ans (donc mineur isolé) recherché pour des rodéos sauvages, arrêté… Lire la suite »
je suis bien mieux informé que toi du danger pour notre culture et sécurité en Europe que constitue la surreprésentation, croissante en plus, des adeptes de la secte musulmane (la pire des “religions” à mes yeux, incompatible avec la démocratie quand elle est aussi aveugle chez bien trop de ses “fidèles”, Algériens revanchards notamment
Fais attention Inforétif, tu parles le même langage que moi, langage étiqueté extrême drouate, ton amie Minie la folle ne va pas être d’accord avec tes propos !
Je ne suis pas sur que tes pensées d’informations supérieures aux autres soient réelles. La démocratie n’est pas en danger du fait des musulmans, elle l’est bien plus de ses propres citoyens français de souche qui ne savent plus ou ils habitent et ne pensent qu’au mirage FN et autres extrêmes, arrosé de solutions dites faciles. On le vois actuellement pour les discutions budget 2026. Elle l’est aussi de ces mêmes representants politiques en grande majorité qui se fichent de TA démocratie et pensent que cette démocratie c’est eux et eux seul. Elle est en danger parce que tous ces… Lire la suite »
Attention : je n’ai jamais parlé des “musulmans” en général. Par contre et tu ne peux le réfuter il y a une vague islamisante à la fois dans la jeunesse de souche maghrébine biberonnée à la haine de la France et dans l’immigration de masse en Europe. Ces photos extraites de manifestations en Europe* en sont bien le signe et comme tu le sais les portes d’entrées sont grandes ouvertes. Et si tu veux redéfinir le mot “démocratie”, tu peux toujours aussi le faire en négatif et regarder les pays musulmans où elle n’existe pas. Ce n’est pas dans leur… Lire la suite »
“… on s’aperçoit que le pessimisme est au coeur des idéologies des droites radicales et populistes en Europe.” D’autant que si notre pays était devenu – en 8 ans- après les périodes covid et gilets jaunes – ce presque pays du quart monde en déclin, comment dans de telles conditions, au titre de l’année 2025 la France a -t- elle pu connaître (cf rapport Insee saison touristique été2025 et bilan du Ministère des Finances du 4 sept. 2025 ) une hausse conséquente de sa fréquentation touristique estivale aussi bien intérieure qu’extérieure de la part de touristes étrangers venus du monde… Lire la suite »
C’est de l’humour, Coconne?
Dans le genre “tout va très bien madame la marquise” oui, il y a encore des touristes qui viennent en France… mais est-ce qu’ils y reviennent, ensuite?
Un peu comme ici d’ailleurs, les vrais touristes ne reviennent jamais.
Alors, c’est du déni ou c’est de la mauvaise foi?
“Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.“
“Tout va bien en France”, selon Coconne…😆😂
Coconne elle soutient Macron, je suppose?😁😆😂
Sinon, le Lapin Crétin, tu t’es mis à la bicyclette ? T’as pas encore eu le temps je suppose occupé, fichu ahuri à pondre tes énormes conneries ? Comme celle – ci ! Y a pas eu de touristes en France en 2025 ni depuis longtemps et ce secteur est sinistré, comme en NC? Paris ne fait plus recette, ses grands palaces ferment les boutiques de luxe haute couture aussi ,la Tour Eiffel n’a plus de visiteurs, etc. etc. Et les vrais touristes ne reviennent jamais? Ah bon ? Il y a que les faux ? Tu es complètement pété… Lire la suite »
Mais oui Coconne, mais oui… tout va bien en France, et Macron il est fin gentil, surtout avec les vieilles dames… c’est connu…😁😆😂 Et puis il est beau Macron, et il s’intéresse aux jeunes… surtout les noirs… En France il n’y a pas d’insécurité, ni de criminalité, ni d’immigration hors de tout contrôle… 😆😆Tu vis dans une grotte ou quoi??? C’est vrai, j’oubliais, vous les kahouins vous aimez bien les grottes… 😁😆😆 Tu confonds “vrais” touristes” (étrangers) et “affinitaires”, Coconne… tout comme tu confonds “démocratie” et “état de droit”… Et moi j’ai l’impression d’être en train d’apprendre à un cochon… Lire la suite »
“Mais oui …Le Lapin Crétin ,tout va très très mal en France ” ! D’ailleurs on a ouvert une Mosquée au dernier étage de la Tour Eiffel et tous les Français y compris toi sont dans un profond 💩 !Tu écris sur ton ordi depuis ton bunker privé? T’as pu trouver de quoi te nourrir? D’aileurs vis-tu en France hexagonale ? 🤣 “Tu confonds démocratie et Etat de droit ” Re MOUHAHAHA! Tu récris cette ENORME imbécilité? 🤯 Tu faisais quoi pendant les cours de philo, IGNARE de service du site ? Tu comptais les mouches sur le brasseur d’air… Lire la suite »
Suis, un peu, Coconne… je parlais du tourisme en Calédonie… “Les affinitaires, Coconne, les “affinitaires“… c’est propre au tourisme “lôkal”, ça (Calédonie 100M/an, à Fiji 1 million/an… 😁😆)
Tu as vu beaucoup d’affinitaires japonais rendre visite à leur famille en France, Coconne? 😂😂🤣
Une fois de plus TU N’AS RIEN COMPRIS et tu nous chies une pendule…😁😆😂😂
Sinon, oui, tu as raison, tout va pour le mieux en France… c’est pour ça qu’en 2027 Jordan sera président…😁😆
” Suis un peu” On s’en” fout !” C’est complètement “kong ” ce que tu racontes. “…des affinitaires 🤯japonais rendre visite à leur famille en France ? Comme des franco- japonais vivant au Japon ou des Japonais qui ont de la famille vivant en France ou des Japonais nés en France et retournés vivre au Japon mais pas leurs enfants et ils reviennent leur rendre visite?🤣 Sinon y a des Japonais nés au Japon qui viennent en NC aussi pour y rencontrer des Japonais de leur famille nés en NC et qui visitent l’ile . Et il y a des… Lire la suite »
Mais oui c’est ça, Coconne, raccroche toi aux branches…
Donc tout va bien en France? 😁😆😂😂🤣
Ah tiens?! L’insignifiante petite dactylo boucaque croisée ponoche ne sait pas faire le “È”, ni le “É”?
C’est vrai que un clavier de PC c’est pas une Olivetti…
Eh! La ponoche! Essaie le toutoute pour cracher ton venin…😁😆
Ça te ferait peut-être du bien d’avoir un truc dur dans la bouche… 😁😆😂😂
C’est parce que les touristes etrangers aiment bien les pays sous développés et leurs gentils autochtones, couillonne.
Ils adorent leurs jeter des piecettes.
Et puis pauvres burnes desséchée il y a beaucoup de touristes mais juste à Paris, pour peu de temps et en ne depensant rien.
L’Espagne en à moins mais cela lui rapporte beaucoup plus par tête de Pine.
“cela lui rapporte beaucoup plus par tête de Pine.” Vooaaahh!, t’as dit un gros mot, Coconne elle va gueuler… 😁😂🤣
” Il y a beaucoup de touristes mais juste à Paris…”???? ” Le crétin “de service qui nous ressort des imbécilités gratuites à la hauteur de son vocabulaire recherché! “Juste” à Paris ?🤣 C’est le meilleur !🤯 Excuse – les du peu,tête de 🪢 “En ne dépensant rien “? On va demander à Vuitton ,Chanel, Dior etc….et aux” palaces ” ( 31 répertoriés en France à Paris mais aussi dans les Alpes et sur la Côte d’Azur et les plus connus dans le monde,symboles du raffinement et de la culture et des traditions françaises) fréquentés par le “prolétariat ” des… Lire la suite »
“sans oublier les touristes ” affinitaires” ” Je parlais du tourisme en Calédonie, Coconne… déjà dit à toi, ponoche, deux fois… toi pas comprendre vite, hein? Toi trop picolé hier soir encore? Ça va, tu t’amuses bien avec tes envolées lyriques? Tes grandes phrases? Tu te fais plaisir au moins à écrire des conneries qui partent dans tous les sens? “aux” palaces ” les plus connus dans le monde, symboles du raffinement et de la culture et des traditions françaises fréquentés par le “prolétariat ” des pétromonarchies 🤣 sans oublier les touristes ” affinitaires” d’un peu partout venus de” leur bled… Lire la suite »
” C’est de l’humour ” Non, ahuri, c’est de l’ironie ! Va chez AXA, Allianz et chez les affinitaires des groupes que tu veux et dégage de là espèce d’AHURI INFINI avec tes commentaires lunaires,tes contre – sens, tes non – sens et tes images à la” Kong” ! Et si 💩 il y a pauvre” paumé ” du net , c’est avant tout dans tête, planqué dans ta grotte blindée du fond du très profond de ton quartier en ” Nouvelle- Ecosse”!( Pour toi ce sera ,en retour policée de tes ” civilités”, du fond de TA ” Caldochie… Lire la suite »
“Ouin ouin ouin gna gna gna c’est pas mon nez d’abord, et puis c’est même pas mon caca”…
Aouh Coconne…. 😁😆😂😂🤣🤣
Ah tiens, je n’avais pas lu ton comm. “il n’est de pire aveugle…” je viens de l’écrire à Coconne, ça…
De toutes façons Coconne et Coconnet sont des suce-boule à Macron… donc pour eux tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes…😁😆😂
“Ouin ouin ouin gna gna gna!!!”… “C’est pas mon caca d’abord!” … “Et pis c’est même pas mon nez!”… 😁😆😂😂
Ce sont les mêmes qui disent ne plus avoir besoin et ne plus vouloir de la France qui lui demande de l’argent pendant que la pauvreté s’est répandue dans la population kanak et ça n’a pas attendu 2024. Ces mecs sont des imposteurs et des guignols qui ne sont intéressés que par leur mode et train de vie de politiciens, les voyages à Paris et à l’ONU et maintenant ils disent en fait qu’ils sont prêts à être achetés avec une histoire de soi disant loyer qu’il faudrait leur payer. Y a des coups de bottes au fion qui se… Lire la suite »
Lemec Dici “Y a des coups de bottes au fion qui se perdent. A quand la fin des mensonges et la grande purge chez les indépendantistes ?” Cette purge a été faite à la fin des années 70 lorsque la tendance dure de la mouvance indépendantiste représentée, entre autres leaders, par JM Tjibaou et Eloi Machoro ont mis la main sur l’Union Calédonienne avec pour conséquence, la création en 1979 du FLNKS qui depuis, est toujours sous la coupe de l’UC. Et plus que jamais aujourd’hui avec la mise à l’écart de l’UNI (UPM, PALIKA). Avec pour conséquence, les émeutes du 13… Lire la suite »
Arrête de raconter des conneries Concon, le FLNKS a été créé en 1984.
Rectification apporté à mon commentaire du 27 octobre 2025 19:47 “la création en 1979 du FLNKS“. Erreur de ma part. En fait, en 1979 c’était la création du Front Indépendantiste qui rassembla au sein de cette coalition, l’UC (l’Union Calédonienne), le Palika (Parti de Libération Kanak), le LKS (Libération Kanake Socialiste), le FULK (le Front Uni de Libération Kanak), le PSC (Parti Socialiste Calédonien) et l’UPM (Union Progressiste en Mélanésie). Le FLNKS (Front de Libération National Kanak et Socialiste) quant à lui, sera crée en 1984 sans le LKS, après la dissolution du FI. Le FLNKS, étant désormais sous la… Lire la suite »
Complément apporté à mon commentaire du 27 octobre 2025 19:47 “Le FLNKS, étant désormais sous la coupe de l’UC et de quelques micros partis indépendantistes.” En 2025, font partie du FLNKS : l’Union Calédonienne (UC), le RDO (Rassemblement Démocratique Océanien), et le Parti Travailliste et bien sur, la CCAT. Groupuscule créé par l’UC pour “commettre” des actions sur le terrain ! CCAT signifiant “Cellule de Coordination des Actions de Terrain”. Au vu de ce qui s’est passé le 13 mai 2024 et les jours qui ont suivi, il est évident que cette “cellule” n’a pas été créée pour porter, pacifiquement… Lire la suite »
Heureusement que tu es là, Concon, pour nous apprendre des trucs qu’on sait déjà… Je me demande vraiment comment on ferait sans toi… 😁😆😂
Et on dit merci qui?
On dit surtout pas merci, “Konkong”, à Rocky Siffredo le mytho qui passe son temps à temps à poser la même question à la ” kong “.
Ho! Cong! La taouie de fougère croisée cochon d’Inde… tu arrêtes de dire “cong”, cong?…😆😂
Bientôt si ça continue tu vas dire “chocolatine”, cong… 😁😆😂