Actualité
Le pouvoir change de rive
Comment le centre de gravité kanak glisse du FLNKS vers la coutume
En surface, rien ne change. En profondeur, tout se déplace. La Calédonie vit une recomposition silencieuse : le pouvoir kanak glisse du front politique vers la coutume. Explications.
Il y a des moments où un pays bouge sans bruit. Où rien ne semble changer en surface, et pourtant tout se déplace en profondeur. Depuis quelques mois, la Nouvelle-Calédonie vit exactement cela : une recomposition silencieuse de ses forces réelles.
On continue de parler de loyalistes, d’indépendantistes, de FLNKS, de présidents et de ministres… Mais pendant qu’on regarde les acteurs habituels, d’autres forces, plus anciennes et plus solides, reviennent au premier plan. Ce texte essaie simplement de mettre ces mouvements en lumière.
Un pays qui glisse sans le dire
La vie publique donne l’impression d’être bloquée dans un débat déjà trop connu. On répète les mêmes mots, les mêmes sigles, les mêmes affrontements. Mais le pays réel n’est plus tout à fait là.
Sous la surface, quelque chose s’est déplacé. Et tant qu’on ne descend pas à ce niveau, on a l’impression que tout stagne — alors que tout change.
Le FLNKS arrive au bout de son cycle
Il n’y a ici ni reproche ni ironie. Juste une donnée historique. Le FLNKS aura été, pendant quarante ans, le cadre politique de l’unité indépendantiste : un front, une bannière, une manière d’organiser la lutte et de parler d’une seule voix.
Mais l’histoire des fronts politiques suit toujours la même logique : ils naissent, ils montent, ils s’imposent… puis, un jour, ils arrivent au bout de leur mandat historique. Ce n’est pas un échec. C’est une fin de cycle.
Les signes sont venus les uns après les autres :
– divisions devenues fractures,
– départ du PALIKA,
– perte de mandat,
– impossibilité à engager son peuple dans un oui ou un non,
– silence stratégique devenu silence tout court.
Personne n’a « tué » le FLNKS. Il s’est simplement épuisé.
Pendant ce temps, la coutume se remet en mouvement
Quand un espace se vide, un autre se remplit. Pendant que le FLNKS s’est figé, la coutume — elle — a recommencé à respirer.
On l’a vu ces dernières semaines : les assemblées sous la case, les réunions des huit aires, l’Alliance des Royaumes Kanak, l’Assemblée du Peuple Kanak le 15 novembre, et même l’annonce adressée au Conseil de Sécurité de l’ONU sur la création d’un Conseil National de Transition Kanak.
Il ne s’agit pas d’un retour folklorique. Il s’agit d’un retour à la source : lorsque les structures politiques s’affaiblissent, les structures profondes reprennent naturellement leur place.
La coutume n’a jamais disparu. Elle attendait son heure. Elle parle moins souvent, mais quand elle parle, elle engage.
Deux légitimités se clarifient
Et c’est peut-être le point le plus important du moment politique actuel. Pendant longtemps, tout a été confondu :
FLNKS = Kanaky,
Loyalistes = République,
comme si chaque camp portait tout le poids d’un peuple.
La réalité d’aujourd’hui est plus nette, plus honnête, plus stable :
– côté Kanaky : la coutume,
– côté Calédonie Française : la République.
Ce ne sont pas deux adversaires. Ce ne sont pas deux ennemis. Ce sont les deux piliers sur lesquels repose ce territoire.
Deux manières de dire : « voilà ce qui nous fait tenir debout ». Deux légitimités différentes, mais réelles, anciennes, et chacune valable dans son ordre propre.
Bougival : un accord construit sur un décalage
Il faut dire les choses simplement, sans colère. Si Bougival semble si fragile depuis le premier jour, c’est parce qu’il a été construit avec un acteur qui n’avait plus les moyens d’engager son peuple.
On peut signer un texte avec une organisation, mais on ne peut pas demander à un pays entier d’adhérer à un accord négocié par un front politique au moment précis où ce front perdait sa capacité de décision.
Ce n’est la faute de personne. C’est un problème d’ajustement. L’État a parlé à un mouvement politique, alors que le poids réel, lentement mais sûrement, glissait déjà vers les autorités coutumières.
Comment reconnecter ces deux forces
La question du moment n’est pas : « qui a tort ? » ou « qui doit céder ? » La vraie question est beaucoup plus simple : comment remettre en dialogue les deux légitimités qui font tenir ce pays ?
La coutume, parce qu’elle représente encore un peuple dans sa profondeur.
La République, parce qu’elle représente encore un cadre de droit et de continuité.
L’avenir ne se construira pas contre l’une ou l’autre. Il se construira entre elles. Pas dans la défiance. Pas dans le déni mutuel. Mais dans la reconnaissance de ce qui est : un pays à double fondation, qui a besoin des deux pour respirer.
Restaurer le lien par la vérité
Ce texte n’est pas un verdict. Ce n’est pas un reproche. C’est la tentative d’éclairer un mouvement silencieux du pays. Parce qu’on ne peut pas avancer si on regarde encore dans les vieux cadres.
Dans un pays secoué, la vérité n’est pas un risque : c’est une boussole. C’est elle seule qui permet encore de se retrouver.
Faire en sorte que la vérité, même douloureuse, redevienne un lien.


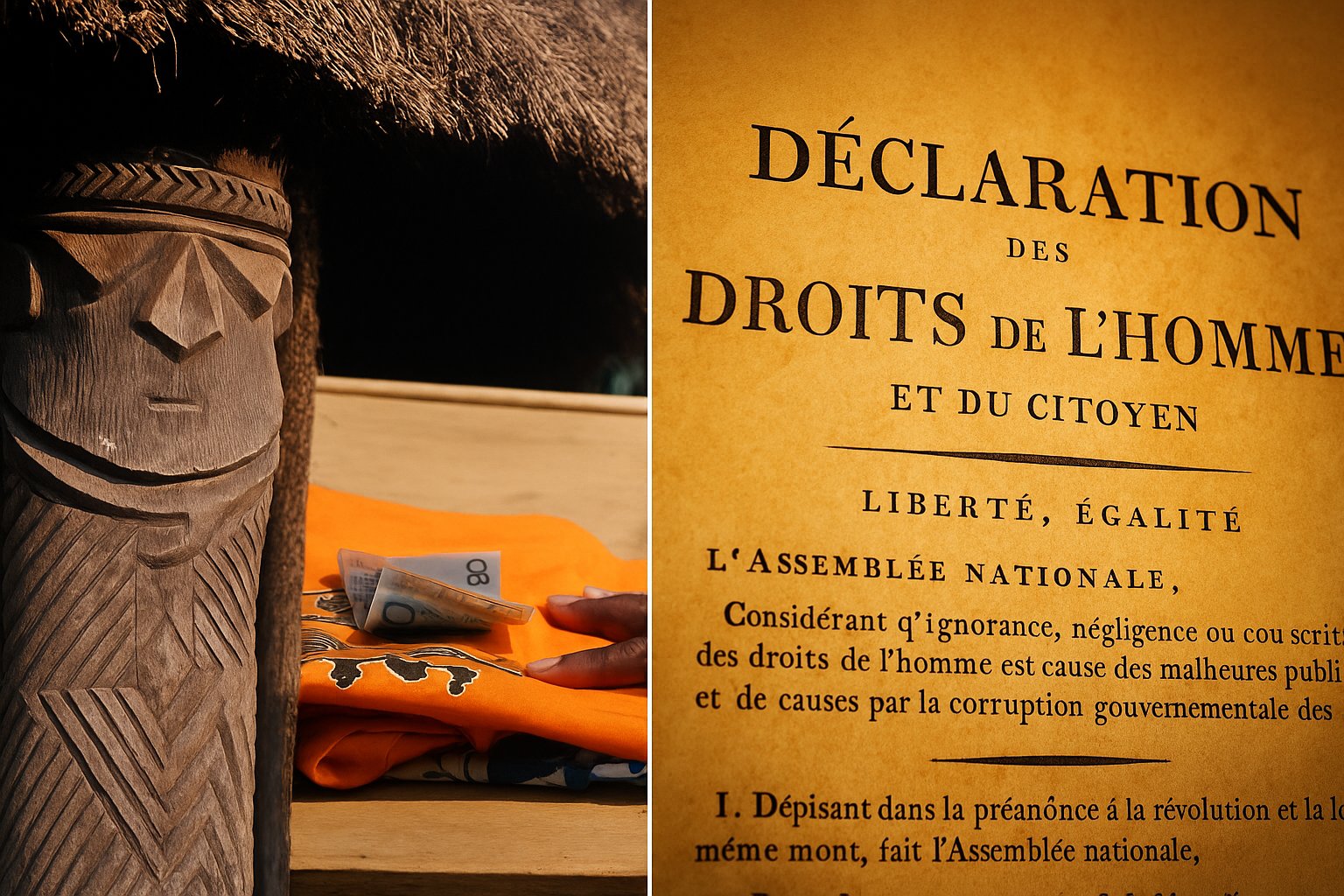


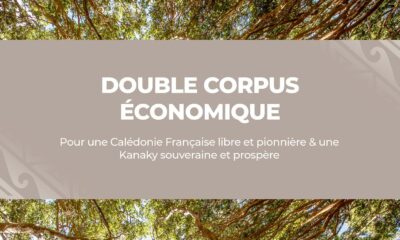

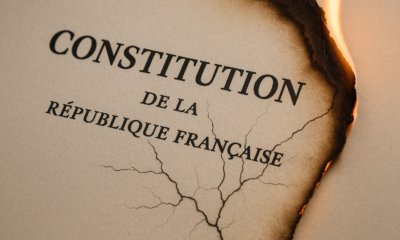







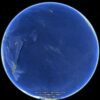







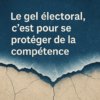
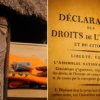



















https://www.facebook.com/share/r/1D1prwVx5E/
https://www.lefigaro.fr/politique/on-perd-deja-des-enfants-le-petit-elias-la-petite-philippine-le-petit-mehdi-reagit-jean-louis-borloo-apres-les-propos-du-chef-des-armees-20251121 Jean-Louis Borloo n’est pourtant pas d'”extrême drouate”…. Je me suis dit la même chose que lui. Comme quoi le bon sens n’a pas de couleur politique. Il ne serait pas étonnant qu’un bonne partie de la population française pense la même chose, toutes couleurs politiques confondues. Plus on nous casse les noix et on veut nous faire peur avec cette guerre, plus c’est contre-productif et ceux qui se jettent dans cette voie seront les futurs perdants de 2027. Comme Glucskman; ce petit bobo arrogant et prétentieux a déjà perdu la Présidentielle. ça va être dure d’expliquer ça à Inforétif,… Lire la suite »
«Malheureusement, des enfants on en perd déjà, le petit Élias, la petite Philippine, le petit Mehdi» Comme quoi Borloo peut lui aussi s’emmêler les pinceaux : quel rapport avec notre défense militaire contre un ogre qui en a fait perdre 20 à 30 000 par le crime contre l’Humanité d’ enlèvements à l’Ukraine et qu’il monte contre leurs parents pour en faire sa chair à canons de la suite de sa guerre ignoble d’invasion ?! “on veut nous faire peur avec cette guerre” Tu crois que Poutine a besoin de quelqu’un d’autre que lui pour faire peur ?! “ceux qui… Lire la suite »
Le rapport ? la formule “perdre des enfants”. Faut t’expliquer ? Le reste de ton élan lyrique démontre quoi ? “ceux qui se jettent dans cette voie seront les futurs perdants de 2027.” Tjrs au ras des paquerettes l’électron, l’est jamais très loin le RN de ta poissonnière vendue à son banquier Poutine. Tu crois que Poutine a besoin de quelqu’un d’autre que lui pour faire peur ?! Tu t’en es chargé toi et tes acolytes en 2022, ” Poutine va envahir l’Europe”, relayant la bonne parole des macronistes, qui s’en chargent eux aussi, comme la crétine de Valérie Hayer.… Lire la suite »
“Tu t’en es chargé toi et tes acolytes en 2022, ” Poutine va envahir l’Europe”, L’histoire n’est pas finie, grâce à la trahison de Trump. Et entre 2022 et aujourd’hui, les centaines de milliers de tués et de biens détruits par Poutine, tu passes ça par pertes et profits ? “ceux qui veulent nous embarquer dans cette guerre sont-ils largement suivis par l’électorat ?“ Munichois jusqu’au bout des ongles de ta poissonnière, tu ne retiens donc rien de la débâcle de notre armée en 1940 face à une armée d’invasion allemande des méthodes de laquelle s’inspire celle de Poutine, jusques… Lire la suite »
Inforétif “L’histoire n’est pas finie, grâce à la trahison de Trump.” A laquelle s’ajoute un niveau de sénilité, de comportement de plus en plus surprenant voire inquiétant, de la part d’un chef d’Etat et, de quel Etat ! Les USA comptent encore, du fait de leur puissance militaire et de leur armement nucléaire aptes à calmer les appétits guerriers de ce désaxé de Poutine. Confère sa dernière incartade (doux euphémisme) : https://www.lefigaro.fr/international/tais-toi-la-truie-donald-trump-s-en-prend-violemment-a-deux-journalistes-20251119 “«Tais-toi la truie!» : Donald Trump s’en prend violemment à une journaliste à bord d’Air Force One” “«Tais-toi la truie!» à l’une, «vous êtes une personne horrible» à l’autre.… Lire la suite »
tes références historiques, munichois, etc, ridicule et on s’en branle et une comparaison totalement déjantée*; j’appréhende les choses dans leur temps et leur contexte.
(* mais bon, c’est valab ça fait mec cultivé et de grande morale)
“tes références historiques, munichois, etc, ridicule et on s’en branle” Ben dans ce cas, si l’Hitoire avec un grand H au mieux t’indiffère, au pire t’incite à te livrer à une activité que la sainte morale conventuelle réprouve, faudra pas te plaindre si d’aventure un calédosphérique, au hasard un certain Inforétif, venait à te traiter d’inculte résolu. Une chose au moins est incontestable, et parfaitement recevable par tout Français, Européen, démocrate soucieux de sa sécurité, liée comme presque chacun le sait (à l’exception notable d’un certain Electron), au respect du droit international par Poutine: Ukraine : les Européens rejettent le… Lire la suite »
Non, l’Histoire “ne m’indiffère pas”, mais toi tu raisonnes ( où plutôt tu résonnes) avec des grands mots, moi je raisonne en abordant les choses dans leur contexte. C’est bien de parler du droit international. Tu penses que la majorité des Français approuvent le fait d’envoyer leurs jeunes mourir en Ukraine au nom du droit international ? J’en doute. Par ailleurs, et pour t’expliquer les choses dans leur contexte, leur réalité : Quand on voit comment la France est en train de sombrer dans l’insécurité, l’immigration de masse et le séparatisme, la narco traffic et la violence qui va avec*,… Lire la suite »
“Encore une fois, tout porte à croire que je comprends mieux, j’appréhende mieux les choses et la réalité qui m’entourent que toi “ Non, Electron, tu ne comprends rien à rien : pour les Français qui croyaient à la paix éternelle, voir Poutine et Trump détruire leurs certitudes sur des frontières réputées intangibles en Europe c’est la terreur absolue, tant nous avons été marqués dans nore mémoire collective voire même dans nos gènes (vois à “l’épigénétique” : https://www.inserm.fr/dossier/epigenetique/) par les guerres de 1870 à 1939. Pour éviter que ça recommence (c’est là qu’intervient l’esprit munichois et leurs crainte qu’il réapparaisse), tu… Lire la suite »
“Je me suis dit la même chose que lui.
Comme quoi le bon sens n’a pas de couleur politique.”
Certains se disent, d’autres font, notamment dans les partis d’extrême-droite européenne.
Chez les allergiques à l’UE en particulier, rique d’y avoir pas mal d’autres affaires bientôt, comme celle-ci :
Un ex-député européen britannique condamné à la prison pour corruption au profit de Moscou
Electron Libre https://www.lefigaro.fr/politique/on-perd-deja-des-enfants-le-petit-elias-la-petite-philippine-le-petit-mehdi-reagit-jean-louis-borloo-apres-les-propos-du-chef-des-armees-20251121 “«On perd déjà des enfants : le petit Élias, la petite Philippine, le petit Mehdi», réagit Jean-Louis Borloo après les propos du chef des armées”. Réflexion stupide de la part de ce has been. Quel est le rapport entre de sordides attentats ou meurtres et ce qui se passe, aux porte de l’UE avec cette guerre Poutine vs “l’Occident collectif” ? Guerre qui pour l’instant, reste circonscrite à l’Ukraine mais qui pourrait s’étendre aux pays Baltes et, au principe qu’il ne faut jamais insulter l’avenir, pourquoi pas hélas à l’UE. Pour faire le buzz ? Pour tenter… Lire la suite »
Bein oui mon con… En Australie AUSSI ils ont des immigrés (trop) qui foutent la merde… et OUI, en France la plupart des problèmes sont liés à l’immigration totalement hors de contrôle qui permet aux copains MEDEF de Macron d’avoir de la main d’œuvre pas cher, au détriment des travailleurs français.
RS “En Australie AUSSI ils ont des immigrés (trop) qui foutent la merde… et OUI, en France la plupart des problèmes sont liés à l’immigration totalement hors de contrôle…”. As-tu compris le sens de mon commentaire auquel tu as répondu ? Sans doute était -il mal formulé, je veux bien l’admettre. Mon seul but, s’appuyant sur l’évocation de deux sordides drames survenus à Sydney [indépendamment de l’origine ethnique des protagonistes], était de démontrer la non pertinence des propos de Jean-Louis Borloo qui ont pour seul finalité [politique], de rendre responsable l’immigration de tous les problèmes rencontrés en France et ce,… Lire la suite »
Il y a des meurtres dans tous les pays; cet argument n’efface en rien la réalité : -une immigr massive, illégale, incontrôlée -des individus aux codes différents -qui ont tué des Français(es) parce qu’ils étaient Français(es) et le problème : -il est presque impossible de les faire repartir -ils restent des individus dangereux, hostiles à la société d’accueil. -il en arrive encore plus chaque année ! (-et ceux qui donnent l’alerte sont “d’extrême drouate” et pointés du doigt pour ça, tu le sais, tu en fais partie) La France n’est pas un pays du tiers monde Elle le devient; ouvre… Lire la suite »
Mais oui bien sûr Concon, tout va bien en France, on n’a qu’à continuer à laisser entrer des étrangers, ça fait de la main d’œuvre docile et pas chère… Et s’ils égorgent des français c’est pas grave, les riches, eux, sont en sécurité dans les beaux quartiers… 😡 Et SI, mon con, en France on risque de se faire trucider à (presque) chaque coin de rue, ça dépend juste des villes et des quartiers… tout comme on risque beaucoup plus de se faire emmerder à Rivière Salée qu’à l’Anse Vata… ne fais pas semblant de ne pas voir, ton attitude… Lire la suite »
“Et si mon con…” Va nous siffler le Siffredo tes radotages, tes certitudes et affirmations prétentieuses ailleurs ! Comment se fait-il que tu sois encore en vie au milieu de cet enfer du plus que tiers mais”quart monde” européen et hexagonal? Où l’on risque ” presque ” Dukong” ( on te rend ta politesse en utilisant tes références lexicales ) de se faire trucider à chaque coin de rue ! Ton ” presque ” est éloquent pauvre nouille ! Et tu es tellement irréfléchi que tu ne te ne perçois même pas combien ce mot rend ton affirmation gratuite et… Lire la suite »
la pauvreté s’étend en France.
C’est à dire ?
Wanamatcha!! une magnifique tartine de la spécialiste Coconne… 😁😂🤣 À vue de nez 40 lignes de “bla bla bla gna gni gna gnin gnin” qui part dans tous les sens, j’ai pas compté, merde… la flemme… 😁😆😂 Ça va mieux Coconne, tu t’es bien épanchée? Rivière salée tu y vas souvent? Combien de maisons cambriolées, combien de voitures volées à la BD, par rapport à RS? Hein Coconne??!! Tu ferais bien d’arrêter de picoler, Coconne, tu deviens de plus en plus brouillonne… 😁😆😂😂🤣 “des vols à la tire dans les voitures” on dit “vol à la roulotte”, Coconne. Donc toi tu… Lire la suite »
Te fatigue pas Rocky on a compris que tu es tout seul à la maison et qu’il n’y a pas ton auxiliaire de vie pour te lire et surtout t’ expliquer les commentaires des autres !🤣😂😂 Sinon Dukong , depuis que Rivière Salée est devenue une zone sinistrée crois – tu qu’il y ait, le parfait imbécile qui insiste , encore de quoi tenter les cambrioleurs ? Idem : tu vis sur quelle planète le niais ? Tu t’informes des faits divers actuels en NC ? “Brouillonne” ? Dit le “déconneur ” de service de Calédosphère qui écrit les plus… Lire la suite »
Correction: pickpockets
Calme toi coconne, nous sommes entre gens de bonne compagnie (enfin… moi… Toi tu es une woinrue mal élevée qui se prend pour une intello)… UNE FOIS DE PLUS tu ne comprends rien et tu réponds à tort et à travers… c’est ce que te répètent oups et Electron, et ce que je me tue à te dire… et tu sais pourquoi? C’est parce que tu es une vieille carne frustrée et hargneuse, ce qui te rend agressive… Tu aboies au moindre stimulus, sans réfléchir… En fait tu ne réfléchis pas, jamais… tu régurgites seulement la propagande qu’on t’a faite… Lire la suite »
Cette image, tu l’as déjà publiée avec quasi le même commentaire et je t’avais aussi répondu quasi la même chose . Le seul qui est excité et pas calme du tout mon brave R.S c’est toi. Et en effet,je confirme,comme la dernière fois , que ce que tu affiches et que tout le monde peut constater à TON sujet en te lisant , que comme il y est écrit , ” AVANT LES RESEAUX SOCIAUX ,IL N’Y AVAIT QUE TA FAMILLE QUI SAVAIT QUE TU ÉTAIS CON ,ROCKY SIFFREDO ! ET maintenant en effet de nouveau tout le monde le… Lire la suite »
La réflexion du « has been » est certainement celle que se font beaucoup de Français, ce n’est donc pas cet aspect du personnage qui compte. Etre « has been », empêche-t-il d’être lucide ? S’agit-il d’une réflexion, ou d’un état de faits ? On perd des enfants, sur notre sol, tués (ou agressées sexuellement) Ils sont tous de souche ethnique européenne, tu avais remarqué j’espère ? Tu peux aussi ajouter les nombreuses victimes adultes d’attaques au couteau ; ce sont les victimes d’une même cause (et Samuel Paty et Dominique Bernard). Il ne s’agit pas de dire que « l’immigration est responsable de tous… Lire la suite »
EL “On perd des enfants, sur notre sol, tués (ou agressées sexuellement)”. “Ils sont tous de souche ethnique européenne, tu avais remarqué j’espère ?”. ??? Genre de réflexion qui n’engage que toi. Des chiffres, des faits incontestables. Le preuve de ce que tu avances. “Tu peux aussi ajouter les nombreuses victimes adultes d’attaques au couteau ; ce sont les victimes d’une même cause (et Samuel Paty et Dominique Bernard).” Nombreuses victimes ! Là encore des chiffres incontestables. Des preuves irréfutables de ce que tu avances encore une fois. Cette réflexion que je fais, ne cherche en aucun cas à minimiser les meurtres… Lire la suite »
Ah, je retrouve le zep égal à lui-même, bouffi d’autosuffisance, la parole de l’autre ne vaut rien, il doit prouver, même si tu lui es sous le nez des faits incontestables. Seule la parole du zep est infaillible. Puisque tu es de toutes évidences si peu informé, je te suggère d’aller trouver toi-même une photo de Lola, de Philippine, de Thomas, de Mathis. Tu auras “la preuve”, “des faits incontestables” et tu verras qu’il s’agit de faits et non d’une “réflexion qui n’engage que moi”. Voilà, re, de l’autosuffisance qui n’apporte que des comms creux, juste des effets. Commentaire invalidé.… Lire la suite »
EL “Pousser ta pitrerie jusqu’à contester “de nombreuses victimes” est une insulte à la France et aux Français, aux familles des victimes du Bataclan et de Nice. Et toutes les victimes d’attaques mortelles au couteau qui ont fait la une TV.” Trouve un seul de mes commentaires dans lequel j’aurais, soi-disant, minimisé les assassinats, les meurtres commis en France par des terroristes radicalisés, par de quelconques désaxés. En particulier à Nice en juillet 2016, au Bataclan en novembre 2015. Tu dérailles complètement. Je le répète à nouveau, mes commentaires émis sur ce sujet n’ont pour seul objectif que celui de… Lire la suite »
Tu as nié les faits et la nature des faits, c’est une façon de minimiser, voilà ta pitrerie corniaud.
Donc oui je maintiens ta pitrerie est une insulte faite à ces enfants français innocents morts dans les mains d’OQTF, et à leurs familles.
Faut assumer maintenant.
On s’en fout de ce qui se passe ailleurs, c’est une sortie du sujet qui ne prouve en rien le contraire des faits.
EL “Tu as nié les faits et la nature des faits, c’est une façon de minimiser, voilà ta pitrerie corniaud.” Ben là ! Explication de texte STP. “Donc oui je maintiens ta pitrerie est une insulte faite à ces enfants français innocents morts dans les mains d’OQTF, et à leurs familles.” En quoi mes commentaires, dans lesquels [je l’affirme encore une nième fois] j’ai souligné le côté abject de ces assassinats d’enfants (ou d’adultes) en France constitueraient une pitrerie ? Tu es complètement ravagé, à la masse. Après avoir souligné le côté abject, ignoble de ces crimes, rien ne m’empêche… Lire la suite »
“un minable petit bourgeois arrogant“… un caldoche fin de race de Nouméa, quoi… 😁😆
” un caldoche fin de race quoi” Et toi un “gros minable” d’origine inconnue sur toute la planète , et pour cause, une aberration et erreur génétique, fruit d’une expérience illégale, spécimen unique on l’espère , totalement dérangé qui déverse sans retenue aucune ses inepties et vulgarités sur la toile et où la place est plus dans un HP que chez lui à délirer à l’abri de son pseudo . Si tes copains t’ont donné ce surnom ce serait parce que dis- tu , tu serais toi aussi un boxeur,? Soit ils sont ignares comme toi soit ils te prennent… Lire la suite »
Ce que tu peux être conne, ma pauvre Coconne… en fait tu ne comprends pas, et ensuite tu extrapoles à partir de ce que tu as cru comprendre…😆😂😂
Mon prénom N’EST PAS “Rocky”, Coconne… et j’ai juste fait un petit peu de boxe comme ça, en amateur…😁😆
Mon prénom… donc… allez devine un peu pour voir, Coconne… 😁😆
Mon prénom n’est pas Rocky ,Coconne ”
Mais je n’ai pas dit que ce l’était mon gars ! Loin de là , on en reste au prénom de ton pseudo et à son patronyme et à la référence à Rocky le boxeur personnage imaginaire ! Dur dur une fois de plus la comprenette! Je “n’extrapole” donc rien et n’ai rien” cru comprendre” . La vieille carne a encore sa tête. Ton vrai prénom on va le demander à Freund , ça, ira plus vite vu que tu causes souvent avec lui il doit être au courant.
Ps : ce que tu peux être ” con ” mon pauvre concon ” …🤣
“Je ne vois pas ce que tes exemples australiens apportent dans la démonstration de quoi en fait. Alors en fait ton commentaire, il voulait démontrer quoi ?”
Soit t’es vraiment con ou… t’es vraiment con.
Je souhaite que tu le fasses exprès.
Ces deux exemples avaient pour seul but, celui de te démontrer que la France n’avait pas le privilège (si l’on peut dire) d’être, le seul pays au monde, l’objet d’attentats commis pas des individus passablement dérangés.
(ajout : dérangés par leur religion)
Ben non, ça ne démontrait rien puisque ça allait dans mon sens.
“L’immigration n’est pas responsable de tous les mots, “
Exact, certains soupçonnent aussi fortement l’
Académie Française.
” ils sont tous de souche ethnique européenne , tu avais remarqué j’espère ” Comme le jeune Medhi K. victime de narcotrafiquants à Marseille et qui voulait devenir policier et passer le concours de gardien de la paix “? Tu n’as plus aucune retenue dans ton discours raciste l’Electron ! Et en NC tes propos sont identiques à ceux tenus par la frange extrêmiste,xénophobe et en pleine dérive autoritariste qui sévit et ne cherche qu’à dresser les habitants les uns contre les autres au motif de leur rattachement à une communauté ethnique pour servir sa dialectique . De plus mon… Lire la suite »
Ah ça y est, t’as pas pu t’empêcher de l’ouvrir pour me sortir des conneries et donner le bâton pour te faire battre, tu en veux encore ? Ce qui s’est passé pour Mehdi, meurtre en rapport au milieu de la drogue et de ceux qui le combattent, …n’a rien à voir avec les clandestins et OQTF dangereux, que la France a voulu expulser et c’est qu’il y avait bien une raison. Et ces individus dangereux ont bien tué des jeun s français blancs; c’est factuel connasse, quelque soient les tortillements du cul que tu feras pour prouver … quoi… Lire la suite »
Et la tienne tu l’as relue” ta chiasse “à toi, ,”gros plouc?” Parce que le narco-trafic n’est pas de nos jours , notre plus grand fléau national, européen et mondial , tant par les réglements de compte entre gangs dans les villes, causant des dommages collatéraux parfois avec des victimes innocentes se trouvant par un hasard malheureux au coeur de ces fusillades que par les addictions que cette drogue entraîne au sein de la jeunesse française et tous les problèmes sociétaux que cela engendre!Certains des petits dealers sont des mineurs étrangers liés au trafic d’êtres humains . Sans oublier les… Lire la suite »
Narcotraffic : Tu changes de sujet connasse. Rien de raciste dans tes propos? Mais si le parfait ahuri ! La preuve ! ” deux jeunes femmes blanches poignardées” ! Pourquoi,cela aurait changé qq chose si elles ne l’avaient pas été? Sinistre conne, où est le racisme ? ce sont les faits. Le mec les a poignardées pour cette raison. Quelle honte de se comporter comme tu le fais : nier la nature des faits pour ramener ta petite gueule. Quel manque de respect pour les familles. Si je te dit qu’en 2024 des militants CCAT ont insulté, intimidés, sabre d’abattis… Lire la suite »
Je ne change absolument pas de sujet! Quant à ton exemple de la CCAT, le niais, je l’ai moi- même évoqué en comparant ta dialectique à la leur. Tu ne sais pas lire! Tu as le même narratif , exclusif xénophobe et ethnocentré. Tu ne t’en rends même pas compte tellement tu es borné ! Quant à tes préoccupations sur les motifs de tous ces psychopates paumés et en errance c’est ce qui te paraît le plus intéressant!” La criminalité de droit commun n’a rien à voir avec ça ” dis- tu l’expert en droit et criminologie? Lesquels de ces… Lire la suite »
Si, tu changes de sujet; soi tu es complètement idiote pour ne pas t’en rendre compte, soi tu es malhonnête, ce qui ne me surprendrait pas. Mon exemple de la CCAT montre l’absurde de tes accusations de racisme. je l’ai moi- même évoqué en comparant ta dialectique à la leur Faut vraiment que tu consultes un psy à écrire des fantaisies pareilles. Le reste de ton comm: un gloubiboulga intellectuel décousu et sans sens, symptomatique du bordel qui règne dans ta cervelle. Oui, tu donnes le bâton pour te faire battre; et tu crois que c’est avec tes pitreries que… Lire la suite »
” Mon exemple de la CCAT montre l’absurde de tes accusations de racisme ” Et c’est pour ça le farfadet que tu fais comme eux et que tu utilises le même genre de vocabulaire et de référence à l’origine ethnique et à la couleur de la peau dans tous tes commentaires comme argumentaire et un discours ethno centré , comme rempart de “notre civilisation” ? Tu n’as même pas compris mon allusion à Poutine vu ta réponse stupide ! “Et quant au bàton pour de faire battre ” toujours pas,et pitreries encore moins et convaincante ,certainement plus que ta réponse… Lire la suite »
Bah, Coconne c’est juste une vieille conne frustrée pour qui avoir le dernier mot est d’une importance capitale, quitte à se dédire, à se contredire, à raconter d’énormes conneries, et ce avec la plus parfaite mauvaise foi… Elle n’a plus que ça la vieille carne pour avoir l’impression d’exister, en plus ça lui fait du bien, elle se défoule, elle compense ses frustrations. Quand on a eu une vie vide de sens et qu’on n’en n’a jamais rien fait, de sa vie, et que la fin approche… c’est sûr on peut être frustrée… c’est le propre de toutes les vieilles… Lire la suite »
De plus mon pauvre Electron, sur quelle planète et dans quel siècle vis – tu ? Tu es au courant des rapports démographiques des populations sur les différents continents de la Terre sur les 8 milliards d’humains ?Il y a des décennies que l’Europe est dépassée en nombre par l’Asie et l ’Afrique. Et ta réponse c’est des murs pour sauver ” notre civilisation “? Double sinistre conne, quel arguent idiot ! Oui, “notre civilisation”, basée sur son identité chrétienne, sur les libertés fondamentales, l’égalité homme-femme, la liberté d’opinion, la démocratie, le respect et la protection des minorités sexuelles, ce… Lire la suite »
Le chiffre des lectures à monté. Alors un peu d’effort la niaiseuse pour être lue pas des dizaines de milliers d’intervalles assoiffés de tes déclarations.
BÂÂÂÂNJOOUUUUR MÉÉÉMÉÉÉ COOOOCOOOONNE!!!
Salam aleikoum la vieille… aujourd’hui tu manges pas de cochon, ok?
Et puis tu essaies de changer de disque, un peu… “niais, simplet, kong”, etc ça va un moment…
Révise plutôt tes recettes de cuisine, genre dinde aux glands🌰, c’est imminent il va y avoir la guerre, c’est bien, les copains marchands de canons de Macron vont gagner beaucoup d’argent, et toi tu vas aller en Ukraine faire la popotte pour nos pioupious…
“Et puis tu essaies de changer de disque ,un peu,niais, simplet, kong,ça va un moment ” Hahahahaha 🤣 Dit le “parfait ahuri” qui écrit tous les matins les mêmes imbécilités avec quasi les mêmes illustrations idiotes! Ben non mon gars, on ne peut que te répondre en te répétant la même chose, vu que c’est toi qui ne changes jamais de disque : ce que tu écris est en eff7et toujours très niais et tu es bien le ” crétin ” n0 1 de service de Calédosphère . Puisque ça ne te dérange pas de continuer ta “déconnade” je ne… Lire la suite »
Mais oui, c’est ça Coconne… allez, bientôt tu vas pouvoir montrer que tes propos va t’en guerre c’est pas du flanc, tu vas nous démontrer ton patriotisme ardent, tu vas aller faire la cuisine en Ukraine pour nos pioupious…
Tu vas leur faire quoi? de la dinde aux🌰 glands? Ou des 🌰glands glacés?
“Mais oui c’est ça Coconne …” Mais oui mon gars , c’est bien ça !🤣 Ah force comme je l’ai écrit de jouer à l’abruti🤪 tu as bien fini par le devenir ! Car je ne sais pas où tu as pu entendre mes propos ” va t’en guerre ” mais tu es comme la Jeanne😇 , tu entends des voix ! En plus du radotage ( tu te répètes , pépère , avec tes” recettes et les pioupious “) et de la difficulté de la comprenette ! “Tu vas leur faire quoi etc” Moi rien mais toi vu ton… Lire la suite »
“Ah force comme je l’ai écrit de jouer à l’abruti, tu as bien fini par le devenir !”
Pour atteindre un tel degré d’abrutissement à la force du… poignet, il lui aurait fallu plusieurs siècles.
Non, non, lui c’est de naissance, lui c’est tombé dedans avant même d’être petit, lui c’est manger dans les restaus les plus chers comme elle :
Elle se vantait de manger dans des restaurants étoilés à New York mais partait sans payer : une influenceuse jugée pour vol
” … lui , c’est de naissance ”
C’est l’atavisme de ses ancêtres , les “macaques crabiers” , les singes chapardeurs de Bali.
“je ne sais pas où tu as pu entendre mes propos ” va t’en guerre ” L’argument massue des faux pacifistes vrais kollabos poutinophiles du moment… Tiens pour le faire partir au quart de tour ainsi que pour faire sortir son nouveau copain Alik de sa datcha, rien de mieux que du BHL en Ukraine, déclenchement du réflexe conditionnel d’orfraie à la mode Godwin assuré : BHL : « Pour que la victoire revienne à l’Ukraine… »Le philosophe, qui par ses films sur le terrain a depuis 2022 documenté la guerre, salue l’initiative française de livrer des avions pour aider l’Ukraine à chasser… Lire la suite »
Et encore Hitler a t-il fini par avoir la ” bonne idée ” de se suicider! Poutine lui il s’accroche ! Et il parle même de rajeunissement et d’immortalité lors d’une conversation privée avec son ” ami ” Xi Jinping en septembre.
“rajeunissement et d’immortalité “
et, a rajouté Poutine, à l’aide de greffons.
Dont on se doute bien frais car prélevés peu après meurtre sur jeune prisonnier de guerre ukrainien sélectionné hypercompatible.
“Poutine lui il s’accroche”
Et le RN aussi :
Guerre en Ukraine : « Nos enfants n’iront pas combattre et mourir en Ukraine », promet le gouvernement
“La classe politique avait alors immédiatement réagi, comme Mélenchon “en désaccord total » ou Louis Alliot (RN) pour qui « il faut être prêt à mourir pour son pays », mais dans une guerre « juste » ou qui engage « la survie de la nation ».
Résister par les armes à Poutine agressant des démocraties européennes, pour Moncon de maire de Perpignan ce ne serait pas forcément juste ?
Le suspense reste entier …
Que devrait on dire de toi
BHL ?
Le conseiller de Sarkozy qui lui a murmuré à l’oreille qu’il devait intervenir militairement en Libye ?
C’est une référence pour toi BHL ?
Ce type qui se sert des guerres pour se faire une grandeur morale ?
SHAAAABAT SHALOM MÉMÉ COCONNE!!
“Ah force comme je l’ai écrit “???
Caisse à dire, ma coucouille Coconne?😁😆
“Ah force de briser en mes mains des guiitaaareuus”…🎵🎶🎶🎶🎵🎶
Fais pas semblant d’avoir oublié tes propos va t’en guerre Coconne, fais pas comme tes couzs les kahouins de la CCAT qui nous font le coup du “c’est pas nous c’est pas nous”…😁
Tu t’enfonces, c’est tout…😁
Déja parti pour la ” grosse déconnade le ” fada ” de service de Calédosphère! Aucun oubli de ma part le déjanté!🤪 Et toujours tout à fait pour que les Etats de droit européens continuent plus que jamais à soutenir l’Ukraine financièrement,militairement et même sur le terrain ! Et avec leur armée de métier comme celle de la France( le simplet avec ses “pioupious”🙆 à la noix ) d’autant qu’il s’agit du sol européen … C’est d’ailleurs ce qu’ont désormais acté les pays nordiques frontaliers de la Russie en décidant de renforcer cette défense militaire commune face à l’attitude déplorable… Lire la suite »
Il n’empêche qu’avec des cons pareils, auxquels je constate que se rajoute par suivisme un certain Oups2 (Kompromat ?…), calédosphère perd son âme lentement mais sûrement et à terme ses lecteurs. Sinon, plus gravement, il fut un temps, avant que la Russie de Poutine ne la tue, où l’ONU avait une certaine influence acquise dans le prolongement de la Société Des Nations. Reste qd même son discours, c’est mieux que rien : “Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a prévenu vendredi que toute “solution de paix” pour l’Ukraine devrait respecter son “intégrité territoriale”, à la veille d’une réunion du… Lire la suite »
“C’est mieux que rien” Et pour une fois très explicite ! Quant à D. Trump il vient de se faire remettre à sa place par le Président du Brésil qui lui a dit en résumé de se mêler de ses affaires concernant son exigence de libération de J. Bolsonaro et idem pour les taxes douanières sur lesquelles ce comique est revenu ! Et pour cause ce sont les consommateurs américains qui sont le plus pénalisés. Rien qu’au niveau des importations du café du brésil … ça aurait fait cher la tasse de café sachant qu’ils en sont de très gros… Lire la suite »
calédosphère perd son âme
Ben ouais…. depuis que tu traites abondamment de “facho”* et de “traitre à sa patrie” ceux qui voient les choses différemment sur la réponse à donner à la guerre en Ukraine…
(*) tu te elleffises, tu te mélenchonises, c’est mauvais signe.
“(*) tu te elleffises, tu te mélenchonises, c’est mauvais signe.”
Tjrs ta légendaire fainéantise : vérifie donc, pour une fois, tes assertions hasardeuses avant de débiter n’importe quoi : Mélenchon a la même attitude “pacifiste” que ta poissonnière vis à vis de ton potentat russe adoré, nigaud !
“La réponse à donner à la guerre en Ukraine”
selon toi, c’est de “négocier ” avec (= capituler devant) l’envahisseur criminel contre l’Humanité Poutine en lui livrant l’Ukraine comme hors d’oeuvre, pour commencer ?!!
Mais je m’en fous de la position de Mélenchon, de plus cela n’est pas du “pacifisme” me concernant; c’est une guerre entre Russes et Ukrainiens pour un bout de territoire, e ne sont pas nos affaires.
“c’est une guerre entre Russes et Ukrainiens pour un bout de territoire. “
Plutôt une guerre à géométrie variable, si on t’en croit : en mars 2022, sur calédosphère, c’était l’OTAN qui encerclait et menaçait la Russie, selon toi, et on allait “voir de quel bois se chauffait (ton héros) Poutine” …
“Ce ne sont pas nos affaires.”
Faux, nous sommes un des pays de l’OTAN, sans parler des recommandations sur le respect de l’intégrité des frontières internationalement reconnues de l’ONU à laquelle nous adhérons et du memorandum de Budapest censé interdire l’attaque de la Russie contre l’Ukraine.
“c’est une guerre entre Russes et Ukrainiens pour un bout de territoire. “
Plutôt une guerre à géométrie variable, si on t’en croit : en mars 2022, sur calédosphère, c’était l’OTAN qui encerclait et menaçait la Russie, selon toi, et on allait “voir de quel bois se chauffait (ton héros) Poutine” …
Ils (les marionnettistes) ont nourri les causes, ce qui a déclenché une guerre régionale entre R et U.
à eux de se démerder, catégoriquement opposé à l’idée d’envoyer des jeunes Français aller mourir là-bas pour 4 provinces ukrainiennes. On s’en fout, pas notre souci.
Le problème est aussi que c’est le Chef d’Etat Major qui a prononcé ces mots. Or, c’est un discours qui relève de la politique et là il sort de son domaine. Discours tenu lors de l’assemblée des maires de France où c’était le Président qui venait parler, mais comme il est devenu impopulaire et donc inaudible il ne l’a pas fait il a envoyé le militaire faire à sa place ce discours qui relève de la politique étrangère. Car le militaire de haut rang est d’abord un subalterne de la politique, dans ce discours il a été la voix de… Lire la suite »
“La voix de son maître ” Qui , à moins que nous ne soyons plus sous le Régime de la V ème République, est bien- non pas le “maître mais le” chef des armées” responsable en tant que Président de notre Etat de la sécurité du territoire et décideur au plus haut niveau des actions de notre armée sur ce territoire comme hors de celui – ci et qui préside “les conseils et les comités supérieurs de la Défense nationale” comme le dit l’article 15 de notre Constitution. Quant à l’opinion des Français sur cette “logique guerrière” encore faudrait –… Lire la suite »
Tu es soûlante, Coconne… tu nous fais un petit coup de LeZobine ou quoi? Tu te regardes écrire? Tu te prends pour une éditorialiste?😁😆
C’est tes potes bidasses à la retraite qui t’expliquent des trucs?😁😆😂😂🤣
Mais tu n’es une obscure petite dactylo à la retraite, Coconne, tu n’as aucun talent… désolé…
Souviens toi Coconne: De la concision. CON-CI-SION.
“Tu es soûlante Coconne etc etc ” Et toi” Dukong Dukong” , soûl tout court, dirait – on ! Et “désolé tu n’as aucun talent “?Je me contrefiche complètement de tes états d’âme 🤣 car je ne te dis pas le tien de talent ! 🤪 Eblouissant !,🤪😜😛🙃 Tes références à la dactylo en retraite, le pépère , à l’éditorialiste, et à la con- cision tu les as déja faites maintes fois ! “Souviens -toi Coconne ” Du vase de Soissons ? Pour toi, c’est foutu, tu radotes , tu ” gagates “et ne te souviens pas de ce que… Lire la suite »
Arrête avec tes jeux de mots à deux balles, Coconne, on n’est pas dans la cour de récré de ton collège de bonnes sœurs… 😆😂😂
“Arrête avec tes jeux de mots à deux balles Coconne ” Il n’y avait aucun jeu de mots l’intello! “On n’est pas dans la cour de recré de ton collège de bonnes soeurs” Dit le simplet dont les siens sont du niveau du bac à sable de l’école maternelle!👶 Dans ce collège “concon “, je suppose que je suis la vieille Mère Révérende car si je suis aussi une ” vieille carne ” comme tu le dis je ne peux être que cela !Faut être cohérent le Rocky 🤔,même dans la “déconnade” ! T’en loupes pas une Rocky S. plus… Lire la suite »
“pour 4 provinces ukrainiennes. “
Bien plus que pour ça, mais pas envie de continuer à parler à un mur.
Et si c’est juste entre Russie et Ukraine, pourquoi diable Trump vient leur et nous casser les burnes avec son soi-disant plan de “paix” (en dehors de son orgueil) ?
Ce type veut se retirer de l’affaire, pourquoi crois-tu qu’il insiste ainsi ? Avec Trump, faut chercher son intérêt économique (personnel, si possible).
L’Europe doit pas s’en mêler, par contre t’es plus compréhensif pour ton second faux-cul préféré après Poutine !
Tu veux envoyer des jeunes Français se mêler et risquer leur vie pour une bagarre entre Russes et Ukrainiens sur des morceaux de territoires où l'”ukrainophonie” et la “russophonie” sont historiquement mélangées et se disputent ” non ici c’est chez nous” “non c’est à nous, c’est pas à vous na ! “. Pas moi. Ni jeunes soldats français morts pour ça, ni risque d’escalade mondiale pour 4 provinces ukrainiennes*. Trump ? il a ses raisons, c’est hors champ de notre point abordé”. Peut-être qu’il est sincère et veut la paix. Peut-être qu’il se rêve toujours prix Nobel. C’est important pour… Lire la suite »
“Trump…..C’est important pour toi ?” L’important c’est ça, si les démocraties veulent vaincre la coalition des dictatures russo-sino-nord-Coréenne : Négociations de paix à Genève : “les frontières ne peuvent pas être changées de force”, insiste l’UE | Watch De plus l’UE demande à Trump de renoncer à détourner à son profit et celui des USA les 200 milliards d’équivalents en euros russes détenus par des banque belges mais qu’ils soient consacrés uniquement à la reconstruction de l’Ukraine, t’es content j’espère ! Avec ça + l’intangibilité des frontières rappelée par ton adorée VDL, Poutine et Trump, si l’UE tient bon, l’ont… Lire la suite »
Impossible corrections !
” les 200 milliards d’(équivalents en) euros russeS”
Inforétif : Avec ça + l’intangibilité des frontières rappelée par ton adorée VDL, Poutine et Trump, si l’UE tient bon, l’ont dans le luc, c’est ça l’important ! 1-Tu l’as entendu VDL rappeler ce principe intangible quand l’Azer a pris le karabakh et viré des dizaines de milliers d’Arméniens? Moi non. Pourquoi ? t’aurais pas une petite idée ? 2-“Si l’UE tient bon” ? moi je veux bien mais ça fera quoi ces belles paroles contre la réalité sur le terrain ? 3-Inforétif, il est temps que tu redescendes sur Terre : assieds-to, respire un grand coup, j’ai une révélation brutale à… Lire la suite »
“quand l’Azer a pris le karabakh et viré des dizaines de milliers d’Arméniens?” Tu sais que l’Arménie s’est abstenue de condamner la Russie pour son invasion de l’Ukraine lors de l’assemblée générale de l’ONU en 2022 ? L’UE est sympa mais n’oublie rien. Et finalement Poutine a trahi l’Arménie… “l’Europe n’est qu’une puissance verbale.” Le seul “mérite” de Poutine avec son invasion débile est justement qu’elle ne l’est plus, tout en restant la deuxième économie mondiale. L’Europe en 2025 : géant économique, nain politique ? | Cairn.info En dépit des partis d’extrême-droit européens, face à la menace ultiforme russe, la… Lire la suite »
“l’Europe n’est qu’une puissance verbale.”
Qui ne cesse de s’étendre…
500 millions d’âmes aujourd’hui.
à comparer aux 140 millons d’âmes damnées “russes” (dont pas mal d’islamiques…), une Russie en pleine dénatalité et qui part en gros morceaux à l’Est tt en cherchant (vainement !) à compenser à l’Ouest.
Occupée en Ukraine, la Russie perdrait peu à peu le contrôle de son extrême orient, au profit de la Chine
Inforétif “une Russie en pleine dénatalité et qui part en gros morceaux à l’Est tt en cherchant (vainement !) à compenser à l’Ouest.” Et ce n’est pas l’idiot utile de Xi Dada au pouvoir, ce dictateur d’opérette qu’est Poutine qui va arranger les choses. “Invasion chinoise en Sibérie : une menace pour la Russie ?” https://www.youtube.com/watch?v=0MdC0jqiSmA “En Russie, Xi Jinping lorgne sur la Sibérie” https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-internationaux/en-russie-xi-jinping-lorgne-sur-la-siberie-2796732 En 2024 la population chinoise était estimée à 1,408 milliard d’habitants. Celle de la Russie à 146 millions d’habitants. Ils auront beau dire, beau faire les deux compères (*) , la messe est dite.… Lire la suite »
LedZep : Radio-Macron : “Invasion chinoise en Sibérie : une menace pour la Russie ?”
From Vladivostok with love :
https://www.youtube.com/watch?v=tMEcRTNMzt4
Alik “From Vladivostok with love :
https://www.youtube.com/watch?v=tMEcRTNMzt4 ”
De la réclame, du boniment, du matraquage, de l’affichage, de la propagande… pro Russe.
Y’a qu’à lire les commentaires.
Des comme celui-là, il y en a plus d’un :
“Yeah Russia needs an intelligent President like Vlatimir Putin wish there are still Vlatimir Putin likes in Russia”
[Oui, la Russie a besoin d’un président intelligent comme Vladimir Poutine. J’aimerais qu’il y ait encore des gens comme Vladimir Poutine en Russie].
“Radio-Macron : “Invasion chinoise en Sibérie : une menace pour la Russie ?””
因为总是 (Cause toujours !)
“Des Chinois en Sibérie” :
https://www.youtube.com/watch?v=3Tna3T9D88w
“De la réclame, du boniment, du matraquage, de l’affichage, de la propagande… pro Russe.” Bah, selon ce lien : Justice. Ils sont accusés d’espionnage au service de la Russie : qui sont Anna Novikova et Vincent Perfetti ? “Sur sa page Facebook, Anna Novikova a relayé des médias pro-Kremlin comme RT France et Sputnik Africa, ou encore republié un entretien de l’ex-militaire français Xavier Moreau, connu pour être un propagandiste de Moscou et qui a notamment décrit Alexeï Navalny comme un escroc emprisonné pour des délits de droit commun, au lendemain de sa mort.“ Ttes ressemblances avec les activtés alikollaborationnistes sur Calédo seraient… Lire la suite »
LedZep : “De la réclame, du boniment, du matraquage, de l’affichage, de la propagande… ”
C’est ça aussi :
https://www.youtube.com/watch?v=FVKcODDmYSM&t=672s
LedZep, ça y est, c’est la paix, suffit que Zelensky clique sur le bouton “oui” contenu dans ce lien une fois ouvert: La Russie « cessera les hostilités » si l’Ukraine quitte les territoires revendiqués par Moscou, promet Vladimir Poutine Il restera à ce bon Poutine à son Alik à chiffrer les dommages de guerre qui lui sont dus puisque, comme chacun sait en Russie après bourrage de crâne, c’est l’Ukraine qui a attaqué ainsi que le nombre de vierges ukrainiennes à livrer aux militaires russes rescapés présents en Ukraine. Un plus serait la décimation à l’ancienne de l’armée ukrainienne… Lire la suite »
Il est pas là, LeZob, il est parti se faire sucer sur la Gôlcosse… et Mémé Coconne est allée rendre visite à ses cousins mongoliens en Mongolie…
Tu parles tout seul mon con, dans le vide, y’a plus personne…😁😆
Console toi il te reste le bistrot, et le pastis.
Joyeuse fin de vie, pochetron.
“l’Europe n’est qu’une puissance verbale.”
Qui ne cesse de s’étendre…
Qu’est-ce qu’il reste à ajouter ? le Kosovo ? le Montenegro ? des confettis…
500 millions d’âmes aujourd’hui.
à comparer aux 140 millions d’âmes damnées “russes”
Et qu’est-ce que les “500 millions” ont fait devant les “140 millions” qui sont allés sur le terrain faire la guerre en 2022 ?
Rien.
une Russie en pleine dénatalité
Et l’Europe ? T’es pas au courant ?
Tu sais que les démographes s’alarment, l’ampleur de la catastrophe est sous-estimée.
La vacuité de tes arguments.
“Et qu’est-ce que les “500 millions” ont fait devant les “140 millions” qui sont allés sur le terrain faire la guerre en 2022 ? Rien.” Rien, comme les Français (en fait pas rien mais trop peu, en raison des auto-proclamés “patriotes” mais vrais fascistes français d’avant-guerre et autres “communistes” qui, comme les nôtres aujourd’hui ont fait leur possible pour désarmer leur soi-disant patrie bien-aimée). Pour la dictature russe, c’est le dictateur seul qui a décidé de lancer ses barbares (non russes pour la plupart) endoctrinés, drogués, vodkaïsés, violeurs, pillards, assassins détraqués sur l’Ukraine incrédule, c’est évidemment plus difficile pour une… Lire la suite »
les fascistes d’avant-guerre … arrête de répondre avec la première connerie qui te passe par la tête. Et je te rappelle que renforcer notre armée a été le discours politique du RN ces dernières années (j’en parle par obligation, parce que tout passe par lui dans ta tête), il avait pris position pour que la France s’équipe d’un deuxième porte-avion avant même 2017. Faut suivre.* Le vilain RN avait donc pris cette position par clairvoyance, alors que Macron ne le fait que parce que les conditions l’y contraignent. Les petits pingouins macronistes se découvrent patriotes devant le contexte mondial, ça… Lire la suite »
“les fascistes d’avant-guerre … arrête de répondre avec la première connerie qui te passe par la tête.” “Selon Cairn [mais Electron l’est plus fort que les spécialistes…] : Les facistes français avant 1939 ont souvent critiqué le réarmement comme un effort inutile ou une distraction de la priorité de l’Allemagne. Ils ont souvent soutenu la politique de non-agression de Vichy, qui a été critiquée pour sa capacité à maintenir la paix en Europe tout en permettant à l’Allemagne de réarmement. Les critiques ont souvent été basées sur des préoccupations de sécurité nationale et des craintes d’une guerre interétatique. ” Exactement ce que fait ton RN et particulièrement sa poisssonière achetée par Poutine. “un deuxième porte-avion “ n’a strictement AUCUN intérêt pour dézinguer les Russes, pas même l’unique que l’on a : nos avions de chasse en Pologne et Roumanie sont à deux pas du champ de bataille ukrainien, bien mieux abrités et bien plus proches que la Méditerranée ! Tu es teubé ou tu le fais exprès ? “ah, “la chose… Lire la suite »
Mais qu’est-ce qu’on on a à branler monconrétif, je ne suis pas un “fasciste”, les électeurs ne sont pas des “fascistes”. Cette accusation en 2025 de “fasciste” est infondée, elle a été mise à mal par Onfray, Ferry*, etc… sors de ce stade anal ça élèvera ta réflexion. Et je viens de te mettre des éléments factuels, tu comprends rien t’es vraiment con ou quoi ? Ce n’est que du langage politique savamment entretenu pour être instrumentalisé, c’est à coté de la plaque en plus d’être malsain. A force de jouer à ton petit stupide tu es devenu aussi con… Lire la suite »
“je ne suis pas un “fasciste”, les électeurs ne sont pas des “fascistes”.
De mon point de vue, tout français qui approuve les crimes de Poutine est soit un gros con (c’est la majorité), soit un facho.
Ce n’est le cas ni de Onfray, ni de Ferry.
Toi et Alik êtes les deux à la fois.
Réponse complètement idiote, comme d’habitude. Tu avais dit quelque chose contre G.W Bush en 2004? Non. Donc tu as approuvé les crimes ! Donc tu es aussi un facho ! Tu as dit quelque chose contre Netanyahou sur Gaza ? Non. Donc tu as approuvé les crimes ! Donc tu es aussi un facho ! Tu as dit quelque chose contre les milliers de mort dans les provinces russophones d’Ukraine avant 2022 ? Non. Donc tu as approuvé les crimes ! Donc tu es aussi un facho ! Voilà, ça c’est pour le miroir de ta connerie et de ta… Lire la suite »
Inforétif :” …tout français qui approuve les crimes de Poutine est soit un gros con … soit un facho.”… Je n’approuve pas en tant que tels les crimes dont tu accuses Vlaldimir Vladimirovitch sans qu’il en ait été convaincu par une instance un peu plus qualifiée que ta suffisante personne (on n’entend guère parler d’une quelconque progression d’une quelconque enquête en cours). Encore faudrait-il d’ailleurs pour que je le fisse que dans un premier temps tu apportasses les preuves de leur existence, et dans un second celle de sa participation directe ou indirecte à leur commission. Le reste n’est que… Lire la suite »
Inforétif : “Ce n’est le cas ni de Onfray, ni de Ferry.”
On parle bien du même ?
https://www.youtube.com/watch?v=QhD_qOhosXI
“un deuxième porte-avion “ n’a strictement AUCUN intérêt pour dézinguer les Russes Imbécile, ceci remonte à la campagne 2017 et avant, il s’agissait d’une réflexion à l’échelle mondiale, un deuxième porte-avions pour que la France soit en permanence en mesure de répondre à une menace à tout moment être à la hauteur de ses ambitions. ça n’a rien à voir avec la Russie en 2022, tu es incapable d’aborder un réflexion dans sa globalité*, sans tout réduire à la Russie et au vilain RN, putain mais ce que tu es con ! —————————————- (**)nos avions de chasse en Pologne et Roumanie… Lire la suite »
Tiens, imbécile, du factuel, deux articles, un de 2016 https://www.publicsenat.fr/actualites/non-classe/marine-le-pen-commandera-un-2e-porte-avions-si-elle-est-presidente-52116 et un de 2017 qui t’explique la théorie militaire là-dessus : https://institut-thomas-more.org/2017/04/18/pourquoi-la-france-doit-se-doter-dun-deuxieme-porte-avions-2/ Un porte-avion est hors-service 30% du temps; ça suffira pour le cours aujourd’hui. Je t’en foutrais moi, des “fascistes qui veulent désarmer la France”. Ta bêtise te déshonore. Tu vois, la poissonnière a de toutes évidences une hauteur de vue bien meilleure que la tienne. S’il te plaît, abstiens toi de t’aventurer sur le terrain de “la chose militaire”, ça t’évitera de montrer que tu n’y connais rien. Et répéter comme un âne du MSN ne fait pas… Lire la suite »
“marine le pen commandera un 2° pA si…”
On s’en contrefout en ce moment.
Que fera le RN si il parvient au pouvoir par rapport au problème CRUCIAL que pose Poutine au Monde démocratique selon toi ?
Honorera-t-il l’engagement de la France dans l’OTAN si Poutine attaque un des Pays Balte, par exemple ?
Non, on ne s’en contrefout pas : cela invalide tes arguments à la con sur les “fascistes qui veulent désarmer la France”, c’est la preuve que tu n’écris que des conneries.
Tu t’enfonces.
Le reste n’est que supputations; ne te rabats pas sur des supputations sur un futur hypothétique pour faire l’impasse sur des faits réels passés qui balaient tes arguments mensongers.
S’il ne te reste que la malhonnêteté intellectuelle pour argumenter…
“Le reste n’est que supputations; ne te rabats pas sur des supputations sur un futur hypothétique…”
C’est pourtant bien ce que fait tout citoyen au moment de voter.
Et ce qui fait que, justement, il ne faut pas voter pour un RN à la présidence en 2027, sachant la proximité de ce parti avec la mafia au pouvoir de la Russie impérialiste contemporaine.
Les Français n’en ont rien à branler de ces supputations, ils vivent et subissent leurs problèmes au quotidien, ils ne sont pas obsédés par Poutine du matin au soir comme toi.
Infapproximatif. “Les facistes français avant 1939 ont souvent critiqué le réarmement comme un effort inutile ou une distraction de la priorité de l’Allemagne. Ils ont souvent soutenu la politique de non-agression de Vichy, qui a été critiquée pour sa capacité à maintenir la paix en Europe tout en permettant à l’Allemagne de réarmement. Les critiques ont souvent été basées sur des préoccupations de sécurité nationale et des craintes d’une guerre interétatique.”. Très bizarre votre lien 😁. Il conduit à un article de CAIRN, dans lequel on ne retrouve absolument rien du texte mis en exergue par votre désagrégation. Texte bizarre par… Lire la suite »
XYY : “Vichy ? avant 1939 ?”
Grillé.
Pas moyen d’hiberner tranquille …
https://www.tameteo.com/meteo_Irkoutsk-Europe-Federation+de+Russie-Irkoutsk–1-13528.html
Alik.
“Irkoutsk“.
Mardi 2 décembre : -32°C.
Température de ma pataugeoire en ce moment : +32°C 😑
Merci XYY d’avoir fait l’explication de texte ; j’avais lu en diagonale tout en me disant qu’il y avait des éléments pas très clairs. Inforétif s’enfonce de plus en plus dans sa fixette obsessionnelle sur « l’extrême drouate » et « les fascistes » et « le RN » et « Le Pen »*. Il ne sait plus discuter sur un sujet dans sa spécificité sans le réduire et l’aborder sous cet angle parce qu’il n’est plus dans la discussion saine et constructive avec une certaine hauteur de vue, mais dans une sorte de dévoiement permanent du sujet pour en faire une attaque contre son interlocuteur. Il… Lire la suite »
“pour en faire une attaque contre son interlocuteur”
Sais-tu comment se nomme ce trouble (que tu manifestes également avec les excellents LedZep et Minie) consistant à toujours se sentir moralement “attaqué” ?
Il n’y a aucun trouble moncon. Tiens, elle assume sa pratique d’insulter : Electron Libre Répondre à Minie 2 novembre 2025 08:37 Tu as abondamment usé de termes grossiers/rabaissant ( ça revient au même) à mon encontre par le passé et malgré mes demandes d’arrêter tu as continué. Minie Répondre à Electron Libre 2 novembre 2025 16:56 “Malgré mes demandes tu as continué” Pauvre chouchou fortuné! Electron Libre Répondre à Minie 2 novembre 2025 18:05 “Malgré mes demandes tu as continué” Pauvre chouchou fortuné! Tout est dit sur toi ! -tu ne nies pas que tu insultais, tu… Lire la suite »
Et puis tu nous casses les couilles tous les jours depuis trois ans avec cette guerre, avec ton obsession pour Poutine, à traiter tes concitoyens de “collabos” , de “traitre à sa patrie” et de “fachos”.
Sans compter toutes tes prédictions nostradamusiennes qui ne se sont jamais réalisées, comme nous dire fin 2022 que Poutine allait forcement tomber sous peu ses généraux allaient le renverser.
Même ditou et sa numérologie a fait mieux que toi sur le sujet.
L’Ukraine est un pays tout aussi corrompu que la Russie, alors que deux pays de l’Est se foutent sur la tronche pour des bouts de campagne je pense que ça doit être le dernier des soucis de beaucoup de gens.
“L’Ukraine est un pays tout aussi corrompu que la Russie” Faux, et de plus le peuple ukrainien lui-même n’y peut rien dans son ensemble. Contrairement aux Russes, sous propagande poutinienne mafieuse, les Ukrainiens souhaitent faire prtie des démocraties occidentales, dont l’UE, comme ils l’ont manifesté massivement par referendum. “ que deux pays de l’Est se foutent sur la tronche pour des bouts de campagne” Faux, c’est juste le dirigeant de l’un, le Russe Poutine, qui a ordonné à son armée d’envahir l’autre, l’Ukraine. On imagine notre sort dans les années 1940 si les décideurs US avaient tenu ton “raisonnement” ! “ça… Lire la suite »
Bein alors Monconrétif? Ça va pas? Même pas une petite allusion à Adolf? Même pas un petit “Ta gueule Si Crado?”
Tu nous couverais pas quelque chose, des fois?🤔
Inforétif : “On imagine notre sort dans les années 1940 si les décideurs US avaient tenu ton “raisonnement” !”
Dans mon souvenir, les USA ont entretenu des relations courtoises avec l’Allemagne (qui occupait la moitié de la France) et le Japon (qui occupait l’Indochine) jusqu’en décembre 1941, mais je ne saurais l’affirmer avec force comme en aurait l’autorité le premier prof venu, fût-il de biologie.
L’un de nous deux devrait, me semble-t-il, revoir ses cours du lycée.
“Dans mon souvenir, les USA ont entretenu des relations courtoises avec l’Allemagne (qui occupait la moitié de la France) et le Japon (qui occupait l’Indochine) jusqu’en décembre 1941”
Tout à fait exact, pour une fois (l’exception qui confirme la règle depuis le cirque de l’escroc de Marseille).
Les USA en ont tjrs rien eu à foutre de l’Europe (et donc des valeurs de la civilisation, c’est pas le dernier des Mohicans qui me contredira, parait qu’il est mort) :
“Lafayette, nous voilà pas ! ”
qu’il hurle quand il est tt seul dans ses chiottes le Canard Laquais…
Inforétif : “Tout à fait exact, pour une fois” Non, J’ai raison, comme pratiquement toujours, et chacun peut le comprendre : je ne parle que de ce que je connais, d’une part par les discussions que j’ai pu avoir avec des témoins oculaires, d’autre part par une étude sérieuse des sources. Je suis d’autant plus surpris que j’avais cru comprendre que tu avais des liens familiaux avec l’épopée coloniale indochinoise. Par contre, de ton côté, tu te prévaux de ton statut d’ancien professeur certifié pour considérer que ce que tu énonces est systématiquement la vérité absolue (ou au minimum celle… Lire la suite »
“le falot Jean-Noël Barrot”
Ou là là, tu vas vexer du monde sur le site là, Alik.
“je ne parle que de ce que je connais”, Ben voyons ! Qu’en est-il aujourd’hui de l’image renvoyée par l’escroc Raoult, si ne n’est que la désapprobation et la risée de toute la recherche scientifique mondiale, escroc qui s’est pris un blâme en pleine gueule, à défaut de la prison totalement méritée à laquelle il a échappé de par les protections politiques dont il avait bénéficié dans sa période de “gloire”. Qui, un minimum sensé, n’a pas compris que le personnage immensément criminel contre l’Humanité qu’est Poutine ne vaut même pas le prix des douze balles qui auraient dû l’envoyer… Lire la suite »
Inforétif : “Qui, un minimum sensé, n’a pas compris que le personnage immensément criminel contre l’Humanité qu’est Poutine ne vaut même pas le prix des douze balles …”
Déjà les chefs d’état responsables qui en plus insistent pour payer en roubles les éléments un peu sophistiqués réceptionnés ces derniers mois à Saint Paul lès Durance dans le cadre du programme ITER (il doit bien encore y avoir à l’intérieur quelques programmateurs de machine à laver récupérés à Kherson au moment de la retraite en bon ordre des troupes russes)
https://youtu.be/ntdWVwMDD70
“Déjà les chefs d’état responsables qui en plus insistent pour payer en roubles les éléments un peu sophistiqués réceptionnés ces derniers mois à Saint Paul lès Durance dans le cadre du programme ITER “ Quels chefs d’état ??? un peu sophistiqués ? —> des gros aimants … A part sur des sites russes de propagande, nulle part n’est mentionnée la livraison par la Russie du cryostat, si c’est de cela qu’il s’agit (plus de 3 fois la masse de la tour Eiffel) à la France … Ce qui ne signifie pas que la Russie ne continue pas à participer, cahin caha,… Lire la suite »
Infauxretif.
” “L’Ukraine est un pays tout aussi corrompu que la Russie”
Faux, “
Absolument. C’est en tout cas ce qu’affirment en choeur Andrïï Iermak, Timour Minditch et Guerman Galouchtchenko 😊 😇
https://www.huffingtonpost.fr/international/article/ukraine-zelensky-perd-a-nouveau-un-tres-proche-collaborateur-eclabousse-par-un-scandale-de-corruption_257655.html
https://www.huffingtonpost.fr/international/article/en-ukraine-un-scandale-de-corruption-eclaboussant-un-proche-de-zelensky-seme-la-pagaille_257084.html
😋
Lemec Dici “alors que deux pays de l’Est se foutent sur la tronche pour des bouts de campagne je pense que ça doit être le dernier des soucis de beaucoup de gens.” AMHA, tu ne comprends rien à ce qui se passe actuellement en Europe, avec ce comportement guerrier tenu par Poutine et ses séides qui n’ont pour seul objectif que celui, de mettre la main sur l’Ukraine et ensuite sur les ex républiques soviétiques (la Biélorussie, la Géorgie, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie…). Histoire de rétablir la toute puissante URSS de l’après-guerre 39 – 45. … Lire la suite »
“AMHA, tu ne comprends rien à ce qui se passe actuellement en Europe, avec ce comportement guerrier tenu par Poutine et ses séides qui n’ont pour seul objectif que celui, de mettre la main sur l’Ukraine et ensuite sur les ex républiques soviétiques (la Biélorussie, la Géorgie, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie…).” Il comprend mais en a strictement rien à foutre du Monde exceptée la Caldoniepeupléedunebandedecons, pour la bonne raison bien comprise (par lui, tout du moins) que c’est un mec d’ici. Un genre d’Electron, en quelque sorte, mais encore plus restrictif… Encore qu’on en connait… Lire la suite »
Infomigratif.
“Encore qu’on en connait 2 qui se limitent carrément à défendre Ouémo.”
Encore qu’on en connait 1 qui a détalé d’un bout à l’autre de l’axe indopacifique pour finir par se placer sous la protection de Nounours de St Jacques. 😇 😂
“Encore qu’on en connait 1 qui a détalé” Tu pratiques la méthode Si Crado : inventer de toutes pièces une vie-bis à certains interlocuteurs (Minie, LedZep, Inforétif), tenter d’y faire croire et finir peut-être (?) par y croire toi-même, pauvre crétin que tu es pour en arriver même à supporter l’infâme déchet humain qu’est Si Crado ! Sinon, t’as rien à dire sur “MLP et Mélenchon, dirigeants irresponsables qui ont toujours mangé dans la main du Kremlin et courbé l’échine devant les dictateurs”. “Ils n’ont jamais caché leur fascination pour les dirigeants autoritaires et belliqueux”, Les poutinolâtres Alik et Electron… Lire la suite »
ben tu vois, quand tu traites des gens de “poutinolâtres” ou de “traitres à sa patrie”, tu leur inventes aussi une vie…
“ben tu vois, quand tu traites des gens de “poutinolâtres” ou de “traitres à sa patrie”, tu leur inventes aussi une vie…”
Mais oui, c’est ça, t’as encore tout compris.
Le Pen et Mélenchon, publiquement choqués par les agissements criminels de Poutine et réclamant la libération du Donbass et de la Crimée à grands cris !…
Inforétif : “ Le Pen et Mélenchon, publiquement choqués par les agissements criminels de Poutine et réclamant la libération du Donbass et de la Crimée à grands cris !…”
Comprends pas.
La Crimée et la partie “historique” des républiques du Donbass sont libérées depuis 2014.
Pour le reste de la république de Donetsk, ce n’est qu’une question de temps.
Inforétif : “Le Pen … réclamant la libération du Donbass et de la Crimée”
En tout cas, à en croire son filleul, ce serait sans le 2ème REP :
https://www.cnews.fr/emission/2025-11-30/lheure-des-pros-2-week-end-emission-du-30112025-1778532
Il est bien, ce petit, il gagne à être connu.
Et lui, au moins, il ne promet pas la lune …
https://www.youtube.com/watch?v=iNCJI6fq_ek
Alik “Il est bien, ce petit, il gagne à être connu.” Et une de plus, de créature médiatique, œuvre de Vincent (l’un des principaux actionnaire de Canal+) l’ennemi juré d’Emmanuel (qui en fut aussi, une autre). Ensuite, nous avons eu droit à Zemmour (porté disparu désormais, du microcosme politique français) puis à la Marine (ressuscitée mais bientôt embastillée). Et maintenant ce médiocre personnage ! Douce France ! https://www.lecanardenchaine.fr/politique/510-avec-jordan-le-rn-veut-faire-entrer-un-recale-a-matignon “Derrière ses airs de jeune premier, Jordan Bardella est plutôt du genre dernier de la classe. A la Sorbonne, il n’a validé que sa première année de licence de géographie, malgré trois… Lire la suite »
LedZep : “Et maintenant ce médiocre personnage !”
Et comme d’hab, de suite l’attaque au dessous de la ceinture.
Sur le fond, tu nous fais une étude comparée des programmes des candidats Macron en 2017 et Bardella en 2024 ?
On pourrait se demander : qui trouve grâce à ses yeux ?
Electron : “On pourrait se demander : qui trouve grâce à ses yeux ?” [LedZep]
Peut-être Vincent Hervouet :
https://www.europe1.fr/emissions/vincent-hervouet-vous-parle-international/le-dernier-ami-de-zelensky-873365
Pouet-pouet (celle-là, je préfère la préempter)
Alik.
“Pouet-pouet”.
Certainement un des plus beaux titres de la Chanson Française 🤗
https://youtu.be/dXoddlO3q48?si=mm9FJL0J2Z0B76ZI
Bonsoir XYY,
avais-tu entendu parler de Fred Harrison ?
https://www.youtube.com/watch?v=YNrRu8qVXHM
EL. “avais-tu entendu parler de Fred Harrison ?“ Non. Et je fais toujours montre de circonspection devant les prophètes ( de la finance en l’occurrence ). De toutes façons c’est du 50/50, soit ils ont raison, soit ils se plantent. Pour la finance, je préfère lire des mecs qui mettent “la main dans le cambouis” genre Warren Buffet. La seule prophétie “eschatologique” à laquelle j’ai été directement confronté, ça a été le ” bug de l’an 2000 “.😂. Le directeur de l’établissement où je sévissais, n’arrêtait pas de me tanner à ce sujet. Et je lui répondais : “Boss, ça… Lire la suite »
LedZep.
“lecanardenchaine“.
Je croyais que ni Le Canard Enchainé ni Le Chien Bleu ne faisaient partie de vos titres de référence. Mais, bon.
C’est très français, cette inclination pour le diplôme, Moi-même je place sur un piédestal familial mes frangins diplômés de l’N7, des Beaux-Arts, de l’ENSAE et des Ponts: avec ma banale maîtrise, je suis dans le médian inférieur des diplômés de ma fratrie ( vous-même en etiez resté au deug je crois).
Et pourtant même en France, les contre-exemples ne manquent pas: Francois Pinault, Xavier Niel, Serge Papin, etc.
Autre contre-exemple, mais dans l’autre sens: Bruno Mégret.
Le Chien Bleu, sous sa couverture de journal satirique a été par le passé un vrai journal d’investigations qui faisait des révélations et proposait des analyses pertinentes.
XYY “Je croyais que ni Le Canard Enchainé ni Le Chien Bleu ne faisaient partie de vos titres de référence. Mais, bon.” Mais que vient faire “Le Chien Bleu” dans l’histoire ? Dans mon commentaire, auquel tu fais allusion, je citais un article du Canard Enchaîné qui ironise sur la formation scolaire de Jordan Bardella. Mis à part ce fait, je soulignais surtout l’inconsistence de cette nouvelle créature du Paf qui, de part la simple volonté du tycoon vincent Bolloré, fait régulièrement la une de C NEWS et des autres médias qu’il détient. Comme il en fut, pour Eric Zemmour… Lire la suite »
LedZep : “… j’ai eu la chance de terminer ma carrière professionelle dans l’une des principales banques françaises, présente sur la Place locale, en tant que cadre.” Il est certain que cela me rassurerait si j’étais client de cette banque, du moins quant à la rigueur avec laquelle mon compte serait géré au niveau de l’informatique. Néanmoins, cela ne te donne, pas plus qu’à moi d’ailleurs, la formation nécessaire pour juger de la pertinence des informations politiques, techniques, et administratives extrêmement variées et complexes qui font la vie d’un pays, même si sa population (décroissante) ne doit guère dépasser au… Lire la suite »
Alik “Il est certain que cela me rassurerait si j’étais client de cette banque, du moins quant à la rigueur avec laquelle mon compte serait géré au niveau de l’informatique.” PECQMC, l’an prochain cela fera 10 ans que j’ai quitté cette entreprise pour prendre, une retraite bien méritée (?). Et ma foi, en tant que client désormais, je n’ai aucun reproche à lui faire quant à la qualité, de la gestion de son système d’information. “Néanmoins, cela ne te donne, pas plus qu’à moi d’ailleurs, la formation nécessaire pour juger de la pertinence des informations politiques, techniques, et administratives extrêmement… Lire la suite »
LedZep.
“…ne faisait que rappeler à l’internaute @XYY . . mon parcours scolaire et professionnel qu’il avait évoqué, sans plus.”
Vous brodez quelque peu…😊
Il n’était question que de cursus universitaire (confer celui de Bardella)
AMHA, pour être Chef d’Etat, il vaut mieux avoir une bonne connaissance des mécanismes économiques et sociaux qui, ne s’apprenent pas que dans la rue ou dans un quelconque séminaire. Comme Macron ? T’as vu le résultat ? Comme Hollande ? Comme tous ceux qui ont tenu les rênes du pouvoir ces 30 derniers années ? ça s’appelle “les élites”, mon cher ledzep, ces gens pour qui tu as toujours voté tout en méprisant les vilains “populistes”… tiens, du coup, tout comme l’autre burne de Minie, tu passes ton temps à nous les gonfler avec tes omélies “MLP elle a… Lire la suite »
EL “Comme Macron ? T’as vu le résultat ? Comme Hollande ? Comme tous ceux qui ont tenu les rênes du pouvoir ces 30 derniers années ?” Trouve un seul de mes commentaires dans lequel je couvre d’éloges Emmanuel Macron, François Hollande. Mes critiques, portées en ce moment envers Pascal Praud ne concernent que son comportement hors-sol qui ne reflète en aucun cas, selon moi, celui d’un journalisme de qualité. “ça s’appelle “les élites”, mon cher ledzep, ces gens pour qui tu as toujours voté tout en méprisant les vilains “populistes”…” ??? Là encore, trouve un seul de mes commentaires… Lire la suite »
Tu te défausses habilement. -Peu importe, Hollande, Macron, Sarkozy, tu as abondamment vilipendé les politiciens “populistes” pour montrer que tu as forcément voté pour tous ces candidats du système -et depuis des années tu vilipendes MLP qui n’est pas dépositaire du bilan, dette, insécurité, etc. C’est celui de ces messieurs. -mais par contre tu es de ceux qui nous ont en fait toute une montagne de cette affaire d’emploi d’argent, pour le peu que cela ait affecté la France, par contre, si une affaire de quelques millions d’euros sollicite autant ta sensibilité et tes neurones, on se demande bien pourquoi… Lire la suite »
Pour être chef d’état c’est surtout bien d’avoir une colonne vertébrale, ce qui n’est pas le cas de François “Flamby” Hollande, et certainement pas celui de l’autre pédéraste cocaïnomane laquais des Rothschild…
Macron n’a aucune colonne vertébrale idéologique, c’est Bruno Lemaire qui le disait. Puis plus tard il a accepté d’être son ministre de l’économie.
Enfin si, Macron a une petite colonne vertébrale, celle de diluer la France dans une chose européenne supranationale, un vrai “traître à sa patrie” comme dirait Inforétif.
Macron est un laquais, suce ma pine Infomerdif. (SMPI)😠
Electron : “Enfin si, Macron a une petite colonne vertébrale …”
Et en plus, il est le premier président à bénéficier d’un exosquelette.
On aperçoit vaguement le prototype sous la chemise blanche qu’il exhibait à Saint Martin et qu’a relayée Rocky.
Il est probable que c’est un modèle de nouvelle génération qui lui permet d’embrasser aussi fréquemment et aussi frénétiquement Volodymyr.
Pour sa prise de fonction en 2027 en tant que président de l’Europe, il disposera sûrement d’un modèle encore plus perfectionné.
“embrasser aussi fréquemment et aussi frénétiquement Volodymyr”
Et ça peut rapporter gros, l’Ukraine envisageant avec l’aide de l’OTAN de conquérir, annexer et civiliser la Russie par dépoutinisation accélérée.
L’OTAN met en garde la Russie : l’alliance pourrait envisager des frappes préventives contre Moscou
Inforétif => MSN => The Daily Digest : “L’OTAN met en garde la Russie : l’alliance pourrait envisager des frappes préventives contre Moscou”
Du délire !
Je suppose qu’i s’agira de lancer de boules puantes contres les grilles des ambassades …
“lancer de boules puantes contres les grilles des ambassades …”
Après essais préalables sur la case de Ouémo repérée comme nids de kollabos poutinolâtres par les RG, prévois des pinces à linge pour toi et des bâches en cuir épais pour tes bassines à guppies pas encore bouffés par les moustiques génération 2025 qui y pullulent.
Sinon, à propos des russonazis que l’OTAN, avec l’aide de Zelinsky l’informé sur tout, Ouémo compris, va déquiller jusqu’en haut du mât:
Ukraine : la course aux atrocités du groupe néonazi russe Rusich
“Du délire !” Ben voyons ! A côté des menaces nucléaires répétitives de Poutine dès qu’il se sent trop affaibli, c’est du pipi de chat. Et la délicieuse VDL fait tt son possible pour lui casser encore plus le moral, je l’aime; tu l’aimes aussi, Alikollabo ? Ursula von der Leyen ne lâche pas sur le prêt de réparations à l’Ukraine face à l’opposition de la Belgique ““Le plan de paix initial en 28 points, rédigé secrètement par des fonctionnaires américains et russes sans la participation de l’Europe, contenait une idée très controversée: utiliser les actifs souverains [détenus dans une… Lire la suite »
à Alik, suite…
“Et la délicieuse VDL fait tt son possible pour lui casser encore plus le moral, je l’aime;
tu l’aimes aussi, Alikollabo ?”
Et ses sourires en pensant au pic à glace dans le crâne de Poutine bientôt, tu les aimes ?
https://youtu.be/o5yR4TYne-Y?t=27
Avoue que ça a une autre gueule que le “suce ma pine” de ton connard de Si Crado !
Inforétif : “Et ses sourires [VDL] en pensant au pic à glace dans le crâne de Poutine bientôt, tu les aimes ?”
Et comme, à t’en croire, c’est pratiquement fait, elle a envoyé son “soutier” préparer la suite :
https://www.youtube.com/watch?v=F-550pBa_8k
Sur le sujet, petite QCM :
Quel est l’auteur de la partition que jouait l’ochestre ?
A – Mendelssohn
B – Chopin
C – Degeyter
Alik.
“QCM“.
Après avoir longuement hésité entre une marche nuptiale, une marche funèbre et une marche révolutionnaire, je me suis résolu à tricher en allant voir.
Ben ça n’était aucune des 3,.les membres de l’orchestre s’étaient gourés d’instruments, quant au tambour-major, il avait oublié sa canne …
XYY : “je me suis résolu à tricher en allant voir“.
Mais le but de la visite était-il déjà précisé, et avec cet humour corrosif dans le titre si caractéristique de France24 :
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20251204-ukraine-commerce-macron-entre-dans-le-vif-du-sujet-avec-xi-%C3%A0-p%C3%A9kin
En dehors du sourire que peut susciter ce titre, le texte ne laisse aucun doute sur l’importance qu’accorde l’Empire du Milieu à la diplomatie française.
“aucun doute sur l’importance qu’accorde l’Empire du Milieu à la diplomatie française.”
J’imagine la rigolade des Chinois face à la présidente Poissonnière première ou au bébé Bardella si le RN arrive au pouvoir…
Tu planes stratosphériquement, mon pauvre Alikollabo.
Inforétif : “J’imagine la rigolade des Chinois face à la présidente Poissonnière première ou au bébé Bardella si le RN arrive au pouvoir…” Une chose me parait certaine, c’est que les hauts dignitaires chinois, lorsqu’ils reçoivent leurs homologues, qu’ils représentent des confettis du Pacifique ou des poids-lourds des B.R.I.C.S., le font avec dignité et décorum. Faut-il que notre président, qui n’avait rien à offrir, ait agacé Xi Dada pour que celui-ci, pardonne-moi l’expression, l’ait envoyé chier, ce dont rend compte en termes édulcorés France24. “”La Chine soutient tous les efforts pour la paix” et “continuera à jouer un rôle constructif… Lire la suite »
Inforétif en est réduit à s’accrocher à ses croyances, ses supputations, son émotionnel pour se cacher le réel qu’il ne veut pas admettre : Macron s’est couché devant Tebboune.
Mais ça, chuutttt…. faut pas le dire.
Et il s’imagine peut-être que Xi Jing Ping n’était pas au courant…
Alik “Une chose me parait certaine, c’est que les hauts dignitaires chinois, lorsqu’ils reçoivent leurs homologues, qu’ils représentent des confettis du Pacifique…”.
Confettis du Pacifique (entre autres dans notre Monde globalisé, multipolaire, poutinien) qui, pour une certaine nation soit, l’Ensemble Français, lui permet d’être en haut de l’affiche loin devant la Chine de Xi Dada (*).
“Zhìzhě zhǐzhe yuèliàng, yúzhě què dīng zhuó shǒuzhǐ kàn.”
https://www.youtube.com/shorts/fvJiNAEChFU?feature=share
(*)
Tu t’es vu qd tu persifles, tu planes stratosphériquement, mon pauvre Alikollabo.
Inforétif : “Tu t’es vu qd tu persifles, tu planes stratosphériquement, mon pauvre Alikollabo.”
Tu t’es vu quand tu n’as plus rien à dire, tu patauges lamentablement, Info-au-point-mort (mais tu n’auras pas ma compassion).
Infofétide, le mec qui te ressert en boucle les plats froids avariés et le prêt-à-penser de la bienpensance.
Bon, après, on s’y accroche et on argumente comme on peut.
“quand tu n’as plus rien à dire” Sacré Alik, bien au contraire, il y a tant à dire ! Info BFMTV. Jordan Bardella visé par une plainte déposée au PNF pour favoritisme et détournement de fonds publics “La révélation de ces faits concernant l’utilisation, par les élus du Rassemblement national, des fonds issus du Parlement européen doit nécessairement être remise dans le contexte de la condamnation récente du parti politique et de vingt-cinq de ses cadres et collaborateurs pour détournement de fonds publics dans l’affaire des assistants parlementaires.” Et hop, c’est reparti pour un tour ! “”Non content d’être soutenu par… Lire la suite »
Inforétif : Info BFMTV : “Jordan Bardella visé par une plainte déposée au PNF …”
Faut quand même laisser quelques jours à l’enquête et au processus judiciaire …
Il est peut-être innocent.
Mais visiblement, les hyènes salivent déjà …
“Il est peut-être innocent.”
Si fait.
Comme l’agneau(le) qui vient de naître.
Alik “Mais visiblement, les hyènes salivent déjà … [Bardella cloué au pilori]”
Je ne sais pas s’il est (ou fut) possible de voir la queue d’un seul hyène, dans les campagnes de notre douce France. Ils fut un temps néanmoins où, les Canis lupus furent bien présents et en nombre.
Musique : Serge https://youtu.be/K9VFqvGRhNs
LedZep : “Ils fut un temps néanmoins où, les Canis lupus furent bien présents et en nombre.”
Mais ils sont toujours là :
https://www.aspas-nature.org/etude-une-premiere-meute-de-loups-noirs-confirmee-en-france/
Et l’odeur de décomposition que dégagent (jusqu’au fond des P.O.) les bobos gauchos depuis l’élection de Trump et qui devient plus forte avec l’approche de la fin du mandat de Macron devrait encore renforcer l’attrait olfactif.
Alik “Et l’odeur de décomposition que dégagent (jusqu’au fond des P.O.) les bobos gauchos depuis l’élection de Trump...”
Donald, le vieux cochon sénile qui s’en dédit !
“ l’odeur de décomposition que dégagent (jusqu’au fond des P.O.) les bobos gauchos depuis l’élection de Trump” N’avais-tu pas écrit que tu cesserais ton battage anti occidental en général et anti UE / français dès que Poutine nous attaquerait ? Dont acte : si les démocrates américains ne réagissent pas pour déclencher toutes procédures d’empeachment rapidement à l’encontre de Trump pour haute trahison, une alliance objective USA-Russie va aboutir rapidement à la fin des sanctions des premiers contre la seconde, ainsi qu’à la fin du peu qui reste des aides américaines à l’Ukraine, c’est visible sur l’actuelle gueule réjouie de ton… Lire la suite »
à Lilik, suite :
Garry Kasparov révèle le projet de Poutine contre l’Europe
Inforétif, je cite un extrait du lien que tu as donné :
De même, Kasparov estime que l’Union européenne, conçue pour la paix et la prospérité, n’est pas préparée à une confrontation prolongée : il rappelle que sa structure politique « était impuissante à riposter » lorsque la menace est apparue, pointant la difficulté de l’UE à se projeter comme puissance stratégique. Cette observation renforce l’idée que la Russie viserait à amplifier les fissures internes de l’Union, en misant sur ses lenteurs et son absence d’outils de coercition.
Kasparov confirme ce que j’ai écrit l’autre jour : l’Europe n’est qu’une puissance verbale.
Inforétif => MSN => Enderi : “Garry Kasparov révèle le projet de Poutine contre l’Europe”
Les joueurs d’échecs, c’est comme les chanteurs, ils gagneraient à rester dans leur domaine de compétence :
https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/si-ca-arrivait-on-irait-en-suisse-alain-souchon-ne-croit-pas-que-les-francais-soient-assez-cons-pour-elire-le-rn-en-2027_AN-202511140432.html
Et toi, tu irais en Andorre ?
Inforétif,
Une fois de plus, l’Europe n’a pas besoin de la Russie pour se détruire.
https://www.youtube.com/watch?v=mbaeE5dBZEg
Mais bon, expliquer à un type qui gobe joyeusement les yeux fermés…
Inforétif : “N’avais-tu pas écrit que tu cesserais ton battage anti occidental en général et anti UE / français dès que Poutine nous attaquerait ?” J’ai du mal à traduire en termes clairs tes divagations. Rocky (l’innocent) pense que c’est lorsque tu as bu et qu’il peut t’aider. Je crois pour ma part que tes derniers neurones ont barré après ton dernier rappel, et que ton cas relève maintenant de la psychiatrie. Si j’ai bien compris, tu m’accuses d’être critique vis-à-vis du rôle de l’OTAN en général, des USA et de la France en particulier, dans les événements politico-militaires qui… Lire la suite »
“que tes exagérations et tes insultes constantes à l’égard de la Russie et de son président me poussaient à exprimer.”
Il a déteint sur toi, ton demi-dieu tyrannique : les exagérations et les insultes encerclantes (dixit Electron) de l’OTAN et de l’UE ont poussé Poutine à s’exprimer en Ukraine par le sabre et le goupillon.
Ou l’art du retournement des rôles entre l’agresseur et l’agressé.
Quant à ta cécité légendaire depuis le covid : “à ce jour Vladimir ne nous a pas attaqué“ …
Inforétif : “Ou l’art du retournement des rôles entre l’agresseur et l’agressé.”
Juste une question : qui bombardait les civils de la ville de Donetsk à partir de sa banlieue ouest jusqu’à ce que Vladimir siffle la fin de la récré en février 2022 ?
“qui bombardait les civils de la ville de Donetsk à partir de sa banlieue ouest jusqu’à ce que Vladimir siffle la fin de la récré en février 2022 ?”
Encore les Sudètes d’Hitler (ta gueule Si Crado !).
A force de répéter du Poutine pur jus, t’as (presque) fini par y croire : tu es lamentable, Alikollabo.
Inforétif : “Encore les Sudètes d’Hitler (ta gueule Si Crado !).” Petit détail (mais je ne suis pas surpris qu’il t’ait échappé, tu ignorais bien que les USA étaient en paix avec l’Allemagne et le Japon jusqu’en décembre 1941) : les Sudètes, de Bohême et de Moravie n’étaient pas en état de sécession armée ni. assiégés dans leurs capitales par l’armée tchécoslovaque et son artillerie lorsque l’armée allemande est venue les libérer d’un joug purement administratif. Même sur la croisade d’Aragon, je te suggère de me demander conseil, pour éviter d’écrire des âneries si l’envie t’en prenait. Si tu n’oses… Lire la suite »
“ tu ignorais bien que les USA étaient en paix avec l’Allemagne et le Japon jusqu’en décembre 1941″ Ah bon, sur quel indice bases-tu ce pur mensonge, mon Lilik ? Qui (à part ce connard de Si Crado et sa guerre de 1914-1914) ignore que c’est l’attaque japonaise de Pearl Harbour qui a sorti les USA de leur torpeur, avec répercussion sur l’Allemagne de Hitler (TGSC !), le couple Allemagne-Italie ayant créé l’« Axe Rome-Berlin-Tokyo » dés 1940. “lorsque l’armée allemande est venue les libérer [les Allemands de la Région tchéque appelée les Sudètes] Mais bordel de Zeus, v’la t’y pas que… Lire la suite »
correction : tu estimeS
à Alik, suite
https://www.revueconflits.com/pourquoi-la-guerre-du-donbass-na-jamais-ete-civile/
“La guerre en Ukraine débute en 2014 avec les opérations de la Russie en Crimée et au Donbass. Au Donbass, Moscou orchestre une rébellion contre Kiev, fournissant instructeurs militaires et armement pour défendre les séparatistes. “
Ce qu’on appelle une attaque sous faux drapeau. Mais pour ma part, j‘aurais mis défendre entre guillemets.
Dommage qu’on n’accède qu’au début de l’article.
Inforétif : “Dommage qu’on n’accède qu’au début de l’article.”
Tout dépend du nombre de neurones encore en service, donc du nombre d’injections pfizeriennes :
https://sceeus.se/en/publications/why-the-donbas-war-was-never-civil/
Ceci étant, ce rapport à charge est incomplet et non-convaincant.
À la limite Wikipedia est meilleur :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Donbass
🐾
Inforétif : ““ tu ignorais bien que les USA étaient en paix avec l’Allemagne et le Japon jusqu’en décembre 1941″ Ah bon, sur quel indice bases-tu ce pur mensonge, mon Lilik ?” Sur notre échange de commentaires du 29/11 dont je te mets un résumé en annexe. “Qui (à part ce connard de Si Crado et sa guerre de 1914-1914) ignore que c’est l’attaque japonaise de Pearl Harbour qui a sorti les USA de leur torpeur, avec répercussion sur l’Allemagne de Hitler …” Toi, apparemment, puisque tu “oubliais” la neutralité des USA en 1939-40-41. “Mais bordel de Zeus, v’la t’y… Lire la suite »
““On imagine notre sort dans les années 1940 si les décideurs US avaient tenu ton “raisonnement” !” Pour rappel – les années 1940 commencent le 01/01/1940 – l’invasion de la France commence le 10/05/1940 – l’armistice est signé le 22/06/1940 – l’Allemagne déclare la guerre aux USA le 11/12/1941″ Alik, “dans les années 1940“, ne signifie pas que l’événement qui s’y est déroulé a commencé le 1° janvier 40 et a duré jusqu’au 31 décembre 1949 ! Par exemple la danse populaire appelée “Victory Polka “ a pu être créée en 1943 (au pif …) et abandonnée en 1947 (re-au… Lire la suite »
Suce ma pine Infomerdif (SMPI), je te bifle le museau, moralement mais intensément.
Inforétif : “Comme l’est la datation “dans les années 1940” de la participation des armées américaines à la 2° guerre mondiale contre Hitler” Comme le fut “dans les années 1940” le rôle de spectateur intéressé de la chute des empires français et britannique (en 1940 et 1941) que tinrent les Américains acceptant toutefois de vendre à crédit de l’armement aux Britanniques. Inforétif, je reste atterré de te voir systématiquement adopter et utiliser les pires “trucs” pour te sortir des ornières dans lesquelles tu t’envases pour tenter de dénigrer tes interlocuteurs. Je t’ai connu meilleur (avant le Covid). “la fameuse “accrobranche”,… Lire la suite »
“ spectateur intéressé de la chute des empires français et britannique (en 1940 et 1941) que tinrent les Américains” Si ce n’était que pour que ce double empire s’unifie à terme en prenant le nom de Reich, je ne vois pas en quoi ça pouvait intéresser le gouvernement américain, bien au contraire. ““tes diverses et avariées approbations du sinistre déglingué Si Crado.“ Où ça, quand ça ?” La dernière fois c’était y a 5 mn… Alors qu’au final on ne comprend même pas si le duo Si Crado – Oups est contre ou pour l'”indépendance” de la NC, tant ils sont… Lire la suite »
La question n’est pas de savoir si on est “pour” ou “contre” l’indépendance, puisque l’indépendance arrivera tôt ou tard, pauvre con.
La question c’est “Comment faire pour que ça ne finisse pas dans un bain de sang?”
Question subsidiaire: “Comment ne pas devenir un pays du tiers monde suite à l’indépendance?”
Continue à te branler en pensant à Zelensky, va… nous on a d’autres soucis. (Pauvre con, j’ai failli oublier)
Ignarétif.
“je ne vois pas en quoi ça pouvait intéresser le gouvernement américain, bien au contraire“.
Il suffit de se reporter à un ouvrage que j’avais déjà mentionné dans un post: “As He Saw It” (Elliott Roosevelt).
Et plus particulièrement à la soirée du vendredi 22 janvier 1943 (Conférence de Casablanca).
Évidemment, c’est bien trop chronophage à votre gout. 😊
Un conseil: restez dans un domaine où vous etes compétent – à savoir l’accrobranche -, ne tentez même pas les glissements spatio-temporels 😂😂😂
Infoplexif.
J’allais oublier:
“Y a que la vérité qui fâche”
Comme une fuite éperdue d’une Caldoniepeupléedunebandedecons après une pluie d’Obut ?
😂 😂 😂
“La caractérisation me parait tellement satisfaisante, que je l’ait faite mienne,”
T’as donc tjrs pas perçu la fourberie et la superficialité cynique du sinistre (habillé pour l’hiver, me dira même pas merci, l’ingrat) personnage caché sous XYY.
Dautre part :
Invitée de Sept à Huit, Sigourney Weaver (Avatar) dénonce « une Amérique hors de contrôle »
Infovêtif.
“(habillé pour l’hiver, me dira même pas merci, l’ingrat)”
Même pas: je vous signale qu’ici on se dirige en pente douce vers l’été 🤫 😁 ( lundi 22 décembre 2025 – samedi 21 mars 2026 ).
Que voulez vous que je fasse de vos “la fourberie et la superficialité cynique du sinistre“, sinon les suspendre sur cintres à côté de mes marcels par vous offerts antérieurement ( tordu, sounois, cynique ). 🤗
De votre côté, avez vous pensé à faire provision de sel et de lait de chamelle pour l’hiver ? 😂😂😂
“”les insultes mensongères dont tu m’abreuves (“traître, collabo”)…”
Les temps vont devenir durs pour les dits collabos, en UE ça rigole plus.
Armement : l’Allemagne valide un programme d’achats sans précédent
Je t’emmerde Infomerdif, suce ma pine, et va te faire enculer avec ta (ridicule) guerre de 1914/1914… Tu en es donc réduit à ça, pauvre branque?
Suce ma pine Infomerdif. 😎(SMPI)
Shaaaabat shalom les gens.😘
Bon, toujours dans un souci de proactivité, en anticipant la prochaine connerie de Monconrétif-le-bien-nommé:
SUCE MA PINE INFOROUQUIN! (SMPI)
Alik.
“France24.
Le président chinois Xi Jinping et le président français Emmanuel Macron au Palais du Peuple à Pékin, le 4 décembre 2025. “
Là, il est fortement probable que l’auteur de la partition soit un certain Wei Qun…
https://youtu.be/PDNCwPrZphY?si=uI6BVKJm9OwVr-qV
“Emmanuel Macron presse Xi Jinping“. Réponse
Compte-rendu accueil Manu (suite)
Plus complet, celui de CGTN :
https://francais.cgtn.com/news/2025-12-04/1996521465719336962/index.html
Et en plus de Maman, Manu avait emmené son porte-coton (qui a eu droit au cours de 1ère année) :
https://francais.cgtn.com/news/2025-12-04/1996418919692546049/index.html
On touche le fond des discours lénifiants dont les Chinois ont le secret, quelles daubes !
Vla que notre patriote Lilik nous fait une respectite pro-tyran chinois à présent, manquait plus que ça …
Infosinif. “On touche le fond des discours lénifiants dont les Chinois ont le secret, quelles daubes !”. Totalement d’accord avec vous ! Un échantillon : “La France et la Chine maintiennent d’étroits échanges de haut niveau et travaillent toujours dans un cadre de confiance et de respect mutuels. La France attache un grand prix aux relations franco-chinoises, reste fidèle à la politique d’une seule Chine et souhaite continuer d’approfondir le partenariat global stratégique franco-chinois. La partie française se réjouit de la dynamique de l’économie chinoise qui poursuit l’ouverture et la coopération et apporte plus d’opportunités au monde. Elle souhaite travailler… Lire la suite »
“C’est Macron qu’a dit ça ? “
Pas tout le monde est capable d’un tel mimétisme camouflant en terrain ennemi, imagine la poissonnière d’Electron pataugeant poncivement comme le premier pékin venu sur le proverbe chinois de la ligne qu’il faut offrir au pauvre plutôt que du poisson…
“imagine, “imagine”, ça fait déjà deux fois aujourd’hui… arrête d’imaginer Inforétif, tiens en toi aux faits…. bon on sait, ils ne te plaisent pas toujours.
Electron Libre “imagine, “imagine”…
Et comment !
C’est fou ce que l’IA peut faire !
https://www.youtube.com/shorts/quOW9IrGKqE?feature=share
Infomimétif.
 ?v=20220314202411
?v=20220314202411
“Pas tout le monde est capable d’un tel mimétisme camouflant en terrain ennemi“.
J’avais presque oublié :
😂
…et pas seulement en terrain ennemi … 🤗
Manu aurait-il lu “Achever Clausewitz” 😊
Inforétif : “Vla que notre patriote Lilik nous fait une respectite pro-tyran chinois à présent, manquait plus que ça …”
Maigres résultats, à en croire France24, chaîne financée par le contribuable, donc labellisée :
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20251205-ce-qu-il-faut-retenir-de-la-visite-d-emmanuel-macron-en-chine
Une autre visite, non moins importante :
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20251205-sous-pressions-am%C3%A9ricaines-l-indien-modi-et-le-russe-poutine-resserrent-les-rangs
Sur cette dernière visite, le suivi en continu, de “India Today” :
https://www.indiatoday.in/india/story/vladimir-putin-india-visit-live-updates-india-today-world-exclusive-interview-russia-india-ties-pm-modi-meeting-in-delhi-trade-defence-talks-private-dinner-2830531-2025-12-04
L’indien Modi et le Russe Poutine …
Pas de blème, l’UE s’arme, je répète, l’UE s’arme…
La Croatie commande 18 canons Caesar à la France et va moderniser sa flotte d’avions Rafale
“l’UE s’arme”
Et quand il y a quelques années certains tiraient la sonnette d’alarme sur la baisse de notre capacité militaire et l’urgence d’investir massivement, tu étais d’accord avec eux ?
Non, bien sûr…
ça s’appelle de la “malhonnêteté intellectuelle” : tu t’attribues le mérite de soutenir quelque chose quand les circonstances t’y contraignent aujourd’hui, chose que tu ne soutenais pas quand d’autres l’ont fait par le passé … parce qu’ils voyaient plus loin que toi…avant toi.
Je devine d’avance le genre de conneries que tu vas répondre…
Voilà voilà… qu’est-ce que je disais? J’ai eu raison d’anticiper…
Donc, même motif même punition:
Suce ma pine, Infomerdif! (bis)
@Inforétif: Scuze mon con, j’ai oublié l’acronyme…
Donc: (SMPI*)
*(Suce ma pine Infomerdif)… non, je précise, au cas où… 😁😆
Du grand n’importe quoi ! mais ça doit te faire bander.
Tu la veux ta guerre, hein le boomer macroniste ?
“Tu la veux ta guerre, hein le boomer macroniste ?”
Ne sois pas si anxieux pour le respecté tsar pacifique préféré de ton alcoolyte, Poupoutine vient de dire qu’il est prêt, nucléairement prêt.
Je vais être assez occupé aujourd’hui, pas trop de temps pour des billevesées sur ce blog, donc, par volonté d’être proactif, je prends les devants:
🤩Suce ma pine, Infomerdif! (SMPI)😎
Ça va être une bonne journée…😁😆
“Tu la veux ta guerre, hein le boomer macroniste ?” Vu comment va l’économie russe sous les sanctions internationales et ses dépenses militaires, elle ne sera sans doute pas nécessaire (sauf très très haute trahison de Trump, toujours possible) Vente record d’or en Russie : Poutine cède 232 tonnes face à la crise économique “En novembre 2025, la Russie franchit un seuil symbolique : elle vend pour la première fois depuis des années une partie significative de ses réserves d’or, soit 232 tonnes, via le Fonds souverain russe et la Banque centrale. Cette décision survient alors que le pays fait… Lire la suite »
Inforétif : “Vu comment va l’économie russe sous les sanctions internationales et ses dépenses militaires, elle ne sera sans doute pas nécessaire” [la guerre ouverte]
Sur le long terme, tu as peut-être raison …
Oui mais voilà, au jour d’aujourd’hui :
https://www.youtube.com/watch?v=lGEOC6JguoA
“Oui mais voilà, au jour d’aujourd’hui : https://www.youtube.com/watch?v=lGEOC6JguoA“ Oui mais voilà, au jour d’aujourd’hui, dès le départ de ton commentaire : 1- comme dab tu parles de toute autre chose 2- comme dab, tu ne t’émeus pas des horreurs commises par “l’armée” ” russe” (cf dés le début de la vidéo -suis pas allé + loin dans cette merde- la mention d’un de ses crimes de guerre hier) 3- au contraire tu jubiles (cf ton “Oui mais voilà, au jour d’aujourd’hui” au lieu d’un plus neutre “cependant aujourd’hui”) 4- comme dab, hormis ce détail de l’histoire (qui d’ailleurs réjouit les… Lire la suite »
Inforétif : “comme dab, tu ne t’émeus pas des horreurs commises par “l’armée” ” russe” ” Peut-être parce qu’il arrive à l’armée ukrainienne d’en commettre aussi, qui sont également documentées. “suis pas allé + loin dans cette merde” Je peux comprendre qu’un visionnage attentif de ce genre de documents objectifs soit au-delà de tes capacités intellectuelles, lentement érodées par des injections répétées de produits expérimentaux. Toi, dès qu’on s’élève au dessus de la notion de “hachoir à viande” tu décroches “tu jubiles“ C’est ton interprétation, et ton explication de mon texte n’est pas forcément pertinente. ” tu fais la réclame du tyran.”… Lire la suite »
“Peut-être parce qu’il arrive à l’armée ukrainienne d’en commettre aussi, qui sont également documentées.”
Rengaine !
Encore une fois, l’Ukraine fait cette guerre contrainte et forcée, si Poutine évacue elle se termine dans la semaine.
L’armée ukrainienne pourrait découper sans anesthésie en rondelles des tueurs russes déguisés en militaires, ce serait à mes yeux parfaitement légitimes, ils n’ont qu’à pas être en Ukraine ! ! !
Tu es stupide ou stupide ? !
LedZep. “Mais que vient faire “Le Chien Bleu” dans l’histoire ?”. Simplement que, naguère, vous aviez écrit, en substance , que ni l’un ni l’autre n’était votre tasse de thé: je m’étonnais donc un peu que vous prissiez l’un de ces titres en référence. “AMHA, pour être Chef d’Etat, il vaut mieux avoir une bonne connaissance des mécanismes économiques et sociaux qui, ne s’apprenent pas que dans la rue ou dans un quelconque séminaire“. Nos trois derniers, y compris celui en fonction actuellement, n’ont pas fait montre d’une fine connaissance en la matière. De toutes façons, ils ont des soutiers… Lire la suite »
XYY “AMHA, pour être Chef d’Etat, il vaut mieux avoir une bonne connaissance des mécanismes économiques et sociaux qui, ne s’apprenent pas que dans la rue ou dans un quelconque séminaire“. Il eut été plus honnête, SJPMLP, de citer l’intégralité de mon propos et non un extrait qui vous arrange en fait, pour me contredire, pour me mettre en défaut (?). 😀 Ce qui est votre droit le plus absolu bien évidement. Encore faut-il, il me semble, le faire en respectant je le souligne une nouvelle fois, une certaine forme d’honnêteté intellectuelle. Dans ce commentaire (celui du 2 décembre 2025… Lire la suite »
LedZep : “Pour ce qui est des “soutiers” auxquels vous faites référence,… AMHA, il est donc préférable qu’un spécialiste, qu’un grand connaisseur “de la chose militaire” soit à la tête du ministère concerné.” Je n’aurais pas la prétention de me poser en exégète de la pensée (complexe) d’XYY, j’ai toutefois tendance à penser que les “soutiers” auxquels il fait référence ne sont pas les ministres (choisis en fonction de leur poids politique autant que de leurs “goûts”) mais plutôt les chefs d’administration quasi inamovibles qui font marcher la machine et préparent les dossiers. L’actuelle ministre des armées me parait être… Lire la suite »
Alik.
“j’ai toutefois tendance à penser que les “soutiers” auxquels il fait référence ne sont pas les ministres“.
La politesse m’oblige à dire : “Grillé”. Mais je n’en pense pas moins quant aux règles de préséance…. en termes plus fleuris que ceux de Murat cependant.
LedZep. “Il eut été plus honnête, SJPMLP, de citer l’intégralité de mon propos et non un extrait qui vous arrange en fait, pour me contredire, pour me mettre en défaut (?).“ Mais bien impoli de faire remarquer que votre première affirmation: “…pour être Chef d’Etat, il vaut mieux avoir une bonne connaissance des mécanismes économiques et sociaux qui, ne s’apprenent pas que dans la rue ou dans un quelconque séminaire.” était fortement atténuée sinon battue en brèche par l’affirmation qui suivait :” une bonne faculté d’adaptation, d’appréhension, de compréhension est indispensable tout autant si ce n’est, plus…”. Et celà, ça… Lire la suite »
XYY “Gov’t Mule…” ☮️ https://www.youtube.com/watch?v=yfogfQGO5vk&list=RDyfogfQGO5vk&start_radio=1 “jamais un militaire n’a été ministre de la Défense sous la Ve 😊 Mais ce ministre a des super soutiers (CEMA, DGA, SGA)”. Certes. Mais en cas de guerre avec Poutine et son armée de fortune [mais disposant quand même d’une chair à canon imposante, sans parler de son armement nucléaire tout aussi important], il serait préférable que ce ministre des Armées maîtrise, à minima, l’Art de la Guerre, comprenne à tout le moins, l’univers du Discours de ses super soutiers auxquels tu fais référence. Car en définitive ce sera lui, en collaboration (il faut… Lire la suite »
“ Il va bien y avoir un moment où, son entourage militaro-politico-affairiste-mafieux lui fera comprendre que ça suffit.”
T’es pas sympa pour Alik, tu veux le priver de ses vidéos jubilatoires sur la guerre triomphale de son dieu de la guerre Poutine (le champ de batailles bien massacrantes, crimes de guerre compris, la “libération” -sic !- de l’Ukraine comme si vous y êtiez …)
Inforétif : [@Led Zep] “T’es pas sympa pour Alik, tu veux le priver de ses vidéos jubilatoires sur la guerre triomphale”
Ben dis donc, vous avez l’art de vous astiquer en couronne, les duettistes.
Vous allez finir par priver Rocky de ses petits plaisirs.
XYY “Une constante cependant, jamais un militaire n’a été ministre de la Défense sous la Ve” Pierre Mesmer [ https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Messmer ] du 5 février 1960 – 22 juin 1969 “Seconde Guerre mondiale Mobilisé en 1939, il est sous-lieutenant au 12e régiment de tirailleurs sénégalais.” Sébastien Lecornu [ https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Lecornu ] Notre Premier Ministre actuel. “En 2017, il avait été nommé au grade de colonel au titre des spécialistes de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie nationale.” https://fr.wikipedia.org/wiki/Gendarmerie_nationale_(France)#:~:text=Depuis%202009%2C%20dans%20le%20cadre,et%20de%20la%20S%C3%A9curit%C3%A9%20civile. “Depuis 2009, dans le cadre d’un rapprochement entre les forces de sécurité de l’État, la Gendarmerie nationale, qui fait partie des Forces armées françaises,… Lire la suite »
Complément apporté à mon commentaire du 4 décembre 2025 14:12
XYY “Une constante cependant, jamais un militaire n’a été ministre de la Défense sous la Ve”
Sébastien Lecornu [ https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Lecornu %5D
Notre Premier Ministre actuel.
“En 2017, il avait été nommé au grade de colonel au titre des spécialistes de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie nationale.”
____________________________________________
“Il sera de tous les gouvernements suivants d’Emmanuel Macron, successivement secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, en 2018 ministre chargé des Collectivités territoriales, en 2020 ministre des Outre-mer, enfin ministre des Armées de 2022 à 2025.”
https://www.youtube.com/watch?v=jktJZ3umzNI&list=RDjktJZ3umzNI&start_radio=1
LedZep.
“Sébastien Lecornu“.
😊 Gros bémol.😑
Notre Premier Ministre n’a jamais fait son service militaire – et pour cause -…
et la gendarmerie nationale dépend du ministere de l’Intérieur…
Autre réserviste bien connu de la gendarmerie: Alexandre Benalla 😂 😇.
XYY : “Autre réserviste bien connu de la gendarmerie: Alexandre Benalla”
Oups, la sieste m’a été fatale.
B… de D… : “Depuis 2009, dans le cadre d’un rapprochement entre les forces de sécurité de l’État, la Gendarmerie nationale, qui fait partie des Forces armées françaises, est également rattachée au ministère de l’Intérieur aux côtés de la Police nationale et de la Sécurité civile.” Pas exclusivement rattachée ! Selon Le Larousse (qui fait autorité en la matière) : Egalement : “De façon égale ; au même degré, au même titre ; pareillement”. https://www.fncpg-catm.org/wp-content/uploads/2024/01/Le-PG-CATM-FEVRIER-2024.pdf “<< Fils unique, le jeune Lecornu, dès l’âge de 8 ans, accompagnait son grand-père maternel, ancien résistant << couvert de décorations », aux cérémonies commémoratives et aux… Lire la suite »
LedZep.
“Fin de ce débat à la con PECQMC“.
Fallait pas l’engager alors… 😊
Engagez vous, rengagez vous qu’ils disaient 😁.
nb: tout jeune, XYY rêvait d’être pilote de chasse, on sait ce qu’il en est advenu 😑😂
XYY “nb: tout jeune, XYY rêvait d’être pilote de chasse, on sait ce qu’il en est advenu”
Fallait revoir à la baisse ton ambition.
Il me semble que certains PNC, ont réussi à franchir l’étape supérieure dans le métier.
https://www.youtube.com/watch?v=JP3-qXxqbc4&list=RDJP3-qXxqbc4&start_radio=1
cadeau : https://youtu.be/hK3zUH4U4Cs?list=RDhK3zUH4U4Cs
LedZep.
“Fallait revoir à la baisse ton ambition“.
Ce que j’ai fait évidemment (*) 😊.
…ce qu’il en est advenu: à la place j’ai fait maîtrise d’informatique, nettement moins glamour et prestigieux 😁
(*) Il fut une époque ou Y3 limite Y4, ça ne pardonnait pas. De nos jours c’est rattrapable.
LedZep : [Sébastien Lecornu] “En 2017, il avait été nommé au grade de colonel au titre des spécialistes de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie nationale.”
Bah, la même année, Alexandre Benalla a été promu lieutenant-colonel de la même réserve :
https://www.franceinfo.fr/politique/emmanuel-macron/agression-d-un-manifestant-par-un-collaborateur-de-l-elysee/pourquoi-l-attribution-du-grade-de-lieutenant-colonel-a-alexandre-benalla-fait-polemique_2867945.html
Quoi ? de la corruption dans la Macronie ?
Voilà qui pourrait attrister Inforétif.
Il ne va pas y croire, la corruption ce n’est que chez les autres. Lui, il est dans le camp des vertueux.
“Quoi ? de la corruption dans la Macronie ?”
David Rachline, soupçonné de corruption, démissionne de la vice-présidence du Rassemblement national
“Celui que Marine Le Pen appelait encore “mon meilleur ami” pendant la campagne présidentielle de 2022, attend la décision qui doit être rendue le 27 janvier dans son procès pour prise illégale d’intérêt.”
Broutilles, là on est au niveau de l’Elysée.
Faut pas nier en faisant diversion.
Et puis arrête avec ta fixette sur le RN
BRANQUIHNO – LREM
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/03/01/pedocriminalite-un-ex-depute-suppleant-lrem-de-la-loire-condamne-a-un-an-de-prison-ferme_6163725_3224.html
LANG
https://www.francetvinfo.fr/politique/moralisation-de-la-vie-politique/detournement-de-frais-de-mandat-l-ex-deputee-lrem-anne-christine-lang-condamnee-a-60-000-euros-d-amende_5815967.html
CABARE
https://www.leparisien.fr/faits-divers/lex-depute-lrem-pierre-cabare-condamne-pour-agression-et-harcelement-sexuels-25-06-2024-MKBYZ6DQ3RHLJILGKYUDVMUMXM.php
AVIA
https://www.lepoint.fr/politique/l-ex-deputee-lrem-laetitia-avia-condamnee-pour-harcelement-moral-05-07-2023-2527549_20.php
PEYRAT
https://www.radiofrance.fr/franceinter/violences-conjugales-stanislas-guerini-prend-la-defense-de-jerome-peyrat-un-honnete-homme-6452340
Tout ça c’est dans le parti que tu soutiens, couillonrétif.
Que celui qui jette la première pierre nous montre qu’il n’a jamais voté pour un parti dont un membre n’a jamais été condamné pour malversations…
“Que celui qui jette la première pierre”
Tu parles de celui-là ? :
“Electron Libre
4 décembre 2025 18:04
Quoi ? de la corruption dans la Macronie ?”
Et intellectuellement malhonnête en plus, le scapinrétif !
Tu n’as cessé d’attaquer le RN sur ce site depuis des années pour des affaires de ceci ou de cela.
Où est ta justesse, quand on attaque toujours le même parti mais on attaque jamais les autres pour ces “affaires” ?
“Et puis arrête avec ta fixette sur le RN”
Poutine qui menace l’UE de missiles nucléaires, RN dans les mains de ce même dictateur et qui risque de parvenir au pouvoir suprême dans notre pays*** : c’est juste “une fixette” d’en causer, selon toi ? ! !
*** cf ton “Broutilles, là on est au niveau de l’Elysée.”
ça y est, il recommence, il me fait une rechute de sa poutinite,
il nous fait de sa vue simpliste de l’esprit une vérité gravée dans le marbre.
Tu devrais plutôt avoir peur de Macron, entre maintenant et mai 2027 il est capable de faire n’importe quoi pour entrer dans l’Histoire.
Ton petit héro se voit grand, normal il n’est plus rien à l’intérieur de la France. Moi, c’est ça qui m’inquiète.
“Tu devrais plutôt avoir peur de Macron, entre maintenant et mai 2027 il est capable de faire n’importe quoi pour entrer dans l’Histoire. Ton petit héro se voit grand, normal il n’est plus rien à l’intérieur de la France. Moi, c’est ça qui m’inquiète.” Tu devrais plutôt avoir peur dePoutine, entre maintenant et sa mort il est capable de faire n’importe quoi pour entrer dans l’Histoire. Ton petit héros Poutine se voit grand, normal il n’est plus rien à l’intérieur de la RUSSIE QU’UN DICTATEUR menaçant de missiles nucléaires sur l’UE à chaque instant Moi, c’est ça qui m’inquiète. Guerre… Lire la suite »
C’est tout ce que tu as trouvé ? on dirait un gosse dans une cours de récréation.
C’est Macron qui se rêve en tombeur de Poutine, pas l’inverse.
Macron a besoin de Poutine, le vaincre ce serait se grandir devant l’Histoire.
Poutine n’a pas besoin de cela, malgré tout ce qu’on peut lui reprocher.
Il est déjà entré dans l’Histoire, il sera le Président qui aura repris la Crimée.
Factuel, qu’on l’aime ou qu’on l’aime pas.
“Macron a besoin de Poutine, le vaincre ce serait se grandir devant l’Histoire.
Poutine n’a pas besoin de cela, malgré tout ce qu’on peut lui reprocher.
Il est déjà entré dans l’Histoire, il sera le Président qui aura repris la Crimée.”
Protoxyde d’azote ? Coup de folie gériatrique ?
LedZep, Minie, au secours ! Electron et Alik sont devenus fous !!!
Non mon gars, aucune folie gériatrique: ça s’appelle comprendre la réalité factuelle qui t’entoure, avec la tête froide, de manière objective, sans biais cognitif porté par l’émotionnel comme tu le fais depuis.
Maintenant, si tu en es réduit à appeler l’autre folle en espérant qu’elle te sortira des arguments rationnels, dans le sujet en lieu et place de ses élucubrations plates ou tordues qui partent tant tous les sens, comme d’hab… mais bon, tant qu’elle te sert la soupe comme on le fait avec un vieux en EHPAD, tu es content.
Bein alors Coconnet? On appelle Mémé Coconne et Pépé Concon au secours?😁😆
Tu es à court d’argument, tu appelles les deux diarrhéiques pour qu’ils viennent noyer le débat de leur logorrhée chiasseuse de narvalos tordus…
Tu ne te rends pas compte de ce que ça a de pathétique???😁😆😂
PS: SMPI!
“Gna gna gna gna gna gna gna gna gna” M’ouais, bon, rien d’intéressant….
Bon, allez, pour la route… ça mange pas de pain, hein? 😉
Suce ma pine, Infomerdif! (SMPI)
Voilà, ça c’est fait… ✅
😁😆
Inforétif : “RN dans les mains de ce même dictateur”
Prouve-le, c’est très facho d’extrême gauche ces affirmations rabâchées.
“Inforétif : “RN dans les mains de ce même dictateur” Prouve-le,” C’est d’l’humour, j’espère. Un certain Navalny, haï depuis par ta Marine, a étudié l’affaire de l’intérieur : https://www.liberation.fr/international/europe/alexei-navalny-accuse-le-rn-de-vente-dinfluence-politique-a-poutine-et-appelle-a-voter-macron-20220420_T55UBLPNVBETROFQ5APCDNU5YY/ “J’ai été choqué d’apprendre que le parti de MLP a obtenu un prêt de 9 millions d’euros auprès de la banque FRCB. Croyez-moi, il ne s’agit pas d’une simple «affaire douteuse. …. Cette banque est une agence de blanchiment d’argent bien connue qui a été créée à l’instigation de Poutine. Ça vous plairait si un politicien français obtenait un prêt auprès de la Cosa Nostra? Bon, ça, c’est pareil.” Selon la Croix,… Lire la suite »
Inforétif : “Un certain Navalny, haï depuis par ta Marine, a étudié l’affaire de l’intérieur” [prêt banque russe au FN] Feu Alexeï Navalny était un opposant déclaré à Poutine, il n’y a donc rien de surprenant à ce qu’il ait insisté sur le côté douteux de la banque ayant accordé le prêt, un milieu qu’en tant qu’avocat d’affaires il devait bien connaître. Ses soutiens politiques français de l’époque ne pouvaient qu’apprécier le coup de main. Sur le fond, j’ai la naïveté de croire Marine le Pen quand elle affirme qu’il lui était impossible de trouver des prêts corrects auprès de… Lire la suite »
Navalny, … on a tous vu la fourberie dont ont fait preuve les médias du service public à son égard.
Alik : “Le RN serait-il le seul en France à émettre des critiques quant à l’attitude de chef de guerre qu’assume Macron …”
Il existe aussi quelques vieux birbes, retirés de la politique, et recyclés sur les chaînes d’info :
C’est tout chaud :
https://www.cnews.fr/emission/2025-12-04/face-pierre-lellouche-emission-du-04122025-1780660
Tout à fait, mais Inforétif caricature, appauvrit le débat en forçant le passage pour une vision binaire simpliste des choses;
Macron gentil fait bien, RN méchant critique Macron.
Parce que comme tout bobo idiot il veut absolument enfermer les choses dans cette vision réductrice, biaisée, inexacte et du coup il refuse de voir et ne voit plus les choses dans toute leur dimension et leur subtilité.
Macron est largement critiqué, le RN, “l’extrême drouate” n’est qu’un parmi plusieurs qui le critiquent.
Electron : “Parce que comme tout bobo idiot il veut absolument enfermer les choses dans cette vision réductrice, …” [Inforétif] Parce que comme nombre de bobos gochaux idiots de notre intelligentsia, il a été foudroyé par l’élection de Donald Trump que rien dans les sources qui le biberonnent ne lui avait permis de simplement envisager. La terreur que lui inspire le compte à rebours des prochaines présidentielles le conduit à presque souhaiter une bonne guerre qui les reporterait à une date ultérieure. D’où les accusations, au mieux de défaitisme, au pire de traîtrise, lancées contre quiconque ne se range pas derrière… Lire la suite »
Inforétif : “Quoi ? de la corruption dans la Macronie ?” Il n’y a pas de corruption, juste un peu de naïveté. Qui aurait pu se douter de la noirceur de l’âme de Andriy Yermak : https://www.president.gov.ua/en/news/andrij-yermak-u-parizhi-proviv-zustrichi-dlya-rozvitku-ostan-95537 Extrait : “Head of the Presidential Office Andriy Yermak held meetings in Paris with the Minister for Europe and Foreign Affairs of France, Jean-Noël Barrot; the Diplomatic Adviser to the President of France, Emmanuel Bonne; the Chief of Military Staff of the Presidency of the Republic, Fabien Mandon; and the Advisers to the President of France, Xavier Chatel and Bertrand Buchwalter.” Que du… Lire la suite »
Alik “Bah, la même année, Alexandre Benalla a été promu lieutenant-colonel de la même réserve”
Et alors ?
https://youtu.be/x237AMc_46c
[Bardella] Et une de plus, de créature médiatique, œuvre de Vincent (l’un des principaux actionnaire de Canal+)
En voilà une belle connerie !
On ne savait pas que JB s’était fait un nom en étant vu que sur la télé de ton Bolloré tant haï.
EL “En voilà une belle connerie ! [J Bardella créature médiatique de Vincent]”
“On ne savait pas que JB s’était fait un nom en étant vu que sur la télé de ton Bolloré tant haï.”
SJPMLP, tu abuses quelque peu, du “On” rassembleur pour ne pas dire, ensembliste 😀 !
Tu penses sincèrement que si Bardella se contentait “de passer” sur “France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur” il aurait le même impact médiatique qu’il semble avoir, en faisaint la une H24, sur les médias audiovisuels de Vincent Bolloré ?
LedZep : “Tu penses sincèrement que si Bardella se contentait “de passer” sur “France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur” il aurait le même impact médiatique qu’il semble avoir, en faisaint la une H24, sur les médias audiovisuels de Vincent Bolloré ?”
H24, cela me parait quand même un peu excessif.
Mais tu m’inquiètes : voudrais-tu sous-entendre que Bardella est boycotté par le service public (et ses satellites) ?
Ouais, F3 Paca, c’est bien simpliste et réducteur comme argument…
Par ailleurs, il y a des personnes, des voix, des esprits critiques qui ne sont pas les bienvenus sur le service public.
Ceci n’a pas l’air de déranger nos démocrates poutinophobes moralisateurs…
Et sinon, comment expliquerais-tu que l’extrême gauche a une base électorale solide ?
C’est certainement pas Bolloré qui l’a faite, alors ce serait qui ?
Alik “Mais tu m’inquiètes : voudrais-tu sous-entendre que Bardella est boycotté par le service public (et ses satellites) ?”
Aucune idée.
Je regarde très peu les chaînes de télé généralistes ou non, d’information ou pas. Quant à C NEWS, LCI, BFMTV voire même NC1, sans plus. Je me concentre plus sur celles du bouquet C+, qui diffusent des documentaires, des faits historiques, scientifiques. Etant abonné à NetFlix, à Prime Vidéo et à Disney+ (pour les petist-enfants avant tout mais, qui difuse aussi de bons documentaires) j’ai de quoi faire.
Je regarde très peu les chaînes de télé généralistes ou non, d’information ou pas. Quant à C NEWS, LCI, BFMTV voire même NC1, sans plus.
Ou comment avouer que tu ne savais pas de quoi tu parlais.
Tu viens de te court-circuiter tout seul, bravo.
Bardella H24 sur la télé de Bolloré, tu devrais te faire lanceur d’alerte et avertir l’ARCOM pour leur dire ce qu’ils n’ont pas vu.
EL “Ou comment avouer que tu ne savais pas de quoi tu parlais.” “Tu viens de te court-circuiter tout seul, bravo.” C’est une chose d’afficher C NEWS sur sa télé. S’en est une autre, d’être pendu devant et de boire toutes les paroles dites par Bardella ou par Praud. Décidément tu n’en loupes pas une pour tenter d’avoir le dernier mot. Rien ne m’empêche de laisser ma Télé allumée et “branchée” sur C NEWS son coupé et, de temps en temps, de le réhausser et d’écouter ce qui s’y dit. C’est comme ça que j’ai pu constater la présence ou… Lire la suite »
LedZep : “Rien ne m’empêche de laisser ma Télé allumée et “branchée” sur C NEWS son coupé et, de temps en temps, de le réhausser et d’écouter ce qui s’y dit.” Nous avons apparemment des pratiques diamétralement opposées de l’écoute/visualisation des émissions. Mais je ne permettrai à aucun pisse-froid de contester l’une ou l’autre. Personnellement, je consacre une partie de mon temps à la retranscription d’actes d’état-civil de ma région d’origine en utilisant l’écran de mon ordinateur pour les visualiser. Il s’agit d’un “travail” assez routinier ne demandant qu’une attention moyenne. Je meuble donc mon temps de cerveau libre en… Lire la suite »
Alik “De là à en conclure qu’il passait 7/7 24/24 sur CNEWS …[Jordan Bardella]“ Effectivement, il n’est pas un pilier du show Pascal Praud. Néanmoins on en parle souvent dans ce show pour évoquer, sa montée dans les sondages en vue de la future élection présidentielle, dans deux ans ! de sa popularité eu sein du FN / RN au détriment de la Marine. Quant à Praud, il ne se passe pas une seul moment de son show dans lequel, il ne peut s’empêcher de tirer à boulets rouges sur Emmanuel Macron. Bien souvent cela comence dès sa première prise… Lire la suite »
Je trouve que CNEWS, même si on peut lui trouver des défauts est une bonne chaîne. On nous apporte beaucoup d’informations et chose que j’ai remarqué, ils mettent souvent des archives pour montrer comment les discours de certains hommes politiques ont changé 5 ou 15 ans après. Je préfère les interventions des chroniqueurs et invités que les fadaises moralisatrices des journaleux à la botte du service public, que je ne regarde plus que très rarement. Parenthèse, je ne regarde plus France5 depuis plusieurs années, dont je pense tout simplement que c’est de la merde, après avoir entendu les journalopes-propagandistes nous… Lire la suite »
S’en est une autre, d’être pendu devant et de boire toutes les paroles dites par Bardella ou par Praud.
Je ne suis ni pendu, ni à boire les paroles, et encore une fois tu mens en réduisant cela à Praud ou Bardella; il y a de multiples intervrants sur cette chaine et je n’ai même pas le souvenir d’avoir écouté JB sur CNEWS
Non, je n’en loupe pas une pour avoir le dernier mot,
je n’en loupe pas une pour montrer l’absurdité, la nullité de tes saintes écritures.
peu importe le “on”, aucun intérêt. Oui, tu écris des conneries. Oui, JB a fait de multiples plateaux télés où il a été visiblement plu aux téléspectateurs. et des meetings etc, même avant que MLP soit déclarée inéligible C’est factuel, tu vas dire le contraire ? faut suivre au lieu de t’enfermer dans ta petite haine. Dire qu’il a fait du H24 sur la télé Bolloré et que c’est lui qui l’a crée est idiot et factuellement faux. Que tu n’aimes ni Bolloré ni JB tu as le droit et je m’en fiche, mais que tu poses des conneries comme… Lire la suite »
JN Barrot, le mec qui est allé se coucher devant Tebboune and Co, qui ose dire ça des autres ! On a tous vu les images sur F24, comment il sourit et baisse la tête en même temps devant l’adversaire !
Et toi tu répètes comme à la messe les allégations de ce petit rigolo prétentieux de la macronie. Mân Dieu quel désastre…
“On a tous vu les images sur F24, comment il sourit et baisse la tête en même temps devant l’adversaire ! “
Ta bêtise irait-elle jusqu’à croire qu’il a physiquement peur du dictateur Tebboune ?!
Inforétif : “Ta bêtise irait-elle jusqu’à croire qu’il a physiquement peur du dictateur Tebboune ?!”
Peur, peut-être pas, mais il semble marquer la soumission que l’on doit au mâle alpha (surtout entouré de gardes du corps)
Je n’ai jamais laissé entendre qu’il a eu peur physiquement, je dis qu’il s’est couché.
Ce n’est pas la même chose.
Ta bêtise va-t-elle jusqu’à déformer le sens de mes phrases ?
En passant, ce sont les mêmes façon de “l’excellente Minie”…ça explique nos échanges interminables; je ne laissais pas passer ses façons malhonnêtes.
“je dis qu’il s’est couché.”
Couché c’est tout ! ?
C’est con, si …
Couché comment ?
Couché à cause de qui ?
Couché dans quel but ?
Couché avec quelle(s) conséquence(s) ?
Couché en fonction de quelles circonstances politiques ?
Couché d’après toi ?
Couché selon ta poissonière ?
Couché selon son allié objectif Mélenchon ?
Si maintenant il ne te reste que jouer le con qui comprend pas pour nier le réel que tu ne veux pas admettre.
En plus, tu utilises de plus en plus les procédés tordus de “l’excellente”… je commence à comprendre, pauvre Inforétif, tu ne fais que continuer de t’enfoncer.
“jouer le con”
est tjrs préférable à l’être.
La diplomatie, l’obligation de réserve face à des enjeux dépassant les non-initiés, ça te parle ?
Poujadiste !
Arrête de te faire plus con que tu ne l’es, les images sont des faits et ton héro Barrot était rentré bredouille de son escapade à Alger.
De quelle diplomatie parles-tu ? Ils ont gentiment repris leurs OQTF ?
Tu balances du vent.
Couché comme ta mère a couché avec des allemands, SMPI.😠😡
Je n’invente rien, couille de chien… je subodore, enculé de zor… Tu noteras la richesse de la rime… eh oui, je sais, mais je n’ai aucun mérite, c’est juste inné… ça s’appelle le talent… Tu es jaloux parce que tu as raté ta vie, que tu n’as pas d’ami et que tu es impopulaire… Je peux comprendre, tu me diras, ça devait être dur de se faire foutre de sa gueule par ses élèves et de n’avoir aucune reconnaissance sociale… Tout ça pour terminer sa vie de minable entre son pavillon de banlieue et le bistrot, et n’avoir pour vie… Lire la suite »
Infoclonif. “inventer de toutes pièces“. 😂 😂 😂 Tout comme “Encore qu’on en connait 2 qui se limitent carrément à défendre Ouémo” ? 😂 😂 😂 Mais revenon à nos moutons ou plutot à nos boules de pétanque. XYY aurait donc inventé de toutes pièces cette mémorable mène à la suite de laquelle vous largates les amarres, prétendument sur l’insistance de madame la professeure documentaliste ?(très pratique mais minable de reporter sa pétochardise sur une autre 😑😑😑) . Question “inventions de toutes pièces”, genre émois prof de latin ou après-midi d’un faune, biberon au lait de chamelle, vente de poiscaille… Lire la suite »
““inventer de toutes pièces“. Tout comme “Encore qu’on en connait 2 qui se limitent carrément à défendre Ouémo” ?” XYY, tu es con à ce point pour penser que j’étais sérieux en écrivant cette boutade, d’ailleurs sans aucun caractère offensant ? ! ! “XYY aurait donc inventé de toutes pièces cette mémorable mène à la suite de laquelle vous largates les amarres…” inventé en effet car : -Arrivé à la retraite, -mon port d’attache étant réunionnais (dont notre villa à 1,5 bâton à 30 mètres au-dessus du magnifique lagon de la Saline les Bains … coucou pauvre clochard de Si Crado… Lire la suite »
L’autre mytho de zorbak qui étale ses états d’âme et sa prétendue aisance matérielle…😆😂😂🤣
Le clochard te chie sur la tête, connard prétentieux… 😁😆
“étale ses états d’âme et sa prétendue aisance matérielle…” La mémoire, chez toi, Si crado, c’est comme tout le reste : extrêmement branlant … : je ne faisais que rappeler entre les lignes, pour la souligner, ta fierté de plouc hyper-bof bavée ici quand tu te vantais de ta fréquentation des restaurants les plus chers de Nouméa tout en balançant ton mépris des “Zorbaks [auto-mépris, donc] crevards“ (= crève la faim) venus en NC pour “faire du 5,5″. Ne m’oblige pas à te citer en copié-collé, Ducon. Encore une fois, tu es la plus grosse merde qui ait hanté ce… Lire la suite »
Je ne me suis jamais “vanté ” de fréquenter des restaurants chers de Nouméa, Ducon toi même, j’ai dit que je connaissais le monde des restaus “étoilés” (pas à Nouméa, donc, car il n’y en a pas)… Et j’ai bien rigolé ce matin tout en en vaquant à mes occupations en repensant à Monconrétif qui possède à La Réunion une villégiature à 180 millions de francs-bananes à nouzôts, juchée à 40M de haut, surplombant un lieu paradisiaque… mais vit dans un bled de la banlieue perpignanaise, dans un voisinage infesté d’arabes, et essaie de vendre son rafiot pourri qu’il a,… Lire la suite »
Infoterif. “XYY, tu es con à ce point pour penser que j’étais sérieux en écrivant cette boutade… “. Rappel: [ XYY Répondre à Inforétif 30 novembre 2025 11:09 Infomigratif. “Encore qu’on en connait 2 qui se limitent carrément à défendre Ouémo.” Encore qu’on en connait 1 qui a détalé d’un bout à l’autre de l’axe indopacifique pour finir par se placer sous la protection de Nounours de St Jacques ]. 😇 😂 À boutade, boutade et demie. Vous n’aimez pas les boutades ? 😊 Pour paraphraser un agrégé inconnu ex-bourbonnais : “Inforétif, vous êtes con à ce point pour penser que j’étais sérieux… Lire la suite »
“ton obsession pour Poutine, à traiter tes concitoyens de “collabos” , de “traitre à sa patrie” et de “fachos”. “Interrogés sur le fait que MLP et Mélenchon ne rejoignent pas Emmanuel Macron sur l’urgence de se préparer face à la menace représentée par Moscou, le ministre des affaires étra ngères J L Barrot les qualifie tous deux de “dirigeants irresponsables qui ont toujours mangé dans la main du Kremlin et courbé l’échine devant les dictateurs”. “Ils n’ont jamais caché leur fascination pour les dirigeants autoritaires et belliqueux“, poursuit-il.” Y en a d’autres, ceux-là des sinistres d’affaires étranges au fond du trou du… Lire la suite »
Ramassis de foutaises : 1.c’est MLP qui avant avait donné l’alerte sur le déclin de la puissance militaire française, c’est Macron et ses moutons aujourd’hui (dont tu fais partie) qui se drapent dans la vertu de “l’urgence de se préparer”. (ils sont cons et politiquement incultes où ils sont malhonnêtes ces petits bourgeois macronistes ?) Par contre oui, tout comme Alik, j’ai un certain regard positif* sur les dirigeants qui ont de la poigne, qui agissent, qui défendent leur pays contrairement à notre Président à nous qui brasse de l’air et s’est couché devant l’adversité de Tebboune dans la pure… Lire la suite »
“Par contre oui, tout comme Alik, j’ai un certain regard positif* sur les dirigeants qui ont de la poigne, qui agissent, qui défendent leur pays” Tu n’as pas écrit “Heil Hitler !” (ta gueule abruti de Si Crado) mais le coeur y était ! Poutine qui défend son pays, te rends-tu seulement compte de l’énormité ainsi proférée ?! Un salopard se livrant sans raison ni pitié à la destruction de ses voisins, habitants innocents compris, pour soi-disant “défendre on pays”, non mais ça tourne pas rond chez toi, Electron, sans parler de l’état de + en + lamentable à tous points… Lire la suite »
Calme toi, Coconnet… Tu parles vraiment souvent de Adolf Hitler, c’est une obsession chez toi… c’est pour le moins préoccupant…🤔
À mon avis tu as besoin de te changer les idées, il y a du côté de Perpignan deux ou trois établissements sympas, où tu pourrais rencontrer des gens qui seraient prêts à t’aider, ça te ferait le plus grand bien…
Bisous ma poule. 😘
Perpignan Gay Bar & Club Guide 2025 – reviews, gay map, information (travelgay.com)
Inforétif : “Interrogés sur le fait que MLP et Mélenchon ne rejoignent pas Emmanuel Macron sur l’urgence de se préparer face à la menace représentée par Moscou, le ministre des affaires étra ngères J L. …”” L’honnêteté la plus élémentaire devrait t’imposer de citer tes sources. https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/guerre-en-ukraine-jean-noel-barrot-qualifie-marine-le-pen-et-jean-luc-melenchon-de-dirigeants-irresponsables-qui-mangent-dans-la-main-du-kremlin_AN-202511290371.html Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. “Avoue que tu en as fait des cauchemards, …” [@ Electron] Je ne peux pas parler au nom de l’Electron, mais personnellement, ça m’a perturbé à peu près autant que tes prévisions de la même époque sur le “retour” de la Crimée russophone par la force au sein… Lire la suite »
Jean-Noel Barrot, pff, le petit mec qui est allé se coucher –avec le sourire– devant le pouvoir algérien…
Si les analyses des petits trouffions de la macronie sont les références intellectuelles de crétinrétif, on est vraiment perdus.
Aucune hauteur de vue, aucune analyse propre, juste répéter comme un perroquet ces petits parvenus arrogants.
Electron : “Jean-Noel Barrot, pff, le petit mec qui est allé se coucher …”
Barrot, le porte-coton du roi.
C’est lunaire.
“L’honnêteté la plus élémentaire devrait t’imposer de citer tes sources.
Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose.”
Pourquoi devrais-je citer la source ???
Et surtout, SURTOUT, en quoi mens-je (de la chloroquine, comme toi ?) ?
Tu m’inquiètes de + en +, Alikollabo.
Inforétif : “Et surtout, surtout, en quoi mens-je”
Tu mens en relayant les affirmations du fallot Barrot qui ne peut décemment croire que, littéralement parlant, “Marine le Pen et Jean Luc Melenchon … mangent dans la main du Kremlin“
Tant qu’à choisir, la “propagande” du ministre des affaires étrangères “d’en face” est un petit peu plus structurée, et crédible, mais elle n’est pas largement disponible dans le “monde libre”
https://www.youtube.com/watch?v=aLgBha0qxco
(on dit “Merci qui” ?)
“Tu mens en relayant les affirmations du fallot Barrot qui ne peut décemment croire que, littéralement parlant, “Marine le Pen et Jean Luc Melenchon … mangent dans la main du Kremlin“ Là tu tarabicotes à tout va, Alikollabo ! Depuis quand, répéter des paroles qui ont été effectivement prononcées, c’est mentir ? Ou bien alors, si je comprends, tu trouves en fait que c’est notre ministre des affaires étrangères qui ment en déclarant que, en clair, les extrémistes français des deux bords opposés trahissent leur pays. (ne serait qu’en: -se couchant devant Poutine -tout en ayant le culot de prêter… Lire la suite »
Inforétif :”PS : pitié, épargne-nous ton inévitable photo de Colin Powell, d’autant que la France n’a pas partcipé.” T’as raison, zonzon. Pour changer, un petit dossier photos sur le trimestre de bombardements effectués en toute illégalité internationale par les avions de l’OTAN (dont des français) sur la Serbie en 1999. Je l’ai déjà écrit, mais je le répète : ma collègue Kristina balayait les vitres de son bureau de Belgrade, pulvérisées par le “camp du bien”. A ma connaissance, ce crime de guerre n’a fait l’objet d’aucune condamnation, et le Kosovo depuis est devenu un modèle de démocratie que l’UE finira… Lire la suite »
” et le Kosovo depuis est devenu un modèle de démocratie”
Quand tu qualifies un Etat de démocratie, vu comment tu glorifies la Russie sous le joug de Poutine, permets-moi d’être circonspect…
L’Ukraine c’est déjà compliqué pour les “Moncons” qui la dénigrent ici, alors le Kosovo… Laisse tomber les massacreurs génocidaires de Srebrenica et reviens donc à nos moutons du moment, sans te commander bien sûr.
Faut te faire soigner, Coconnet…
Tu veux que je te bifle un peu les gencives, de mon membre flaccide à l’odeur musquée, en te tenant délicatement la tête en arrière par le peu de cheveux qu’il te reste sur la nuque?
Ça te calmerait un peu…
Mais sérieux, tu en tiens une bonne, ça en devient (presque) inquiétant, tu es complètement obnubilé, mon Coconnet… 😳
““Les facistes français“: fascé avec l’orthographe ?”
Sans doute mais adresse-toi à l’auteur de ce texte.
“Vichy ? avant 1939 ?”
Fâché avec le français, dont sa ponctuation ?
Facistes et Vichy ne sont pas dans une même phrase, un minimum de finesses t’aurait permis de supposer un glissement temporel de la première à la seconde.
Sinon, comme dab, rien sur le sujet “proprement” dit, rien que de la fragmentation de poil de cul en 4.
Qu’est-ce que ça change ? rien du tout !
Le rapport que tu fais entre ce texte et le contexte actuel ne prouve en rien la véracité de tes allégations fantaisistes et mensongères.
Infosource. “Sans doute mais adresse-toi à l’auteur de ce texte“. Et qui est l’auteur de ce texte ? 😂 😂 😂 “Facistes et Vichy ne sont pas dans une même phrase, un minimum de finesses t’aurait permis de supposer un glissement temporel de la première à la seconde.” 😂 😂 😂 Reprenons: “Les facistes français avant 1939 … bla bla bla…….. Ils ont souvent soutenu la politique de non-agression de Vichy,” Et quel est donc le référent de Ils ?. Facé avec la linguistique française ? 😂😂😂 “Sinon, comme dab, rien sur le sujet “proprement” dit, rien que de la fragmentation de poil… Lire la suite »
“Et quel est donc le référent de Ils ?. Facé avec la linguistique française”
Non. c’est tordu, ce 2° “ils” a manifestement changé d’époque en changeant de phrase,
et toi c’est sûr, tu n’achèteras jamais une Dacia
Dacia : le choix des gens intelligents | Watch
Pour ce qui est de la position des extrêmes-droites françaises pdt le réarmement de 36 à 39, elle fut très hétérogène.
T’es déjà bourré, toi? Faudrait que tu te calmes, un peu… prendre pour faire mumuse le nom d’un mec mort il y a dix ans…
Si c’est pas de la puérilité…
Inforétif : “et toi c’est sûr, tu n’achèteras jamais une Dacia” [@XYY .]
Je te trouve bien affirmatif …
Contrairement à ce que (de loin) tu peux t’imaginer, il y a, à Ouémo, non seulement des gens intelligents, mais aussi des Dacia …
Alik.
“il y a, à Ouémo, non seulement des gens intelligents, mais aussi des Dacia”.
Il y a 2-3 ans, j’avais un Duster. Je voulais en reprendre un, mais après m’être frité avec un commercial de Dacia, j’ai pris une caisse en provenance de chez Xi Dada. Ainsi va le monde 😊
Passionnant…😁😆
Ah, Berger Kawa est mort, et cet après midi il a plu.
Fait chier, j’ai une de mes poules qui bouffe les œufs, cette connasse.😠
Rocky : “Fait chier, j’ai une de mes poules qui bouffe les œufs”
Parle-lui d’Henri IV …
😆😂😂
“j’ai pris une caisse en provenance de chez Xi Dada.”
Sage précaution, on n’est jamais trop prudent, qui sait ce qui pourrait arriver aux survivants non voiturés chine-toc quand les chars amphibies de la coalition sino-russe surgiront des 30 mètres de fond de votre lagon sur lequel ils sont planqués depuis 4 ans, recouverts de faux madrépores bariolés en plastique, pour bombarder Ouémo afin d’y sauver leur meilleur collaborateur Alikoutine, traqué par le contre-espionnage français.
“Contrairement à ce que (de loin) tu peux t’imaginer, il y a, à Ouémo, non seulement des gens intelligents, mais aussi des Dacia …” Donc en accord avec la pub, tout va bien dans le meilleur des Mondes. Par contre j’avais tjrs cru que tu habitais à Ouemo. Pour ces malheureuses fortunes de mer, qui doivent toutes deux au plus grand des hasards, ainsi que les précédentes du même type, reçois ttes mes condoléances les moins sincères, mon cher Alikollabo : Deux navires de la flotte fantôme russe en feu en mer Noire, près de la Turquie PS : récriminations du genre “Zelensky corrompu”… Lire la suite »
Dacia? plébiscitée par les zoreils homosexuels en général… et les caldoches fin de race de Nouméa en particulier…
Beaucoup de jeunes garçons efféminés qui disent “chocolatine” roulent en Dacia… coïncidence? Je ne crois pas, non…
Décidemment tu n’en loupes pas une, Monconrétif… 😁😆
Inforétif. “ “ils” a manifestement changé d’époque en changeant de phrase“. Facé avec ka linguistique française (bis) ? Pour marquer le changement de temporalité, le français change le temps du verbe, ou utilise un adverbe (ou locution adverbiale), ou les 2 à la fois. En clair: Les facistes français avant 1939 ont souvent critiqué bla bla bla…….. Ils soutiendront souvent la politique de non-agression de Vichy. ou Les facistes français avant 1939 ont souvent critiqué bla bla bla……..Quelques années plus tard, ils ont souvent soutenu la politique de non-agression de Vichy ou Les facistes français avant 1939 ont souvent critiqué bla bla bla……Quelques années… Lire la suite »
Merci XYY pour ces éléments factuels qui apportent la preuve qu’Inforétif écrit des conneries. Il veut tellement se donner le rôle du bobo contre l’extrême droit qu’il perd complètement pied sur le sujet. Par ailleurs, je suis sûr qu’il est de ces bobos qui, lorsque MLP donnait l’alerte sur le déclin militaire de la France, la perte capacitaire avec un seul PA et voulait réarmer la France, devait s’opposer et hurler au “nationalisme”, “le nationalisme c’est la guerre” et autres idioties. Non, donner l’alerte sur la perte capacitaire des armées de son pays, ce n’est pas être nationaliste, ce n’est… Lire la suite »
INZORÉTIF!!! ESPÈCE DE SALE VIEUX COCHON VICIEUX!!😠😡
À GENOUX! …TOUT DE SUITE!!
“BLAF BLAF BLAF BLAF BLAF”…
Tu aimes ça, hein, vieille cochonne? Tu en redemandes, encore et encore… 😁😆
“Tu aimes ça, hein, vieille cochonne? Tu en redemandes, encore et encore…”
Moi non, mais si on fait confiance au système calédosphérique de “notation”, on pourrait croire stupidement que 4 clampins décérébrés te plussoient.
Mais qd donc le portier de ce blog réalisera-t-il la présence d’une si grosse merde sur le tapis persan de son salon pour la jeter dans le premier égout venu ? ! !
21H30 heure lôkale… soit 11H30 heure du camp de Rivesaltes…
Tu sortais du bistrot je suppose?
Infogressif. “Ce qui compte, c’est que l’aventure se termine tjrs mal pour le dictateur“. 😂 😂 😂 Sans déconner 🤗 En vrac, quelques dictateurs et autocrates pour lesquels, selon Infosénile, l’aventure s’est mal terminée: Francisco Franco Antonio Salazar Fidel CastroAugusto Pinochet .Josip Broz TitoLee Kuan YewFrançois Duvalier “Papa Doc” Hafez al-AssadPaul Biya (encore en poste)… 😂 😂 😂 “une Russie en pleine dénatalité” Taux de natalité brute 2023 (sources : ined, georank, macrotrends…) Russie ~ 8,6 ‰ Autriche ~ 8,5 ‰ Croatie ~ 8,3 ‰ Allemagne ~ 8,3 ‰ Estonie ~ 8,0 ‰ Finlande ~ 7,8 ‰ Grèce ~ 6,8 ‰… Lire la suite »
En 2023, le taux de fécondité en Russie était d’environ 1,41 enfant par femme, ce qui est considéré comme faible pour assurer le renouvellement de la population. Cela reflète un déclin démographique dans le pays, avec une population en déclin, et un taux de natalité inférieur au taux de remplacement de 1,6.
Wikipedia
Infonatif.
“taux de fécondité”
Allons bon, on passe du taux de natalité au taux de fécondité 🤗
Allons-y, Alonzo…
Russie 1,41…
Allemagne 1,39
Lettonie 1,36
Autriche 1,32
Estonie 1,31
Grèce 1,26
Finlande 1,26
Luxembourg 1,25
Italie 1,21
Pologne 1,20
Lituanie 1,18
Espagne 1,12
Ukraine 0,99
Hors concours:
Niger 6,64
😋 🍼
T’as raison, zonzon, aucun rapport entre fécondité et natalité…
Sinon, non seulement
Les Russes ne font plus d’enfants, mais Moscou aurait trouvé comment sauver sa démographie – Geo.fr
(les Français à peine un peu plus…)
mais encore et surtout Poutine les envoie au hachoir ukrainien.
Inforétif. “T’as raison, zonzon, aucun rapport entre fécondité et natalité…“. Kikadiça ? 🤔 😊 Ça m’a juste fait marrer de vous voir passer d’un indice statistique (*) à un autre comme on saute de branche en branche. 😂 Manque de pot pour l’ex-boubonnais, dans les 2 cas, la Russie ne fait pas tache par rapport aux pays de l’UE 😊Les chiffres sont têtus n’est ce pas ? 😇 (*) Soit dit en passant, il peut arriver qu’un pays ait un taux de natalité > à un autre pays mai0us un taux de fécondité < à ce même pays. Jetez un… Lire la suite »
“l’ex-boubonnais” Si tu as voulu écrire ex-bougonneur, faut enlever le “ex”, merci par avance. “la Russie ne fait pas tache par rapport aux pays de l’UE” Certes, mais l’UE ne se voit pas en coalition impériale envahissant le minuscule pays (appelé “Kremlin”) de Vla Dimirkirevienoufairechier : c’est donc moins grave pour nous, l’idée honteuse de piquer 20 000 gamins russes pour compléter nos effectifs ne nous prendra jamais. Hitler (va chier Si Crado !), lui, fut plus prévoyant (mais sans prendre en compte l’avis d’un futur grand sage calédosphérique sur l’inéluctabilité de la défaite finale qui attend à la fin… Lire la suite »
Inforaptif.
“l’idée honteuse de piquer 20 000 gamins russes pour compléter nos effectifs ne nous prendra jamais“.
J’ai ouï dire que 2000 gamins bourbonnais avaient été envoyés en villégiature dans l’Hexagone, il y a quelques décennies…et pas seulement pour y faire tapisserie 😑 😇
” 2000 gamins bourbonnais “
Soit autant de gamins de familles (re)décomposées au rhum Charrette et réglant leurs différends internes au sabre d’abattis…
Que de poncifs bien-pensants sur ce sujet !
Infoponcif.
“Que de poncifs bien-pensants sur ce sujet !”.
Ben c’est ça aussi … et étalés sur près de 700 pages 😂
https://www.calameo.com/books/0008863793fc69e71a11f
Mais oui c’est ça Monconrétif, moi aussi je t’aime.
Allez bisous.
“En vrac, quelques dictateurs et autocrates pour lesquels, selon Infosénile, l’aventure s’est mal terminée:” Voir l’agonie de Franco, mon bon. Et tout dépend de ce qu’on entend par “mal terminé” : ces gens voulaient laisser dans l’Histoire une empreinte glorieuse ou à tout le moins positive en tant que chefs d’Etat ayant amélioré celui de leur pays, qu’en est-il de ceux cités par Toa ? Bon, tu me diras que pour tes alcoolytes, et Si Crado, et toi, Hitler (ta gueule Si Crado, avec mon point G dans ta g.) a rempli son contrat mémoriel, comme est en train de… Lire la suite »
Inforétif : “ces gens voulaient laisser dans l’Histoire une empreinte glorieuse ou à tout le moins positive …”
Quelle empreinte penses-tu avoir laissée dans les différents établissements scolaires où tu as sévi ?
“Quelle empreinte”
Énhaurme, j’en veut pour prheuvve le déklin de notre édukation nationale en franssai et byologie à partir de l’année qui a suiviye mon débu de reutrète.
Ce sont ceux pour qui tu as toujours voté qui ont orchestré ce déclin. Toi qui aimes décerner des bonnets d’âne “incompétent”, tu devrais approfondir ta réflexion là-dessus.
À part des traces de pneus, sûrement pas grand chose…
Par contre pour ce qui est de l’image des vieux enseignants blancs qui tripotent leurs jeunes élèves, là…😠😡
Inforétif.
“Voir l’agonie de Franco, mon bon.“
Ce brave Pompon (1911-1974) n’était ni un dictateur, ni un autocrate pourtant . 😇
“ni un dictateur, ni un autocrate pourtant “
Zegondegré ?
Sinon les Républicains réfugiés dans ma ville se retourent dans leur tombe.
“La censure sous le franquismeLa censure sous le franquisme en Espagne a été extrêmement sévère et a été appliquée par le régime pour maintenir son contrôle et son autorité. Les opposants politiques, les syndicats, et les membres de mouvements de résistance ont été persécutés et exécutés pour défier le régime. La garrote, un moyen de torture et d’exécution, a été utilisée pour maintenir l’ordre et la soumission dans le pays.“
Les Républicains tuaient les curés à coups de bâton (cf un roman célèbre), Franco c’était à la garrote …
Infognitif.
“Zegondegré ?”.
Premier degré.
Je maintiens: ce brave Pompon (1911-1974) n’était ni un dictateur, ni un autocrate pourtant.
Mais qu’est-ce qu’ont en a à foutre du franquisme, quel est le rapport avec tout ce qui ne va pas en France, avec la politique en France en 2025 ?
” franquisme, quel est le rapport avec tout ce qui ne va pas en France”
Un rapport évident : en matière de démagogie et de populisme, ta poissonnière y va toujours franco de port.
Devine un peu ce que MOI j’enfonce dans ta gueule, Monconrétif… 😁😆
Inforétif : “Avec Trump, faut chercher son intérêt économique (personnel, si possible).”
Et si nous élevions un peu le débat :
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf
Une lecture ardue, mais passionnante, loin de l’image de l’obsédé gâteux entouré de primates que voudrait donner LedZep.
Le chapitre sur l’Europe est sans pitié.
Evidemment, c’est un peu plus long qu’une brève de MSN, mais dans l’hiver pyrénéen, au coin de la cheminée, une saine lecture …
“Une lecture ardue, mais passionnante”
Change de lunettes, Lilik !
“ Soutenir l’établissement et la consolidation des démocraties et défendre les droits de l’homme.”
Une des “bonnes” résolutions du canard laquais auxquelles il tourne résolument le dos, comme pour presque toutes ses autres.
Infohatif : “Change de lunettes, Lilik !” Prends le temps de tout lire, avant toute saillie. D’ailleurs, à ton âge … Extrait, sur l’Europe : “Continental Europe has been losing share of global GDP—down from 25 percent in 1990 to 14 percent today—partly owing to national and transnational regulations that undermine creativity and industriousness. But this economic decline is eclipsed by the real and more stark prospect of civilizational erasure. The larger issues facing Europe include activities of the European Union and other transnational bodies that undermine political liberty and sovereignty, migration policies that are transforming the continent and creating… Lire la suite »
“Extrait, sur l’Europe” Écoeurant, juste écoeurant. “ L’Europe continentale a perdu une part de son PIB mondial—qui est passé de 25 % en 1990 à 14 % aujourd’hui — ” C’est surtout que le PIB non européen grimpe plus vite …, normal vu son très faible d’origine (resté le même pour le Russe, bravo Poutine !). Et surtout faudrait que l’Amère loque compare d’abord le déclin économique américain actuel avec l’essor chinois ! ” les activités de l’Union européenne et d’autres organismes transnationaux qui sapent la liberté politique et la souveraineté,” Remarque complètement con, mais compréhensible de la part d’une Union américaine… Lire la suite »
Le U de USA est bien plus auto-“sapant” de par ses lois fédérales nettement plus contraignantes pour chacun de ses Etats.
Affirmation vide de sens, absurde.
Trump recommence avec ses plans de paix foireux et pour l’Ukraine.
plutôt un plan serpillère. le pauvre est à la dérive.
“Trump recommence avec ses plans de paix foireux et pour l’Ukraine.”
Sois sympa, laisse donc Alik et votre copain commun Si-Crado savourer.
Bon, évidemment, si on leur rétorque que dans le cas où Trump arriverait à faire céder Zelensky aux exigences de Poutine, ce dernier, fort de son armement nucléaire, pourrait alors choisir à sa guise quels autres pays ou régions (y compris la NC, où il a des complices déclarés sur Calédosphère, pourquoi pas ? !) il pourrait ajouter à son tableau de chasse ….
Des complices il en à partout le boucher. il prétend même que des Francais se battent en Russie contre le barbare envahisseur Ukrainien
L’alcool te rend parano Monconrétif…
Toi, que proposerais-tu ?
.
LedZep, qui n’écrit mot consent : j’en déduis que tu désapprouves ce nouveau lachâge des démocraties par Trump le Kompro-maté.
(calédosphère elle/lui aussi difficile à mater en ce moment, ça beugue à tout va).
Sinon les réactions d’orfraie de certains “patriotes” français tout à coup réveillés par notre chef d’état-major valent leur pesant de rigolotisme.
C’est bien que LeZob nous lâche la grappe un peu… ça nous fait des vacances…
Alors comme ça tu inventes des expressions, toi, le pédéraste alcoolique hargneux? “les réactions d’orfraie” Tu peux développer? 😁
RS [l’érotomane du Net]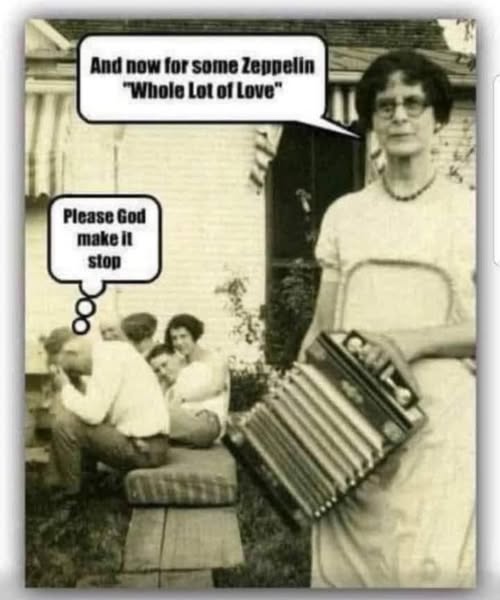
Y’avait qu’à demander :
https://www.youtube.com/watch?v=kQ2QoOs-WRo&list=RDkQ2QoOs-WRo&start_radio=1
Inforétif “LedZep, qui n’écrit mot consent : j’en déduis que tu désapprouves ce nouveau lâchage des démocraties par Trump le Kompro-maté.” Finira t’il son mandat ? Va t’il se retrouver un beau matin, en tenue de satyre, à danser la gigue dans les jardins de la Maison Blanche ? https://www.ladepeche.fr/2025/06/19/donald-trump-propos-inadaptes-vocabulaire-appauvri-phrases-incoherentes-la-sante-mentale-du-president-des-etats-unis-est-elle-defaillante-12769824.php “Donald Trump : propos inadaptés, vocabulaire appauvri, phrases incohérentes… la santé mentale du président des États-Unis est-elle défaillante ?” Quelle déchéance pour ce grand Pays (que constituent les USA) qui inventa la Démocratie moderne. “Sinon les réactions d’orfraie de certains “patriotes” français tout à coup réveillés par notre chef d’état-major valent leur… Lire la suite »
“Tout est possible avec ce déglingué de Poutine.”
D’autant plus avec le bellicisme de ses soutiens dictatoriaux à la tête de la Chine, de la Corée du Nord, de l’Iran.
Et dire que Trump aurait pu aisément débarrasser le peuple iranien de ces derniers, est-ce que c’est parce que Poutine le tient littéralement par les couilles que Trump a stoppé in extremis l’élimination des Mollahs pourvoyeurs de drones à la mafia russe ?
“Quelle déchéance pour ce grand Pays (que constituent les USA) qui inventa la Démocratie moderne.” C’est une tragédie découlant du simple fait que la justice américaine a fait une énorme boulette en n’ emprisonnant pas à vie ce fruit pourri sur tous les plans après sa tentative de coup d’état de la prise du Capitole. Et maintenant cette pourriture lance un ultimatum, non pas à l’agresseur de l’Ukraine, cette fois-ci, mais à nouveau à l’agressée !!! Avec parmi ses motivations, le caprice de l’obtention d’un Nobel (qu’il n’aura d’ailleurs JAMAIS), pour avoir “gagné une huitième “paix”, selon son cerveau malade.… Lire la suite »
“Quelle déchéance pour ce grand Pays”
Un autre grave indice de son déclin :
La principale agence sanitaire américaine relaie une fausse théorie sur les vaccins
faut avouer que 800 lectures on est loin des supers audiences. preuve que lorsqu’il y a moins de revisite et de post il y a moins de lecture au compteur.
MDR… Le Zob va nous en faire une dépression, lui qui se croyait lu par des milliers d’internautes…😁😆😂😂🤣
Tiens, allez, je mets une citation de Nietzsche… il aime bien, ce con de LeZob, il a jamais rien lu de lui mais il s’y réfère, il croit que ça lui donne l’air intelligent…😁😆😂😂🤣
“Il croit que ça lui donne l’air intelligent ” Et toi par contre tu penses qu’en publiant cette image et cette citation ça te fait passer pour moins “kong “que tu ne l’es ? 🤣 Quitte à te faire de la peine le Rocky et à détruire tes illusions, elle est faite pour toi cette citation! Tu es très très stupide R.S🙃. et même si tu ne veux ni l’entendre ni la voir ni en entendre parler de cette vérité, c’est un fait ! Et tout ce que tu enchaînes comme “konneries,” des milliers de lecteurs sur Facebook Calédosphère pourront… Lire la suite »
“des milliers de lecteurs sur Facebook Calédosphère“… où ça???😁
Tu ne te renouvelles pas beaucoup, coconne, toujours la même rengaine, “tu es niais, tu es simplet, tu es stupide, tu es kong gna gna gna gnin gnin gnin”… c’est lassant à la fin…
Sinon, c’est quoi “Facebook Calédosphère“??😁😆
“Tu ne te renouvelles pas beaucoup coconne ..toujours la même rengaine..gna gna gna gnin gnin ” Tu l’as dit bouffi !🤣Tu es indécrottable mon gars!TA même rengaine d’onomatopées, toujours pas la mienne . La preuve !Tu l’as encore pondue cette litanie puérile👶! “Tu es niais, tu es stupide , tu es simplet, tu ,tu es kong…c’est lassant à la fin “Non,sans blague? Pauvre toi, 😮💨, comme tes délires quotidiens sur la toile et ton jargon vulgaire et /ou raciste, voire obscène et ton vocabulaire recherché autour du mot ” kong” adressés aux mêmes internautes ? ” des milliers de lecteurs… Lire la suite »
Putain, ça part dans tous les sens…
T’es en forme, Coconne, visiblement… 😁😆
tiens te revoila? tu nous as manquée tu peux pas savoir.
toujours aussi niaiseuse. tu ne te renouvelle pas.
“Tiens te revoilà?Tu nous a manquée ,tu peux pas savoir ” Vu comme tu écris” manquée”je n’en doute pas, le ” spécialiste” de la communication écrite. Toi par contre, si tu disparaissais avec tes idioties, pas sûr que tu ” nous ” manquerais , le ” penseur n0 2 des bacs à sable de Calédosphère ! ” Toujours aussi niaiseuse .tu ne te renouvelle pas “. “Niaiseuse ? “Mazette,un néologisme de Oupse2 ! La centrale va être en surchauffe ! Toi non plus question ” narratif “,tu ne te renouvelles pas mon pauvre gars, on dirait même le perroquet OQTS.Cal.… Lire la suite »
Reste à comprendre pourquoi Oups, qui appréhende parfaitement la géopolitique mondiale alarmante du moment, se fourvoit à ce point sur ce connard de Si Crado.
se fourvoiE à Minie et LedZep : Zelensky a parfaitement intégré qu’il ne faut pas répondre à ce demeuré de Trump de front mais le flatter pour tenter de le manoeuvrer : Un plan de paix élaboré entre Trump et Poutine pour l’Ukraine ? Une proposition envoyée à Zelensky “En réponse à la proposition américaine, Volodymyr Zelensky prévoit d’échanger des “possibilités diplomatiques disponibles et des principaux points nécessaires à la paix” avec son homologue Donald Trump “dans les prochains jours”. “Nous sommes prêts à travailler de manière constructive avec la partie américaine …” Bonjour les ulcères d’estomac pour parvenir à se contrôler ainsi… Lire la suite »
“se fourvoiE” Ducon…
Agrégé… de lancer de poids, c’est bien ça? 😁😆
mais oui la grosse niaiseuse. la langue c’est quelque chose de vivant sinon le contraire c’est une langue morte comme la chose dans ton cerveau.
Après les petites fautes pour te raccrocher. tu sais bien la grosse niaiseuse que tu en fait aussi.
Idem: totalement débile ta réponse Et dans un jargon incompréhensible !
Tu n’as que ça à fo…tre d’écrire de telles insanités ? Tu te lances dans la compétition de qui écrira la plus grosse co…rie ?
Pas de compétition tu es imbattable.
“…fautes…tu sais bien… que tu en
faitfais aussi”Même ton génial copain Si Crado, qui vient de souligner l’une des miennes, en fait aussi !
Si Crado, 20 novembre 2025 19:06
“… à ruminer sur sa vie qu’il a raté,”
nul y échappe.
Ben voilà suffit juste de la boucler sur ce sujet.
toi tu avais disparue avec tes pâtés de chien pour trottoirs, on s’inquiétait
Complètement crétine cette réponse.Qui peut le plus peut le moins. Toi tu excelles dans le moins.
Et toi dans les pâtés.
Totalement débile, complètement crétine, ensuite on inverse complètement débile, totalement crétine…
Je vais faire un dico de tes réponses totalement cretines.
Avec les tiennes mon petit Oupse 2 tu auras déjà de quoi faire et mieux qu’un dicco : une encyclopédie avec toutes tes stupidités , comme celle – ci qui n’a aucun sens et dont on se demande ce qu’elle vient faire dans les sujets abordés . Pourquoi,tu penses que ce que tu me postes est intelligent ?Tes histoires de pâtés pour chien sont d’un grand intérêt ? Je dois avoir raté un épisode de ta thèse !
Un seul “C” à “dico”, Coconne… J’hallucine… 😁😆
Arrête de te la péter, wouinrue, tu n’as pas le niveau… 😁😆😂😂🤣
“J’hallucine ” Mais tu n’as pas besoin de le préciser ,tout le monde le sait que tu hallucines le RS et ce depuis le début de tes publications ! 🤣 Et même que tu délires et que ce délire n’est pas comme je le confirme , très mince ! 🤪 Un seul c à dico ? Qu’est ce qu’on en a à ficher “dukong dukong” ? “Arrête de te la péter …tu n’as pas le niveau ” Le niveau de ton dikko wikip , de ton jargon , de ton ” Bèchrelle” et de ta bibliothèque d’images prouvant ta “xénoglossie”… Lire la suite »
disparu, sans e.
Mais sinon, à part vouloir nous enduire d’erreurs grammaticales et nous prouver que tu manques cruellement de savoir-vivre et générosité envers tes contemporains, c’est quoi ton but ?
Je te l’ai dit mon but, faire partie de l’anomalie cosmique caledo, le bip qui se perd dans le vide infini. Et puis relire chacun de tes posts rabâché sur Poutine. J’en raffole. Le tien c’est quoi de but, à part traiter de super intelligente la coconne bouffonne et de nous envoyer tes tirages à la noix, pester contre tout le monde, surtout sur si crado le dénommé ainsi, par toi. C’est amusant comme toi, la bouffonne et d’autre ne faites que réchauffer chaque fois les mêmes sujets. vous êtes sur les jantes les loulous avec vos débâts perpétuels. Mêmes… Lire la suite »
Euuuhhh… non, moi c’est Rocky… c’est mes potes qui m’avaient surnommé comme ça parce que je faisais un peu de boxe… et Siffredo c’est à cause de mon prénom… 😁😆😂
Je mets une photo de Clint, comme ça LeZob pourra se branler un petit coup… 😁😆
Je sais mais comme l’autre folle t’a surnommé comme c’a j’ai repris son expression te concernant.
Je le ferais plus promis.
Aucun problème… je m’en fous en fait 😉
C’est Monconrétif-le-pédéraste-frustré qui m’a surnommé comme ça… la vieille elle est bonne à peau… alors inventer des surnoms… 😁😆😂
Bonne soirée.
Par contre “Monconrétif©” c’est de Electron, rendons à Jules ce qui appartient à César.
Du coup je te ferai un virement en fin d’année, Electron, pour les royalties. 😉
L’autre folle dont je parlais pour ce coup était infodemerde.