Actualité
Le gel électoral, c’est pour se protéger de la compétence
(Ce que le pays commence enfin à comprendre)
On explique le gel électoral par l’histoire. C’est juste. Mais on oublie l’essentiel : il a aussi protégé un système politique qui n’aimait pas la concurrence. Un pays peut vivre un temps sous cloche. Pas éternellement.
Depuis quelques jours, un phénomène discret, presque banal, éclaire mieux la situation politique que des mois de communiqués : les commentaires sur les pages indépendantistes kanak.
On y lit des phrases simples : « Les métros votent pas, sinon fini le business », ou encore: «Il y a beaucoup de loyaliste qui sont contre le dégel du corps électoral (…) les plus anti zoreil ça à toujours été la droite locale »
Brutale, oui. Mais dans ces formules, on trouve quelque chose que les sociologues appellent une “intuition de système” : l’idée qu’un mode de fonctionnement, plus qu’un camp, cherche à se préserver. Ce n’est pas une attaque. C’est un constat.
Pourquoi les Kanak voient clair
Les Kanak (pour ceux qui ne dépendent pas de la fonction publique territoriale) observent le système de l’extérieur. Ils n’en vivent pas. Ils n’en héritent pas. Ils en profitent plus rarement. Ils voient les rouages sans les illusions qui les maquillent. Ils savent identifier les alliances silencieuses, les arrangements entre vieux appareils, les réflexes de conservation d’un écosystème qui tient ensemble pour tenir tout court.
Quand un internaute écrit : « Les métros votent pas, sinon fini le business », ils ne parlent pas d’identité. Il décrit la mécanique d’un système qui se protège de la concurrence puisque le “métro” qui ne vote pas ne peut pas, de facto, être candidat. Ce regard-là, extérieur, est souvent plus lucide que celui des appareils qui vivent de l’entre-soi.
Le gel électoral n’a jamais été un outil identitaire uniquement
Sa première justification est connue : protéger un équilibre fragile dans un territoire marqué par l’histoire. Mais une seconde fonction, rarement nommée, apparaît aujourd’hui avec évidence : le gel a permis à un système politique — loyaliste, autonomiste et une partie du mouvement indépendantiste — de fonctionner sans concurrence nouvelle.
Cela ne signifie pas que le gel était illégitime à l’origine — il répondait à un moment, à une nécessité — mais aucun système ne peut vivre éternellement sous cloche sans finir par se dégrader. La question n’est pas morale. Elle est structurelle.
Dans un écosystème politique où les réseaux, les habitudes et les positions acquises sont essentiels, l’arrivée d’électeurs et surtout de candidats nouveaux, formés ailleurs, porteurs d’autres standards, constitue un choc. Un système clos se protège. C’est universel. C’est humain. Ce n’est pas spécifiquement calédonien.
Les exclus du système : des citoyens qui travaillent… mais ne votent pas
Ce paradoxe est l’un des plus frappants : la Nouvelle-Calédonie compte des adjoints au maire, des conseillers municipaux, des responsables associatifs, des entrepreneurs, des gens investis, compétents, reconnus localement, qui n’ont pas le droit de voter aux provinciales.
Ils gèrent des budgets, des équipes, des dossiers complexes. Ils améliorent leur commune. Ils réparent ce qui doit l’être. Mais le système ne leur donne pas voix au chapitre quand se joue l’essentiel. Pourquoi ? Parce qu’ils incarnent ce qu’un système politique redoute le plus : la montée du niveau.
Encore une fois : ce n’est pas une accusation. C’est une logique institutionnelle. Tous les systèmes fermés fonctionnent ainsi.
Car en République, le droit commun n’est jamais une négociation : c’est six mois de résidence. Tout le reste n’est qu’une parenthèse politique.
L’exemple Descheemaeker : quand le niveau apparaît, le système s’écarte
En avril 2025, un professeur de droit, Éric Descheemaeker, expose devant 500 personnes ce que chacun pressentait sans réussir à le formuler : l’Accord de Nouméa est juridiquement arrivé au bout de lui-même. Il est caduc.
Le débat, très technique, devient enfin intelligible. 50 000 vues sur les réseaux sociaux. Le mois suivant, silence total dans les journaux télé et radio du service public. Non par malveillance : par incapacité à traiter un sujet qui dépasse les routines habituelles.
Ironie de l’époque : huit mois plus tard, ce même professeur est sollicité par ces mêmes médias pour comprendre la consultation annoncée par Paris. Le phénomène est universel : lorsque le niveau monte, les systèmes clos perdent la maîtrise du récit. Skills kill the system.
L’État a entretenu une fiction qui a figé la vie politique locale
Pendant quarante ans, par prudence ou par fatigue, la République a fait croire qu’elle n’était plus souveraine en Nouvelle-Calédonie. Que seuls les « signataires » décidaient. Que le droit commun était suspendu. Cela a permis d’éviter les conflits.
Mais cela a figé le système. Et cela a transformé le gel électoral en un mécanisme de protection institutionnelle, bien au-delà de sa raison d’être initiale. Là encore : pas de jugement. Simplement un constat.
« Le dégel, c’est la guerre » ?
Non : le vrai risque, c’est le blocage sans fin. On entend déjà l’objection : « Le dégel, c’est la guerre. La preuve : le 13 mai. » C’est l’argument ultime de ceux qui veulent prolonger la parenthèse.
Mais le 13 mai 2024 n’est pas né du retour au droit commun. Il est né de quarante ans d’exception prolongée, d’un système conçu pour ne jamais vraiment sortir de lui-même, et d’une explosion de frustrations accumulées — chez les Kanak comme chez les non-Kanak.
Dire que le dégel “crée” la guerre, c’est inverser la causalité. Ce qui nourrit la violence, ce n’est pas la norme démocratique. C’est l’incapacité à y revenir.
Refuser indéfiniment le droit commun, maintenir artificiellement des corps électoraux gelés, repousser toujours la concurrence réelle : c’est précisément ce qui fabrique des 13 mai. Le débat posé ainsi est simple : soit on considère qu’un territoire français ne pourra jamais revenir à la règle universelle “un citoyen = un électeur” sans s’embraser — et alors c’est tout le modèle qu’il faut reposer ; soit on admet qu’on ne sortira du cycle de crise qu’en assumant, tôt ou tard, ce retour à la norme, avec des garanties, des transitions, mais sans mensonge.
Dans les deux cas, ce n’est pas le dégel qui est dangereux par nature. C’est le mensonge prolongé sur sa possibilité.
Un rappel historique : la Calédonie a déjà accueilli le niveau
L’histoire calédonienne a déjà montré que le pays sait reconnaître les compétences quand l’heure l’exige. En 1940, Henri Sautot — premier gouverneur de l’Empire à rallier la France libre — est envoyé à Nouméa par de Gaulle pour assurer le ralliement du territoire aux forces alliés. Son arrivée provoque un soulèvement populaire qui fait basculer la Nouvelle-Calédonie du côté des vainqueurs.
Chassé ensuite par les rivalités du haut-commandement gaulliste, il revient après la guerre, toujours respecté, et les Nouméens l’élisent maire en 1947. Il administre la ville, la modernise, puis transmet naturellement la fonction à son adjoint, Roger Laroque.
Sautot n’était pas « d’ici ». Mais le pays l’a adopté, parce qu’il voyait en lui du courage, du niveau, du sens. La Nouvelle-Calédonie n’a jamais craint la compétence. Elle l’a utilisée pour se relever. Elle se l’est appropriée. La vie politique trouve toujours un chemin quand elle laisse entrer l’oxygène.
Le gel électoral n’est pas une question identitaire.
C’est une question de niveau — et le pays le redécouvre. Les commentaires des militants, kanak ou non, le montrent. Les Calédoniens ordinaires commencent à le percevoir. Et l’État devra tôt ou tard regarder la réalité en face : on ne peut pas transformer un territoire en laboratoire politique éternel. Revenir au droit commun, un jour ou l’autre, ce n’est pas menacer un camp. C’est remettre un pays dans la norme démocratique universelle : un citoyen = un électeur.
Ce jour-là, la Nouvelle-Calédonie ne perdra rien. Elle retrouvera ce qu’elle a longtemps su faire : accueillir le niveau, élever son propre standard, et respirer enfin hors de ses clôtures institutionnelles.
Parce qu’au bout du compte, ce n’est jamais l’identité qui souffre du retour du réel. Ce sont les systèmes qui ont cessé d’évoluer. Et les systèmes, eux, peuvent changer. Les peuples, non : ils continuent. Comme toujours.


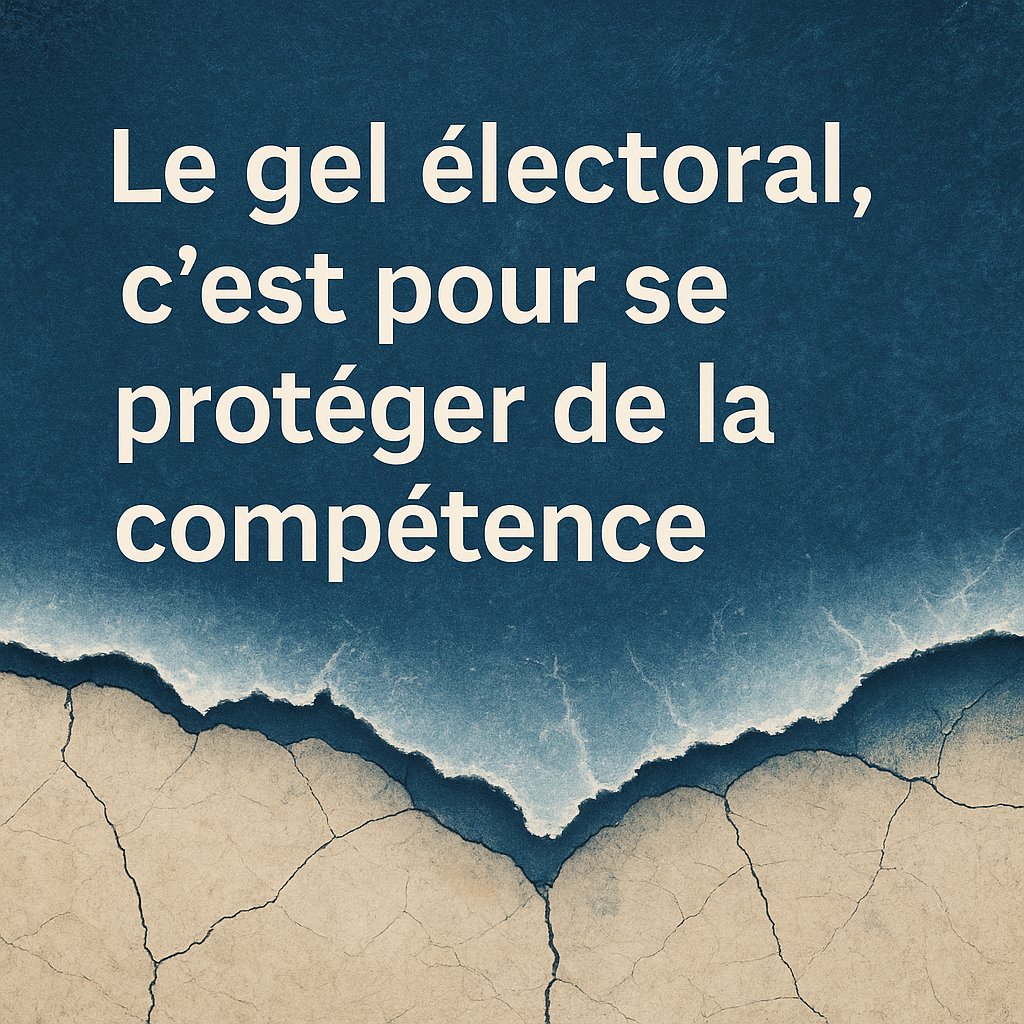










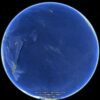





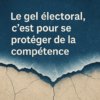
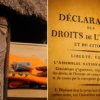























TEST
Elle est où Mémé Coconne? Elle est partie faire la cuisine en Ukraine ou bien elle est allée voir ses cousins mongoliens en Mongolie?😁😆
À moins qu’elle soit partie faire le djihad dans le Nord, tirer dans les nids de roussettes à coups de fusil à plombs… 😁😆😂
y’a pas qu’elle qui à disparue. c’est la désertion.
Un dessin humoristique pour illustrer l’actualité
Je reste dubitatif sur le sens de la réflexion que pose cet article.
La police n’est plus respectée elle est constamment provoquée par les petits gaulois https://www.facebook.com/share/r/1BXpmopjFi/
On s’en doutait un peu
Tu peux mettre du blanc sur les visages cela ne changera rien. L’armée n’arrive pas à recruter pour l’ensemble de ses offres.
Le français ne veux pas servir à l’armée, pas plus que faire serveur ou cuistot, plongeur, travailler après 19h00 etc
Oups,
je t’invite à regarder de près les images que nous avons souvent tant à la télé que sur le net, de soldats français.
Tout comme je t’invite à observer nos gendarmes ici sur place, que l’on voit toujours en nombre.
Et tu te rendras compte de quelque chose.
Je suis prêt à revenir sur ce point et y apporter quelques éléments complémentaires.
«Mali, Afghanistan… La France et ses armées ont toujours su payer le prix du sang pour défendre la nation»
Heuuuuuu
Au Mali et en Afghanistan on ne protégeais pas la mère patrie.
Guerre extérieures. On y foutais quoi.
Afghanistan guerre perdue, morts pour rien et Mali on connais la fin.
“L’armée n’arrive pas à recruter pour l’ensemble de ses offres.” Un soldat français professionnel est payé entre 2 et 3 fois moins que son équivalent allemand (qui déjà, lui-même, ne se précipite pas bcp bcp plus au portillon). Tu es assez pas trop bête (le mardi est mon jour de bonté) pour en tirer l’hypothèse partiellement explicative qui s’impose. Du moins en temps de paix. Nul ne sait très précisément comment se comporteront nos soldats -à mon humble avis héroïquement pour nos professionnels, cf les actions exemplaires de nos corps expéditionnaires inspirant toutes nos armées alliées, américaines pdt l’Afghanistan en… Lire la suite »
Il ne s’agit nullement de “défaitisme”.
Quel bla bla sur NOS soldats héroïques!
T’as jamais du faire l’armée toi.
Tu la joue à la Poutine. Faut bien payer pour qu’ils aillent se faire dezinguer!
Ou va tu à la pêche de toutes ces conneries?
Pas assez payé certes mais pension à vie dès qu’il quitte et c’est un salaire différé.
Par rapport à tous les branleurs indexés dont tu fait partie c’est vrai que ce n’est pas assez, surtout que les dits branleurs sont souvent inutiles.
Il y a du mélange dans cet article. Il est evident que le blocage du corps électoral est politique du point de vue canaque. Laisser rentrer des électeurs nouveau est une dilution de leur poids dans les urnes. C’est qu’on le veuille ou non un acte colonial dans l’esprit. Alors certains hurleront à la démocratie et à son déni mais le droit de vote ne garantie pas une démocratie. S’il suffisait de voter pour faire d’un pays une démocratie cela se saurait. Voir le merdier en métropole. Je ne suis pas en train de défendre les canaques mais ce sujet… Lire la suite »