Actualité
Le silence des coutumiers
Ils ne parlent plus. Et parce qu’ils ne parlent plus, tout le monde les croit absents. Mais leur silence est lourd. Organisé. Subventionné. À l’heure où l’on débat d’un accord sans ancrage, les autorités coutumières gardent le silence. Ce texte en déplie les raisons. Et les conséquences.
Ils sont toujours là.
Ils siègent, accueillent, transmettent, se lèvent quand il faut, se taisent quand on leur demande. Chaque année, ils reçoivent leur part. Pas volée, diront certains : c’est le prix de la paix, de la situation, de l’ordre. Mais que vaut une paix sans parole ?
Depuis vingt ans, la parole coutumière s’est déplacée. Elle n’est plus à l’intérieur des institutions que la République lui a concédées. Elle est revenue dans les cases, dans les districts, dans les corps. Le Sénat coutumier est devenu un décor : budgetisé, protégé, médiatisé. Mais sans chair. Sans nerf.
Un milliard de francs pour un silence.
C’est, en moyenne, ce que le budget propre de la Nouvelle-Calédonie consacre chaque année au maintien symbolique de la coutume dans ses rouages : ADCK, DACC, ALK, chefferies, travaux sur terres coutumières, foncier, culture. Tout est là. Sauf la voix.
Car dans les moments décisifs — ceux où se forge le destin — la parole coutumière ne parle plus. Elle se rétracte. Elle s’en remet à plus tard, ou à plus haut. Elle attend que les partis décident, que l’État tranche, que les jeunes s’agitent. Elle se tait.
Ce silence n’est pas un oubli. Il est une stratégie.
Les anciens savent. Ils voient que le processus est piégé, que les termes sont minés, que l’accord à venir ne reconnaît plus rien. Ils pressentent que parler, ce serait s’avancer sans pouvoir reculer. Et pourtant, ils se taisent. Pourquoi ?
Parce qu’ils sont vieux. Parce qu’ils sont tenus. Parce qu’ils sont tristes.
La coutume a perdu le bras, l’œil et la dent. Elle tient encore la mémoire. Mais elle n’a plus la main.
Mais ce pays est en train de la perdre aussi.
Car pendant qu’on subventionne les outils, on méprise les voix qui vivent. Le Conseil des Grands Chefs, réactivé sous le nom d’Inaat Ne Kanaky, regroupe désormais plusieurs dizaines d’entités coutumières — soit une minorité conséquente au sein des bases vivantes du pays kanak. Son porte-parole, Hippolyte Sinewami Htamumu, a parlé à l’ONU. Il a proclamé la souveraineté sur ses terres coutumières. Il a appelé à ce que la voix coutumière ne passe plus par les partis, mais par elle-même.
Rien. Aucun relais. Aucun accueil. Pas même un silence en retour.
Parce que ce silence-là, le vrai, c’est celui du système.
Ce pays ne veut pas entendre les vivants. Il veut entendre les institutions. Il ne veut pas de chefs qui pensent, il veut des instances qui rassurent. Et la coutume officielle rassure : elle ne bouge pas, ne s’oppose pas, ne propose rien.
Mais pendant ce temps, les clans parlent. Les jeunes se réveillent. Des souverainetés sont proclamées. Des paroles circulent sous le bois, hors micro.
Alors, ce texte s’adresse à eux.
Ceux qui n’ont pas encore parlé, mais qui savent. Ceux qui n’ont plus rien à gagner, mais tout à transmettre. Ceux qui ont gardé le sens, mais qu’on n’a pas invités à la table.
Le silence des coutumiers ne sera plus une excuse.
Car le silence, en politique, est un choix. Et ce qui n’est pas reconnu ne survivra pas.
Vous seuls pouvez encore dire oui. Ou non. Mais pas rien.
SIRIUS



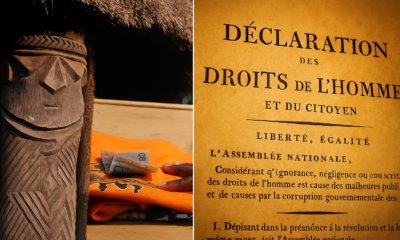
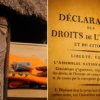










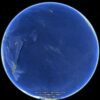








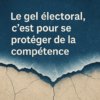




















Le coutumier Mélenchon, lui, a vite retrouvé le sourire….
https://www.youtube.com/watch?v=Zt3zId8Rd7o
Sauf qu’ Inaat Ne Kanaky n’est pas une organisation pas aussi apolitique et hors parti qu’elle le prétend mais qu’elle est une émanation dissidente du Sénat coutumier, totalement dans la ligne et la doctrine uc ccat fnlks. Avec le même discours quant aux exactions du 13 . Et le même narratif. Et pas hors micro.Modernité oblige… Comme elle l’a démontré dans sa publication du 17 mai 2024 à l’en-tête du Conseil national des chefs de kanaky qui ” apporte son soutien à la ccat …qui n’est pas un groupe terroriste ou groupe mafieux comme certains responsables politiques veulent le faire… Lire la suite »
Corrections : n’est pas une organisation aussi apolitique…- organisation sociale – sans oublier –
“Le Sénat coutumier est devenu un décor : budgétisé, protégé, médiatisé. Mais sans chair. Sans nerf.” La faute à qui ? Il ne faut pas s’en étonner. Une organisation pensée, établie, structurée à 16.732 km de Nouméa (distance à vol d’oiseau entre Paris et Nouméa), par des énarques talentueux certes mais, peu à même de comprendre l’affect de communautés aussi diversifiées que celles qui peuplent la NC dont celle d’importance pour le Pays, Canaque, qui vivait à l’âge de la pierre polie (c’est un fait établie et non une critique) lors de sa rencontre avec les premiers européens tel que James… Lire la suite »