Actualité
Le mirage du dialogue : quarante ans pour ne pas décider
On ne “poursuit pas la discussion” pour faire la paix : on décide. De Pisani (1985) à la Commission Mixte Paritaire (2025), la même méthode a enfermé la Calédonie dans un dialogue sans fin. Quarante ans de palabres, de dépendance et d’amnésie politique. La Nouvelle-Calédonie vit sous un même régime : celui du dialogue perpétuel. Il est temps de sortir du groupe de parole.
À chaque crise, on change les mots, on renomme les acteurs, on repeint le décor — mais on rejoue la même pièce : celle de la pédagogie politique qui remplace la décision par la discussion. Ce théâtre de la parole, conçu par la gauche française dans les années 1980, a transformé la question calédonienne en un métier d’État : parler pour durer, durer pour ne pas choisir.
2025 : le Parlement renomme la fin en moyen
Tout est parti d’un mot. En octobre 2025, la commission mixte paritaire a modifié le titre de la loi sur le report des provinciales : il ne s’agissait plus de « poursuivre la discussion sur l’accord du 12 juillet » – le fameux accord de Bougival – mais « de permettre la poursuite de la discussion en vue d’un accord consensuel ». Un déplacement minuscule, apparemment technique. Mais un symbole immense : la finalité disparaît, la procédure devient l’objet même de la loi.
On ne cherche plus à conclure : on cherche à continuer. Le dialogue cesse d’être un moyen de paix ; il devient une méthode de pouvoir. Le député socialiste Arthur Delaporte, à l’origine de l’amendement, l’a dit clairement : « Les socialistes seront les garants du consensus ». Quarante ans après Pisani, la boucle est bouclée : le socialisme colonial a retrouvé son réflexe génétique.
1985 : Pisani ou la naissance du paradoxe
Le 7 janvier 1985, sur la place des Cocotiers, Edgard Pisani prononce la phrase qui condamne la Calédonie à l’entre-deux : « L’indépendance-association. » Un État souverain… mais associé à la France. Un peuple libre… mais administré. Un divorce… dans une union. Une rupture… sans rupture.
C’est l’acte fondateur d’un mensonge d’État : promettre la décision tout en la repoussant indéfiniment. Pisani croyait réconcilier ; il a créé la dépendance durable. En échangeant la clarté contre la cohabitation symbolique, il a installé le principe moteur du système : plus la Calédonie simule l’indépendance, plus elle dépend de la France.
Matignon, Nouméa, Bougival : quarante ans de palabre subventionnée
Depuis Pisani, chaque génération politique a entretenu la pièce. L’Accord de Matignon, puis celui de Nouméa, puis la séquence de Bougival, ont chacun promis « l’ultime étape »… pour mieux réintroduire la suivante. La République, incapable d’assumer le verdict des urnes (trois référendums successifs), a inventé une politique du provisoire perpétuel :
– on négocie,
– on signe,
– on attend,
– on recommence.
Le dialogue est devenu le cœur du dispositif budgétaire et moral : il justifie les postes, les missions, les subventions, les médiations. Chaque report crée des emplois ; chaque “paix à construire” alimente la machine. Ce n’est plus un processus démocratique : c’est une industrie de la procédure.
Le théâtre institutionnel : acteurs, figurants, spectateurs
Dans cette pièce, chacun tient son rôle avec application :
- L’État joue la sagesse : il arbitre, finance, temporise.
Il distribue les répliques et les subventions, fait mine d’écouter, puis referme le dossier au nom du “temps du dialogue”. C’est le metteur en scène qui ne croit plus à sa propre pièce, mais continue par habitude.
- Les loyalistes jouent la loyauté : ils protestent, mais signent.
Toujours indignés, jamais dissidents. Ils se battent contre Paris le matin et posent pour la photo à l’Elysée l’après-midi. Ils incarnent la discipline du vassal : l’art de la désobéissance respectueuse.
- Les autonomistes jouent la raison du milieu : ils traduisent le malentendu en méthode.
Ce sont les régisseurs du théâtre, ceux qui rallument la lumière quand tout s’écroule.
Ils appellent cela “trouver un consensus”, mais leur vrai métier, c’est de maintenir la scène ouverte. Sans eux, la pièce s’arrêterait — et chacun devrait alors dire ce qu’il pense vraiment.
- Les indépendantistes jouent la dignité : ils refusent, mais participent.
Ils brandissent la sortie comme une promesse, tout en vivant de la troupe. Ils dénoncent la pièce, mais viennent à chaque représentation. Leur silence vaut plus cher que leurs mots : c’est le cachet du partenaire indispensable.
- Les médias, enfin, jouent le chœur antique :
Ils commentent la mise en scène, chronomètrent les entrées et les sorties, expliquent au public ce qu’il doit ressentir. Ils sont les gardiens du “moment”, jamais du sens.
Et le peuple, lui, reste dans la salle, prié d’applaudir. “La paix avance”, lui dit-on. En réalité, c’est le rideau qui bouge, pas le décor. Le “mirage du dialogue” n’est pas un échec moral : c’est une structure dramaturgique. Chaque séquence politique en produit une suivante, pour éviter l’instant où il faudrait trancher. L’État a fabriqué un système où le consensus remplace la souveraineté où la répétition tient lieu de courage, et où le verbe fait oublier le vide. Une liturgie de palabre qui tient lieu de politique.
Une économie de la dépendance
Ce théâtre a sa logique économique. Tant que le désaccord dure, les transferts continuent ; tant que l’avenir est “en discussion”, personne n’a de comptes à rendre. Les élites locales prospèrent dans le flou ; Paris y trouve la paix statistique ; les corps intermédiaires vivent de la concertation.
C’est l’équilibre parfait du mensonge : un territoire administré comme indépendant, un État présent comme absent, et une population qui ne croit plus à rien. On appelle cela du “consensus républicain”. C’est en réalité de la dépendance programmée.
2025 : la Démocratie-Assistance
Le socialisme de Pisani promettait l’indépendance avec la protection. Le macronisme de Delaporte promet la discussion avec la subvention. Entre les deux, quarante ans d’un même art : gouverner par la conversation. En 1985, on avait inventé l’indépendance-association. En 2025, on a inventé la démocratie-assistance. La même chose, mais sans illusions.
La commission mixte paritaire ne fait que ratifier ce glissement : la République ne tranche plus, elle temporise ; elle ne décide plus, elle “accompagne”. Ce n’est plus la République réelle, celle du choix : c’est celle du prolongement administratif de l’indécision.
Sortir du groupe de parole
Le “dialogue” n’a pas pacifié la Calédonie ; il l’a stérilisée. Il a remplacé la confiance par la procédure, la vérité par le récit, la décision par la pédagogie. Et chaque fois qu’un accord échoue, on invente une nouvelle table de discussion pour ne pas constater la faillite du modèle.
Tant que nous confondrons la paix avec la procédure, nous fabriquerons de nouveaux Bougival.
La seule issue n’est pas de discuter mieux : c’est de dire la fin. De choisir : Français, Kanak, libres — mais responsables. Car un peuple ne se trahit pas en un jour : il se trahit chaque fois qu’il confond le dialogue avec le courage.











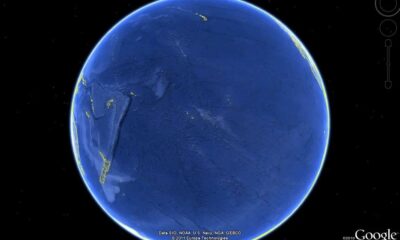
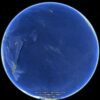




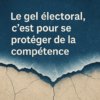
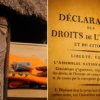























Sirius “Il est temps de sortir du groupe de parole“. Il me semble que c’est un peu tard. Je ne connais pas de décolonisation réussie ou ratée. En revanche, je connais des colonisations réussies ou ratées. Ici chez les nouzot’, les caldoches n’ont jamais voulu “faire du blanc”: dehors les zoreils, et surtout pas de pieds noirs… Ils auraient pu “faire du jaune “: on sait avec quel “empressement” ils ont essayé de faire revenir les déportés japonais ou retenir les engagés viets… colonisation ratée… Par contraste, des colonisations réussies… Australie: 4% d’aborigènes Nouvelle-Zélande : 15% de maoris. Hawaï: 10%… Lire la suite »
XYY : “Je ne connais pas de décolonisation réussie ou ratée.
En revanche, je connais des colonisations réussies ou ratées.”
Vaste sujet de réflexion.
Quelques pistes :
– l’Amérique du Nord anglo-saxonne
– l’Amérique latine
– les îles de la Caraïbe et des Mascareignes
– l’Asie du Sud-Est
– le sous-continent indien
– Fidji
– Timor Leste (en attendant Bougainville et la Western Papua)
Pour l’anecdote, dans “Cadix ou la diagonale du fou“, Arturo Perez-Reverte décrit la présence des représentants des colonies aux Cortes de Cadix pendant le siège (1810-12).
La prison la plus sécurisée de France, quelle blague! Mauvaise blague mais quelle faille securitaire, l’effondrement devant nos yeux, une clé UsB dans les mains d Abdeslam ! L homme le plus surveillé de france! Parloirs passoirs!
Mais biensûr personne n est responsable !
Mais si c’est Macron. Dis le!
C’est vrai ce que vous avez écrit et on a envie de dire que c’est à peu près la même chose au niveau de la politique nationale. La valse des ministres (avec un jeu de mot involontaire), on change, on remplace les ministres, ils parlent, ils parlent, les éléments de langage changent parfois aussi, mais rien ne change vraiment, les problèmes et le mécontentement persistent et on continue de faire croire et de croire.
C’est pire, ils parlent et font le contraire de ce qu’ils vendaient auparavant dans leurs discours.
Bravo… un résumé qui exprime parfaitement mes pensées.