Actualité
Les fils de la colère
Le 13 mai, on a brûlé Nouméa. Le 15 octobre, on viole une grand-mère au Vallon-Dore. Entre les deux, un seul fil : la fin du lien social. Et une question : combien de temps avant que le pays n’explose pour de bon ?
La scène
Une femme de 74 ans, malade d’Alzheimer, agressée et cambriolée dans sa maison du Vallon-Dore. Un adolescent de 14 ans, originaire de Saint-Louis, placé en garde à vue. Trois autres, âgés de 9 à 15 ans, relâchés après audition.
Quatre enfants dans une maison vide, à la frontière entre deux mondes : celui d’une Calédonie qui vieillit, qui s’enferme derrière des caméras, et celui d’une jeunesse qui ne s’appartient plus, livrée à l’errance, à la jalousie, au mimétisme. Ce fait divers n’est pas une aberration : c’est un signal. Le crime n’est pas une déchirure dans la toile du pays, il en est la trame.
Le visage du désordre
Chaque société produit ses monstres. Les nôtres ont 13, 15 ou 17 ans. Ils ne savent ni lire un contrat, ni se projeter dans un métier, mais ils savent forcer une porte, fracturer un coffre, menacer une vieille dame.
Ce n’est pas un hasard, c’est une mécanique. Depuis vingt ans, la Nouvelle-Calédonie fabrique à bas bruit une génération d’enfants sans destin. Les chiffres sont clairs :
- près de 300 jeunes Kanak sortent chaque année du système éducatif sans diplôme ;
- 40 % d’entre eux ne seront jamais formés ni employés ;
- 10 à 15 % basculeront, tôt ou tard, dans la délinquance répétée.
Sur dix ans, cela représente près d’un millier d’individus – le noyau dur d’une prédation sociale devenue endémique. Autour d’eux gravitent trois à quatre mille jeunes hommes, parfois complices, parfois suiveurs, souvent désœuvrés : ce sont ceux qu’on a vus sur les routes en mai 2024, parmi les 8 000 à 10 000 insurgés du 13 mai.
Un pays de 265 000 habitants ne peut absorber une telle masse d’exclus sans imploser moralement. Et pourtant, tout cela était prévisible. Tout cela a été dit, écrit, nié.
Les enfants du vide
Un jour, un député l’a dit sans détour :
“Voler, c’était un jeu. Jouer avec la police, faire la nique au système.”
Cette phrase d’Emmanuel Tjibaou, enregistrée sans provocation, devrait figurer dans les manuels d’histoire. Parce qu’elle dit tout : quand l’autorité disparaît, le vol devient rite d’initiation, et la haine sociale, un jeu d’enfant.
La délinquance n’est pas qu’une question de morale — c’est une question de structure. Ce qui a remplacé l’école, ce n’est pas la coutume. Ce qui a remplacé la coutume, ce n’est pas l’emploi. Ce qui a remplacé l’emploi, c’est la rue.
Et la rue, ici, ne forme plus des citoyens : elle forme des soldats du ressentiment. Non pas des “émeutiers politiques” — des prédateurs symboliques. Ils volent, violent, brûlent, sans but collectif, sans projet, sans doctrine. Ils frappent le premier corps faible à portée : un commerçant, un vieil homme, une femme isolée.
La guerre sociale invisible
On veut croire qu’il s’agit de dérapages, de “faits divers isolés”. Mais il n’y a rien d’isolé dans un système qui produit le même scénario chaque semaine : un cambriolage à Dumbéa, un guet-apens à Saint-Louis, un viol au Vallon-Dore, une voiture brûlée à Koné.
C’est le même territoire mental : celui d’un pays où la pauvreté se vit comme une vengeance. Ce n’est pas “la culture kanak” qui dérape — c’est la République qui a abdiqué. En se croyant protectrice, elle a désarmé. En prétendant “réparer”, elle a entretenu la dépendance. Et en refusant de nommer les choses, elle a laissé la misère devenir une identité.
Le chiffre et la peur
A la prison du Camp-Est, 600 détenus pour 400 places :
- 95 % d’origine kanak.
- 60 % de récidive.
Chaque sortie prépare un retour. Ce sont les mêmes visages, les mêmes prénoms, les mêmes parcours. Un cycle fermé, où l’État ne rééduque plus : il recycle. Le tout pour 1 000 à 1 200 individus seulement — 1 % de la population totale, mais 100 % du désordre quotidien.
C’est ce 1 % qui fait peur à 99 % des autres. Pour la grande majorité des faits, c’est lui qui est responsable du millier d’appel d’urgence que la gendarmerie reçoit chaque jour. Et c’est lui qui dicte désormais la géographie de la peur : les portails électriques, les chiens, les alarmes, les grilles.
L’autre fracture
La Nouvelle-Calédonie est entrée dans une phase post-politique : le clivage n’est plus entre indépendantistes et loyalistes. Il est entre ceux qui travaillent et ceux qui pillent, entre ceux qui entretiennent le pays et ceux qui le dévorent.
Le reste n’est que théâtre. Les élus jouent à Paris, les institutions prononcent des “vœux”, votent des “pactes” et des “chartes”, pendant qu’à Vallon-Dore, une vieille dame se fait violer dans son sommeil.
La leçon
La République a cru pouvoir “acheter la paix” en distribuant des transferts. La Calédonie a cru pouvoir “acheter la cohésion” en multipliant les aides. Les deux ont fabriqué des assistés furieux, c’est-à-dire des esclaves sans chaînes.
Ce que ce crime révèle, ce n’est pas une aberration : c’est la conséquence d’un modèle qui s’effondre. Celui où l’on paye les uns pour qu’ils ne se révoltent pas, et où l’on pardonne aux autres pour qu’ils ne se sentent pas coupables.
Le seuil
L’adolescent de Saint-Louis ne connaît ni la République, ni la coutume. Il connaît la force, la peur, la honte et la rumeur. Il n’est pas “la cause” du problème — il en est l’enfant.
Mais ce qu’il a fait, ou cru pouvoir faire, nous oblige à regarder la vérité : ce pays est assis sur une poudrière démographique, éducative et morale. Ce n’est pas une question d’ethnie. C’est une question de seuil.
Et nous venons de le franchir.





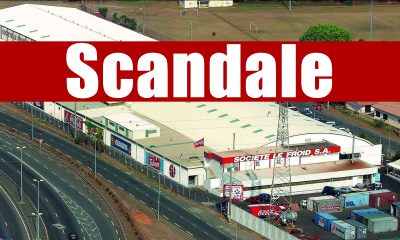

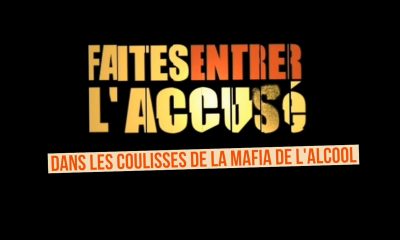











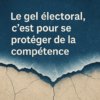
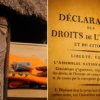























.
Marion nous dit la vérité sur qui est Rima Hassan https://www.facebook.com/share/r/1BWBvLtbMa/
Les fils de la Kanaky https://ladepeche.nc/2025/10/21/tensions-extremes-a-belep-violences-en-mer-et-rupture-des-echanges-entre-clans/
Lemec Dici.
“violences-en-mer“.
Je vous dis pas s’ils avaient des ULM ou des drones 😂
ou pire encore, des boules de pétanque.
Inforétif.
“ou pire encore, des boules de pétanque“.
Ça, ils doivent déjà en avoir des tas.
Et lancées d’un ULM ou d’un drone, ça serait pas mal.
Une forme de pétanque extrême ®FFPE.
Comme dit le proverbe, si tu veux la paix prépare la guerre.
” si tu veux la paix…” Certes mais en l’occurence il n’y a qu’un groupe d’individus minoritaires et incohérents dans leurs déclarations publiques qui préparent constamment la guerre sans jamais vouloir la paix ! Et n’en sont pas à une contradiction près. Hurlent à la mort pour dénoncer la ” ” déportation “de leurs prisonniers politiques ” et réclament leur ” rapatriement ” sur leur terre ancestrale …mais dont le “chef de guerre ” , alors qu’il se voit offert la possibilité de ce retour sur un plateau d’argent , ne semble pas finalement si pressé que cela de rentrer… Lire la suite »
[Coconne] “alors qu’il se voit offrir la possibilité”
C’est comme “addendum”… tu sais? Un “additif” c’est quand tu mets du rhum dans ton café le matin.
[@Pépé Concon, le “Jimmy Page” de la vallée des couillons]
Tiens, mon con… “spéciale dédicace”. De rien.
… ” additif ….” Sinon mon “kong” va voir les différents sens de ce mot et ne t’arrête pas au sens premier du terme ! Faut tenir ton écran à l’endroit quand tu lis des renseignements sur Wikipedia. A supposer que ton dicco du net ne soit pas trop rudimentaire ! Autre sens de ce mot additif utilisé en francais, comme le mot latin, peau de nouilles : texte, article ajouté…etc. etc. Et c’est le blaireau qui s’exprime comme un charretier et qui ne comprend rien aux citations qu’il cite qui vient donner des lecons de langage en citant des… Lire la suite »
Un seul “C” à “dico”, Coconne… tu disais?😁😆
“Et ké ke quoi qui vient faire” quoi dans quel sujet, Coconne?
Toujours aussi brouillonne Coconne…
Tiens, tahu? Y’a un film sur Springsteen qui sort au cinéma… tu crois qu’ils expliquent comment il recrute des chauffeurs de salle pour lui demander des chansons convenues à l’avance pour les reprendre parce qu’il n’en n’a pas assez écrit lui même en 21 albums studio et plus de 50 ans de carrière?
On s’en fout d’un seul C ou pas à “dic[c]o mon gars, d’autant que c’est un mot familier! Je peux même écrire “diko “sur le net si je veux,je ne vais pas avoir d’ennui avec Wikipedia,alors cette coquille … “Toujours aussi brouillonne…” ? Ben on te vois à l’oeuvre: encore Springsteen, surnommé le “Juke Box humain” dans le magazine Rock &Folk ? Même réponse! Il a même repris AC/DC dont tu disais que cette idée était absurde ! Je te renvoie au lien dejà fourni sur les plus célèbres reprises de standards des autres par B.Springsteen, artiste dont je me… Lire la suite »
Bravo Coconne, tu as bien travaillé, tu as fait des recherches, et reporté consciencieusement tes copiés/collés en les modifiant de manière à ce que le texte paraisse être de ton cru. Beau travail. (Si si.) C’est pas Concon qui serait capable de ça, hein Concon? Je ne vois pas en quoi reprendre AC/DC en Australie à la demande d’un fan australien est “absurde”… au contraire c’est le genre de challenge qu’il aime bien relever… tu te fais des films, Coconne, je n’ai jamais écrit ça. Le muscadet? CEPENDANT, COCONNE, tu n’as toujours pas répondu à ma question: “Comment fait Bruce… Lire la suite »
RS [do, ré, mi, fa, sol, la ,si [do] et ensuite ?] “Je ne vois pas en quoi reprendre AC/DC en Australie à la demande d’un fan australien est “absurde”… au contraire c’est le genre de challenge qu’il aime bien relever… “ ??? Penses – tu sincèrement [à moins que tu n’y connaisses rien à la Musique, ce dont j’en suis certain] que des musiciens professionnels (y compris Bruce Springsteen lui-même) puissent au débotté, sans avoir effectuer un minimum de répétitions tous ensembles auparavant, interpréter une musique fusse t’elle même aussi “simpliste” que celle d’AC/DC ? Un peu téléphonée cette reprise, lors… Lire la suite »
“ce dont j’en suis certain”??? Bravo Cocon, à cause de toi un Bescherelle vient de se suicider…
Bein si justement, mon con… c’est sa marque de fabrique, en fait, à Bruce et à ses amis avec qui il joue depuis plus de 50 ans (enfin, ceux qui sont encore vivants)…
Et tu sais comment il fait? Il est OR-GA-NI-SÉ… (Oui Coconne, couché!)😁
Moi, je sais comment il fait, comment il s’organise… mais je ne te le dirai pas… cherche un peu, tu connais un truc qui s’appelle “Google Chrome”?😁
“Assume un peu” ?A quel sujet? ” Ce mot finalement je vais toujours l’écrire DIKO,en vertu des pouvoirs que je décide de me conférer et j’assume complètement ! Ça n’intéresse personne ici. Sinon, le “Juke -box humain “il n’a pas fait que reprendre des standards des autres en concert , “ahuri [in]fini” , il en a même enregistrés !Dont des reprises de morceaux de Pete Seeger à qu’il a consacré ,cf article dans Rolling Stone du 23/09/21 ,un album entier le E Street band qui est selon cet article le plus célèbre ” cover band”de ce genre musical comme dejà… Lire la suite »
RS [le musicologue du Zinc] Tu veux jouer à celui qui… le plus loin : Sans mettre en doute la popularité de Bruce Springsteen (aussi bien aux USA que dans les restes du Monde) et la qualité de sa musique, 21 albums studio de produits selon toi mais, c’est rien à côté du géantissime Johnny Cash qui donnait (à quelques notes près 👀) dans le même style de musique : 67 albums dans sa carrière. Certains médias, spécialisés dans le genre, avancent même plus de 100 (si l’on compte aussi des sorties posthumes) ! Go ahead, make your day unforgettable… Lire la suite »
Celui qui veut toujours pisser le plus loin, Concon, c’est toi… tu as toujours ce besoin d’étaler ta science, de ramener ta fraise, de nous faire des exposés… regarde toi, un peu, abruti… 😆😂😂🤣 Et celui qui se prend pour un “fin musicologue” c’est également toi, mon con…. rien que ton pseudo, tocard… 😁😆😂 J’expliquais un truc à l’autre conne, en précisant que Bruce a réalisé 21 albums studio… OK, donc “Bruce a 21 albums studio à son actif”…Et là, MON CON arrive en couinant “Ouais mais Johnny Cash il en a fait 67 gnin gnin gnin…”… et alors???? 😁😆😂… Lire la suite »
“Et alors “? Ben et alors nous aussi on sait compter et pas que jusqu’à 21 !🤣 “On se tape du nombre d’albums que machin ou truc a bien pu faire, c’est pas la question crétin de la Ouitchambo…”dis-tu? Si on s’en tape et si c’est pas la question, le descendant des Alouates, immigré du bled de nulle part ,OQTSC ( dans l’obligation de quitter le territoire du site de Calédosphère ) qu’est – -ce que tu viens depuis des jours nous ” em… …der” avec celui du “Juke-Box humain milliardaire”? 🤯 “JCVD”? Même ses réparties à côté des tiennes… Lire la suite »
“Gnin gnin gnin”… oui Coconne, et tu voulais en venir où?
Tu avais quelque chose à dire, ou c’était juste un bon “Gnin gnin gnin” pour agresser? 😆😂😂
Pour “agresser” en citant tes “gnin gnin gnin,”?
HAHAHAHA!
Tu ne serais donc qu’une petite chose fragile, Rocky le petit Rikiki qui se sent “agressé ” par ses propres puérilités ?
C’est bien toi , n’est ce pas, hein,qui a prévenu qu’on ne savait pas à qui on allait se mesurer et qu’on allait le voir?
On voit ! 🤣
“… tu voulais en venir où?”
Visiblement là! Mais tu n’as visiblement pas encore bien capté pourquoi!🤣😂
“C’est bien toi , n’est ce pas, hein,qui aS prévenu qu’on ne savait pas à qui on allait se mesurer et qu’on allait le voir?” Heeiiiin??? Tu délires, Coconne la pocheTronne… j’ai jamais dit ça… pas mon genre d’abord, on dirait du LeZob, plutôt… Visiblement tu en fais une affaire personnelle, c’est devenu une obsession, agresser les gens à coups de “Gnin gnin gnin” et de “gna gna gna”… tu te crois dans un ring de boxe, ou dans une arène comme Pépé Concon qui se rêve homme d’action?😁😆😂 Et tu sombres dans la paranoïa, Coconne, tu te sens persécutée, on… Lire la suite »
Visiblement t’as un problème de ” con- centration ” car le seul qui utilise les, je te cite ” Gnin gnin gnin et gna gna gna “🍼👶 comme tu viens encore de le faire et comme tout le monde peut le lire dans tes commentaires, c’est toi !😂 “Tu sombres dans la paranoïa ” MOUHAHAHAHA La para n’a quoi ? 😂 “On est méchants avec toi ?” Ça fait beaucoup de méchants avec “on” si tu mets un S!😂 Sinon ton image que tu as déja postée, est stupide dans sa légende et comme d’habitude le tout très très niais!… Lire la suite »
“Mais tu [Si Crado] n’a visiblement pas encore bien capté pourquoi ! “
Si Crado, champion incontestable du “narcissisme malfaisant “, comme Trump.
Mais heureusement parfaitement inoffensif, contrairement au potentat américain.
Trump est-il un dangereux psychopathe ? Un psychiatre révèle le profil psychologique du président américain
Hé, salut Monconrétif! Il est bon ou quoi, zorbak? Alors? T’as passé une bonne soirée tout seul à picoler devant ton PC? Ou bien tu es allé au bistrot tchuquer avec tes potes pochetrons comme toi? Encore heureux que je suis inoffensif, Coconnet… on est sur un obscur petit blog de Nouvelle Calédonie (“la plus grande cour de récréation du Monde”) lu par moins de 30 personnes, où interviennent 12 internautes*, dont trois fieffés pedzouilles… 😆😂 Tiens, je te colle un bon point, pour te remercier pour le lien. *Coconne elle aime bien ce mot, hein Coconne? Concon aussi il… Lire la suite »
“Encore heureux que je suis inoffensif, Coconnet… on est sur un obscur petit blog de Nouvelle Calédonie”
Tu es “inoffensif” sur calédosphère, benêt à qui faut tout expliquer !
Et n’est-ce pas précisément ce que j’ai écrit, Coconnet le décérébré, de lancer de poids agrégé?😁😆
Inforétif : “Si Crado, champion incontestable du “narcissisme malfaisant “, comme Trump.
Mais heureusement parfaitement inoffensif, contrairement au potentat américain.”
Psychologie.com : “Trump est-il un dangereux psychopathe ? Un psychiatre révèle le profil psychologique du président américain”
Article de vulgarisation de Cécilia Ouibrahim, toutologue (ascendant psycho) de service capable d’éclairer l’internaute moyen sur un peu n’importe quoi :
https://www.psychologies.com/auteur/c-ouibrahim
Par contre sur le pervers narcissique que tu encenses depuis huit ans, il y a du lourd :
https://www.youtube.com/watch?v=SNFNTPjT_Hs
Interview (29/09/2024) sur BLAST de Marc Joly, chercheur au C.N.R.S. pour son ouvrage récent : “La pensée perverse au pouvoir“
“Article de vulgarisation de Cécilia Ouibrahim, toutologue (ascendant psycho) de service capable d’éclairer l’internaute moyen sur un peu n’importe quoi “ Exact. Mais de là à faire de Trump un modèle de droiture, d’équilibre mental et de réussites diplomatiques… Selon lui, il a en toute modestie déjà mis fin à 8 guerres en 8 mois (comme si le Hamas ayant maintenant relâché tous ses otages, Israel n’allait pas en “profiter” pour finir le boulot de son extermination …) Là il attaque la neuvième, combien de jours ça va tenir son blocus des exportations d’hydrocarbures russes sous les flatteries de ton… Lire la suite »
J’espère bien qu’ils vont finir le boulot, merde alors… c’est pas des zoreils, c’est le Grand État d’Israël… Ils ne se laissent pas emmerder, eux…
Les 2 plus grosses têtes de con du moment :
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1D6Fat.img?w=768&h=432&m=6&x=286&y=102&s=654&d=170
Ils ont élevé (pas “éduqué”, “élevé”) deux générations de gamins dans la haine de la France, la haine du système, la haine des blancs… en Mai 2014, après les avoir chauffés à blanc pendant des semaines ils les ont lâchés… vous connaissez la suite…
On remarquera quand même qu’ils n’ont pas brûlé tout Nouméa, ils se sont attaqués à leurs voisins, des gens un peu moins pauvres qu’eux, par contre les beaux quartiers des très riches n’ont pas du tout été touchés; combien de maisons, combien de commerces brûlés à Tina Golf, à l’Anse Vata, à la Baie des citrons?
Quelle envolée lyrique ! C’est Françoise Pignon qui t’as écrit le discours ! Tu sais parler autrement que par des images de western avec des fusils à la Kong ? Sinon le Rocky, il n’ont pas brûlé des ,”belles maisons ” (?) mais ils ont brûlé des écoles , des églises, des dispensaires , des centres de soin, des lycées, des pharmacies ,des entreprises, des commerces, détruit des infrastructures publiques, des agences de la poste , des routes,des trottoirs, dans ,” tout” Nouméa, et dans le grand Nouméa et dans bien d’autres communes sur tout le territoire de notre archipel… Lire la suite »
Tu souffres du manque, Coconne, détends, toi, prend un petit verre de muscadet… Oui, ils ont brûlé des écoles, des commerces, des maisons… si tu savais, Coconne, si tu savais… Ils ont tué des gens Coconne, un de mes amis, si tu savais… Mais les belles maisons des gens vraiment riches… tu sais, ceux qui ont fait fortune en massacrant les montagnes, en arnaquant tout le monde, etc… ces maisons là elles n’ont pas brûlé… C’est toujours comme ça Coconne, partout dans le monde, quand les pauvres se mettent en colère ils ne s’attaquent pas aux vraiment riches, ils s’attaquent… Lire la suite »
PS: Les “images western” et les fusils, les gros mots, tout ça, c’est UNIQUEMENT avec Concon, Coconnet et toi, Coconne… je me mets à votre niveau…
Hein, madame la taoui de fougère qui tire les roussettes au fusil a plombs? Ou au bibiche? Je sais plus… 😂
Complètement crétin ton ” récit”! Treize personnes sont mortes,sinistre individu dont deux gendarmes et deux adolescents. Et ne parlons pas des nombreuses victimes parmi les FO . Ni celles décédées au sein de la population fautes de soin, ni des enfants privés d’école tous milieux confondus. Les maisons des gens riches elles n’ont pas brûlé (?) mais leurs entreprises permettant aux gens de travailler et de nourrir leur famille ? ” Ceux qui ont fait fortune en attaquant les montagnes en arnaquant tout le monde ?” Comme un certain arnaqueur en PN et sa doctrine Nickel gagnant gagnant qui n’a… Lire la suite »
Bein voilà, qu’est-ce que je disais, deux ou trois petits verres de pif et Coconne est de retour, toujours plus hargneuse, toujours plus conne…
mon ami fait partie des victimes collatérales, sa mort a été comptée comme accident de la circulation, je n’en dirai pas plus par égard pour ses proches.
Au fait, tu sais quoi, Coconne? nous aussi on était là… pas besoin de nous faire le récit de ce qui s’est passé… tu vas pas t’y mettre toi aussi, non?😁😆😂
Tu fais quoi à Mathias Chauchat, woinrue de tribu? 😂🤣🤣😁
Staki le blog??!! Koutchii!!
“Je n’en dirais pas plus par égard pour ses proches ” Au milieu d’un flot de paroles décousues et de bêtises du style de ce que tu viens d’écrire : “woinrue de tribu, Staki le blog , Koutchii !”? Tu appelles cela par “égard ” ! Moi, si ” ami décédé” et si ses proches il y a (?) , je te dégagerais de chez moi avec un magistral coup de pied au matricule arrière histoire de te remonter le cerveau à sa place et je porterais plainte contre toi pour oser évoquer ainsi la mémoire d’un soi- disant ami… Lire la suite »
FERME TA GUEULE ESPÈCE DE CONNASSE!!
il y a une mère qui pleure son fils, un homme qui pleure son frère…
Même une truie croisée cochon d’Inde de woinrue de tribu devrait pouvoir comprendre ça!!!
” …devraitpouvoircomprendre ça.”Y a rien à comprendre bougre d’âne dans ce discours scabreux qui n’a aucun sens et est totalement déplacé et honteux par rapport au ” vrai sujet “!
C’est à toi que l’on devrait couper définitivement le sifflet sur ce site du 🌰!
Débarrasse nous le plancher avec tes propos totalement décalés et déjantés!
Ton imagination débridée et schizophrénique est totalement hors sol !
AHURI . Faut arrêter de fumer ta moquette. Crétin très crade du net.
Ferme ta gueule connasse (bis).
Je ne fume pas… toi tu picoles par contre et tu agresses les gens, puis tu essaies pitoyablement de faire passer ça pour de l’humour, on dirait un gamin de 5ème…
Et ce dont je parle plus haut est TOTALEMENT en rapport avec le sujet, au contraire, j’ai perdu un ami en mai l’année dernière, “victime collatérale” de la folie des kahouins de la CCAT.
Tu as quelque chose à redire à ça, sombre connasse????
” Tu as qq chose à dire etc ” Oh que oui mon pauvre gars, à REDIRE : on n’évoque ni ne déplore la supposée mort d’un ami en le faisant à l’intérieur d’un commentaire délirant et vulgaire parsemé de mots grossiers sur un site public : c’est totalement irrespectueux envers cette personne décédée et sa famille sinistre crétin , par principe d’ailleur fait authentique ou pas ! Et idem : tout ce que tu mériterais, internaute au cerveau reptilien – même pas un gamin de 5eme n’écrirait cette fiente – c’est qu’ils te fassent couper ta chique une fois… Lire la suite »
“Rocky Siffredo Répondre à Minie 20 octobre 2025 21:26 Tu souffres du manque, Coconne, détends, toi, prend un petit verre de muscadet… Oui, ils ont brûlé des écoles, des commerces, des maisons… si tu savais, Coconne, si tu savais… Ils ont tué des gens Coconne, un de mes amis, si tu savais… Mais les belles maisons des gens vraiment riches… tu sais, ceux qui ont fait fortune en massacrant les montagnes, en arnaquant tout le monde, etc… ces maisons là elles n’ont pas brûlé… C’est toujours comme ça Coconne, partout dans le monde, quand les pauvres se mettent en colère… Lire la suite »
PS: Pour info, je continue à bien rigoler Coconne…
Toujours aussi conne, hein coconne?! 😂🤣
“Pour info je continue à bien rigoler Coconne…”
Pour info,nous aussi mon “Kong!”🤣
Mais au vu de ta réponse, je ne suis pas sûre que dans ton cerveau embrumé 🤯et délirant tu en aies bien compris la raison !
” Toujours aussi Conne hein,Coconne “?
Et toi toujours aussi bourricot, hein, le Rocky Siffredo alias le guignol de l’info ! MDR .
PS: même conseil arrête de fumer ta moquette et un 🍷ça va, 🍷🍷bonjour les dégâts !
Comme dit précédemment, Coconne, je ne fume pas… par contre ton alcoolisme t’empêche de vite comprendre les choses… qui ça “nous“, au fait? Tu n’as pas répondu à ma question sale vieille conne méchante, où dans mon commentaire du 20 octobre 2025 à 21:26 ai-je écrit le moindre gros mot?, je cite: “un commentaire délirant et vulgaire parsemé* (lol) de mots grossiers“ Et donc qu’est-ce qui a fait que tu t’es crue autorisée à te gausser de la mort de mon ami ESPÈCE DE VIEILLE CONNASSE MALFAISANTE???!!! Visiblement ça n’est pas que d’alcool que tu manques… 😒 *Moi j’aurais écrit… Lire la suite »
RS [le sociologue du zinc] “partout dans le monde, quand les pauvres se mettent en colère ils ne s’attaquent pas aux vraiment riches, ils s’attaquent à d’autres un peu moins pauvres qu’eux…” ??? Quelle puissante analyse tu fais de ce qu’il s’est passé en NC et particulièrement, dans le Sud du Pays, dans le grand Nouméa en mai de l’année dernière ! Tu n’en rates pas une triste benêt. A ton avis, “les pauvres” et “les moins pauvres qu’eux”, du Pays, dans quelle mouise se trouvent ils désormais, après que quelques centaines d’écervelés de ces mêmes “pauvres”, dont “la colère”… Lire la suite »
LeZob [La ceinture noire de Cobol, l’homme d’action du clavier, le romancier de Google-Chrome, l’homme à la table basse-faisant-foi] Eh bein quoi mon con? Combien de maisons brulées à la BD, à l’Anse Vata, à Tina Golf? Ta tartine, là, elle démontre quoi? Tu te regardes écrire une fois de plus, tu enfonces des portes ouvertes, tu te gargarises de mots compliqués pour te donner un genre… (“janissaires”, “caciques”… tu l’aimes bien celui-là, “cacique”, hein mon con?) Cherche la définition de “janissaire” dans Google (“Chrome”), mon con… et tu en profiteras pour chercher celle d’une “image d’Épinal” pendant que tu… Lire la suite »
” Tu veux bien nous dire Coconne où tu vois un commentaire délirant et vulgaire parsemé de mots grossiers ” Ben juste en dessous mon gars et AUJOURD’HUI , le 21octobre 25: R.S. répondre à Minie 21 octobre 25 à 17:36 : ” Ferme ta gueule Connasse (bis ) folie des kahouins “….etc Laquelle Minie a répondu ce 21 octobre 25 à 17:58 à ce commentaire : “un commentaire délirant et vulgaire parsemé de mots grossiers “qui comme tout lecteur potentiel peut le constater était donc une réponse de ce jour à ton commentaire redondant ( d’où ton bis )… Lire la suite »
Additif : tu es complètement ” “perché”mon pauvre gars ! Tes commentaires haineux, racistes et immoraux sont navrants et ne servent en rien la cause des habitants de la NC qui toutes communautés et classes sociales confondues n’aspirent qu’à vivre en paix dans le respect mutuel des droits des uns et des autres et de celui des règles du vivre ensemble. Ton discours ne vaut pas mieux que celui xénophobe, raciste ,exclusif des extrémistes indépendantistes et de leurs” gros bras ” qui ont tout intérêt à cultiver cet antagonisme pour continuer à exister politiquement . Débarrasse nous le plancher de… Lire la suite »
Inutile d’essayer de te rattraper en nous la jouant “moi je ne veux que la paix je suis bienveillante, toutes communautés confondues tralala lalère, le respect mutuel des droits des uns et des autres à s’enfiler librement et du vivre ensemble en mangeant des omelettes jambon-fromage le jour du Shabbat“… tu t’enfonces, Coconne…😁😆😂
Et c’est pas “additif”, Coconne, c’est “addendum” (pluriel “addenda”), quel genre de secrétaire navrante as-tu bien pu être? 😁😆😂
Coooooconne…. 😆😂😂🤣🤣
La vérité si tu mens? Dégage nous de là, débile du net avec tes images stupides. Et comme dirait Platon,va te faire voir chez les Grecs et plus si affinités. IMBÉCILE de service de Calédosphère.
On n’en a rien à foutre de.tes délires. Casse -toi pauvre pomme.
FAUX, FAUX, FAUX… tu t’enfonces, Coconne, méchante vieille femme hargneuse et frustrée… j’ai partagé en termes policés mon sentiment au sujet de la tragédie de Mai 2024 et des semaines qui ont suivi, de la tentative d’épuration ethnique et du saccage de notre économie, et de la détresse dans laquelle nombre de mes proches ont été plongés, j’ai exprimé ma douleur au sujet de mon ami tué… et toi tu t’es ouvertement moquée de moi ESPÈCE DE VIEILLE CONNASSE MALFAISANTE!!!!! Se moquer de la mort d’un homme, un fils, un frère, un ami… QUELLE HONTE!!!… 😠😡🤬 Et tu peux me… Lire la suite »
On s’en fout! Tu veux qu’on te le traduise en anglais ! Va vomir tes délires et tes imbécilités ailleurs ! Dégage de ce site et emporte tes élucubrations schizophréniques avec toi.
“En termes policés “?
Comme ” VIEILLE CONNASSE MALFAISANTE ” ou comme ton expression redondante “caldoche de fin de race “?
“Tentatives d’épuration ethnique”?Tu es bon à enfermer ! Et si avant de faire ta petite valise on t’en collait virtuellement un de terme policé entre les deux oreilles histoire de “purifier” ta cervelle du gros marigot cacateux qui l’encombre?
Toi le chemin de ton Karma il est tout tracé : ➡️🚮
Il est grand temps que tu sois viré de ce site.
Boooonjour Coocooooonne!!
Bein oui Coconne, en termes policés… et je n’ai fait que répondre ensuite à ton odieuse méchanceté… se moquer de la mort d’un homme, tu n’as pas honte, vieille connasse malfaisante???
‘”Tu n’as pas honte … vieille con… …asse “? Non, pas du tout et encore moins avec TA formule ” policée”de conclusion. Toi c’est ” au trou ” que tu devrais finir, le” délinquant du net” . Tu ferais mieux de faire gaffe et te faire définitivement oublier. Les medias ont encore diffusé ce matin le communiqué officiel du Procureur de la République.Les appels incitant à la violence et les propos délictueux à caractère raciste -sur les réseaux sociaux ils sont nombreux en ce moment en NC- font et feront l’objet de poursuites . D’où qu’ils viennent. Et on peut… Lire la suite »
“Gnin gnin gnin gnin gnin”… Ça va mieux?
J’espère qu’un jour un de tes proches mourra de mort violente, et que des connards de ton acabit se foutront de ta gueule.
” Gnin gnin gnin gnin gnin ” ça va mieux” ?MOUHAHAHA! Toi pour qq d’accablé par le deuil t’as l’air en super forme ! ” j’espère qu’un jour un de tes proches mourra de mort violente etc etc “. Oh le vilain fin méchant! Fais gaffe , Jésus ton sauveur va pas être très content ! Là où il est, à supposer que ce soit ” authentique “, mon pauvre diable , il doit se retouner dans sa tombe ” ton proche ” en lisant tes publications et en constatant que tu parles de lui dans un même commentaire –… Lire la suite »
Où ça une éloge funèbre, Coconne? J’exposais des faits, mais comme d’habitude tu n’entraves rien, et tu te mets à blatérer. Je persiste, “une truie croisée cochon d’inde woinrue de tribu”, la question est quelle genre de taoui? Taoui de fougère, ou taoui de bord de mer? Le reste… “gna gna gna”, ok rien de nouveau… Tu seras réincarnée en chien kanak, dans une tribu où tu te feras martyriser par de petits kahouins cruels comme seuls eux savent l’être, et tu crèveras dans un caniveau, shootée par une bagnole, ou de maladie car bien sûr tout au long de… Lire la suite »
Toi t’as dû faire de multiples chutes de🛴 sans porter de casque enfant!Dur dur le récit! C’ est pas que la moquette de ton appart que t’as fumée ! C’est celle de tous les apparts de l’immeuble vide de leurs occupants , les derniers de tes voisins, tes locataires fonctionnaires zoreilles au salaire scandaleusement é levé avec index et avantages divers s’étant ” tirés ” dès qu’ils ont pu le faire, et trouver un logement tout aussi bien voire mieux surtout en terme de voisinage et moins coûteux niveau loyer! Ben tant pis ! Tes revenus ont baissé mais la… Lire la suite »
Détends toi Coconne, tu es en manque, sers toi un verre et fais un tour dehors en respirant bien par le nez…
Voiiiiilà… gentille, Coconne. Couché.
Tu radotes compĺètement “papi konkong” tu racontes toujours les mêmes sornettes…les verres c’est toi qui en uses et abuses..souviens- toi ,un 🍷ça va, 🍷🍷bonjour les dégâts !
Le slogan (que manifestement tu n’as pas retenu, car sûrement pas écouté, et certainement pas mis en application) c’était “Un verre ça va, trois bonjour les dégâts”
C’est l’alcool qui fait ça, Coconne, tu ne te rends plus compte des conneries que tu dis, ou que tu écris… et ça ne va pas aller en s’arrangeant avec l’âge…
Tu t’avances sur une pente savonneuse, Coconne… as-tu songé à en parler à quelqu’un? Il y a des gens prêts à t’aider, sais-tu?
[Tadammm! Shitstorm in 5 – 4 – 3 … 😆😂😁]
“[Tadammm Shitstorm in 5,4,3 …” HAHAHAHA! Et t’arrives à compter à rebours qu’à partir de 5 et que jusqu’à 3? Ton “shitstorm ” c’est un tout petit petit 💩, pas de quoi déclencher une alerte sur le net ! “Il y a des gens prêts à t’aider sais-tu ?” Comme avec un ” totem d’immunité”? Avec toi il n’a pas l’air d’être très efficace ! Et LE slogan “c’était un verre ça va ,trois bonjour les dégâts”? Ben toujours pas mon gars pas LE mais UN des slogans ! Car des slogans y en a eu et y en a… Lire la suite »
10H50, Coconne a trouvé l’inspiration, elle va répondre du tac au tac… Tadamm!! (enfin, façon de parler, avec 14 heures de décalage… c’est du “tac… aaauuuuuuu….. tac” façon “taoui de bord de mer”)
C’est pas “ton” shitstorm, Coconne, “storm” ça veut dire “tempête”… Du coup, (comme dirait XYY), on dit “ta shistorm”
Trois verres pour toi c’est en début de soirée, avant de dîner?
Ou c’est plutôt à l’apéro avant le déjeuner?😁😆😂
AMHA (comme dit Concon) c’est les deux… 😂🤣
AMHA, toi y pas d’heure !🤣
Cadeau, 2ème réponse: “C’est pas ton shitstorm ,storm ca veut dire tempête ! “Bravo champion! C’est pour ça que j’ai dit ” une” tempête .🤣 Mais shit ça veut dire “un” “merdier” ! Et comme en français ( d’ailleurs RAF car c’est un mot anglais ) le masculin l’emporte sur le féminin, du coup, comme je dis et comme beaucoup le disent aussi 🤣, on ne dira pas du tout” ta” mais ” ton ” shitstorm” et de toutes les façons ,ce sera toujours très kong de se poser la question! Les 2 font la paire de nouilles comme toi… Lire la suite »
Bein non Coconne “une” shitstorm… logique… après la logique, pour une pocheTronne qui s’imbibe à longueur de semaine… 😁😆😂
Et non toujours aucune logique ni dans le une ni dans le un ! Après la logique chez Rocky, faut le dire vite ! Il descend plus vite des branches de son arbre qu’il ne comprend la sottise de son franglais! Et il voit des “poceronnes ” partout qui s’imbibent à longueur de semaine tellement c’est lui qui est imbibé et à longueur d’année! 😂
Boooonjoouuuur Coconne🎶🎶🎵!!!
Alors? Il est bon? Pas trop la tête dans le cul?
Tu vas aller faire la cuisine à Gaza du coup? Tu vas leur faire des omelettes jambon-fromage? Ils vont adorer ça les mecs de Tsahal…😂🤣
Ou alors tu pourrais faire chauffeuse de salle pour les meetings à Macron… tu aurais du succès…
Je t’imagine bien en train de hurler “Tu fais quoi à Néaoutyne?”… et là une foule immense de 350 zoreils qui répondrait en chœur:
“BOURRE LE!!!”😁😆😂
Retourne à ta niche vieille vérole. Et potasse des réponses plus abouties au lieu de toujours vouloir surenchérir avec tes 3 tirages en stock.
Et toi, retourne dans ta fosse septique et restes- y, et ne cherche pas à répondre tout court ,tes réponses sont totalement crades et stupides. Décérébré du net. Tu es un parasite totalement improductif et comme tes compères tout aussi déjanté. Guignol vulgaire de service sur Calédosphère.
Qu’est ce qu’y à la vérole je t’ai blessée ? D’un seul coup la vérité t’est apparue sur ta condition? T’as réalisé que tu serais jamais Einstein et tu t’énerves? Ben ouais faut t’y faire, tu seras jamais qu’un gros étron tout sec qui attend la moto crotte. Tu es la vulgarite même, tu es une fosse septique grand format, tu es ignare tout en essayant de faire croire que tu as des connaissances en tout mais tu ne fait que déblatérer dans le vide. Capable de nous faire des discours sur l’armée, sur les povres ado du site, gestapiste… Lire la suite »
“…volontairement dénonciatrice et menaçante “? Je n’aurai donc pas de circonstances atténuantes si je suis responsable de ta disparition sur le site ? On ne pourra pas dire que j’ai causé la mort de ton pseudo sans intention de la donner?AHURI !Si moi je ne suis pas Einstein, à côté de toi même le nain Simplet fait figure de génie! Vu ta réponse cette “Vérité” est loin de t’avoir été ” révélée “. Il suffit de lire tes ” exploits épistolaires”, le cruchon vulgaire et stupide qui ne sait s’exprimer qu’avec des mots orduriers et parasite ce site avec ses… Lire la suite »
Bein alors Coconne? C’est la gueule de bois qui te met de mauvaise humeur comme ça?
Dis donc, quand je vois comment tu t’adresses à Oups, j’ai l’impression que tu t’adresses à moi…Lui aussi il est “niais, simplet stupide balourd et vulgaire”? Y’a pas que moi alors?
Et lui aussi tu voudrais qu’il disparaisse?
C’est ton côté “woinrue de la tribu qui astique les roussettes au fusil à plombs”? Tu veux foutre tout le monde dehors, koutchii staki le blog, c’est ça?
Tiens je te mets une chouette petite photo de roussette toute mignonne, pour te calmer un peu.
” Monsieur Roussette, depuis, du 🌰 ,vu ses ” attributs, ” il a fait bien des petits et a “visiblement ” échappé à tes plombs vu que tu ne chasses pas (même que ça fait mal aux dents ces” plombs ” des fois quand il en reste des petits morceaux dans la daube, qui ont échappé à l’œil pourtant exercé de la cuisinière) . Il t’as laissé prendre la photo de son “profil ” sur “Meetic ” un site très fréquenté par les 🐒comme toi? Staki le blog, toujours pas tête de 🎀 à Georges! Peut-être à sa cousine Georgette… Lire la suite »
C’est de l’humour Coconne?
“C’est de l’humour Coconne “?
Non, du🌰, c’est du cochon comme toi !
” C’est de l’humour Coconne?”
Re- réponse :
Tu as avalé ton cousin, le perroquet clandestin? CANNIBALE !
La roussette se cuisine en civet, pas en daube, Coconne…
Et les connards qui astiquent les nids de roussettes*, que ce soit au “fusil à plombs” ou au bibiche, je leur chie dans la bouche, quand on ne respecte pas la nature on ne respecte pas son pays, et on n’est pas digne de respect. Vous n’êtes que du bétail.
*Ce qui est illégal et contraire à l’éthique de la chasse, au fait, connasse.
“Tu es la vulgarite même
Comme ton double le Si Crado, mais en un peu moins ravagé par la haine de tout et de tous et l’amour de toi seul, achète-toi un miroir, oups 2, si t’as pas peur d’avoir une attaque.
“achète-toi un miroir, si t’as pas peur d’avoir une attaque.”… C’est puissant, ça… on sent le mec rompu à l’Art de la rhétorique…
“achète-toi un miroir, virgule, si t’as pas peur d’avoir une attaque”… Cette créativité dans l’invective, cette profonde recherche de la métaphore, quel aboutissement dans l’art subtil de se harpigner! On en reste coi…
C’est au moins du niveau de 5ème Segpa… son passé d’enseignant agrégé en lancer de poids peut-être?
Quand Trump aura eu son prix Nobel de la paix, il faudra songer à proposer la candidature de Monconrétif-le-subtil pour celui de littérature.
Et toi on te proposera pour celui de l’humouriste de 🚾 de l’année au Ig Nobel.
Et comme tu nous fournis en plus gracieusement ta photo, et son ” slogan ” bien trouvé, on n’a plus qu’à l’envoyer a son jury! Tu bats largement Trump au classement, DUKONG!
Quand vas-tu dégager de là, l’internaute perché dont le contenu des propos oscillent entre ceux d’un vieillard – radoteur, grincheux ,vulgaire et obsédé et ceux d’un ado grossier attardé , propos stupides qui ne pénalisent pas que trois intervenants! AHURI du net !
“l’humouriste”??? En fait j’ai tapé dans le mille, non, tu es bien effectivement croisée cochon d’Inde…
Après, de quelle partie du continent indien… (?)… Le français c’est pas ta langue maternelle?
Ou alors boucaque, peut-être?😁😆
Ils ne sont pas élevés, il sont nourris juste à peine et pas correctement, et surtout abreuvés. Pas surveillé du tout, pas cadré, abandonné au système scolaire qui sert de garderie, les parents n’ayant plus eux mêmes de repères valable. A la VDT quand j’y habitais j’ai vu un gosse de pas trois ans ce faire traiter de connard parce qu’il chialait, la mère une povre conne sans cerveau, la famille vivant à 10 dans un 3 pieces dégueulasse, le jardin transformé en abri avec des cabanes. Vous voulez quoi comme reussite scolaire. C’est vrai que le problème est insoluble.… Lire la suite »
Toi, il n’ya plus aucun espoir de rattraper quoique ce soit chez toi. C’est pas possible de débiter autant de clichés et de formules simplistes et réductrices en guise d’analyse et de réflexion sur les problématiques d’une société confrontée à la globalisation et à la mondialisation au XXIeme s et aux bouleversements dans les mœurs , modes de vie et relations à leur environnement que cela entraîne, comme chez nombre de populations du Pacifique . Et bien d’autres populations sur la Terre . Il n’y a qu’une dictature avec camps de travail pour résoudre le PB? Comme celles des petits… Lire la suite »
Rentre ta tête dans ton cul et endors toi. C’est la nuit
“Rentre ta tête dans ton c..l et endors toi. C’est la nuit ” En voilà une pensée profonde , Oupse 2, alias le “Maître des latrines de Calédosphère !” Et oui, après le jour vient la nuit et inversement ! Tu vas finir par battre le” philosophe Karaté Kid.” T’as pris des cours avec M.Kesuke Miyagi ? Qui comme tout le monde le sait sauf toi n’est pas un descendant de Maître Chojun Miyagi, fondateur du karaté”Goju -ryu” ( 1888 – 1953 àNaha ,Okinawa ) Attention, lui il n’aime pas les gros mots … Tiens un petit proverbe de ton… Lire la suite »
Elle déconne ton IA à mettre des mots les uns derrière les autres sans aucun sens. Allez oups à la niche avec une grosse chaîne pour empêcher de mordre tout ce qui passe.
“Elle déconne ton IA à mettre les mots les uns derrière les autres sans aucun sens…” C’est pas plutôt parce que la tienne d’intelligence elle n’est pas ” artificielle ” et pas efficace du tout dans la comprenette de base du langage des humains? Complètement court-circuitée par ton imbécilité rédhibitoire ? Surtout si tu écris, débile: “Allez oups à la niche avec une grosse chaîne …etc. etc. …” Tu te donnes l’ordre à toi -même d’y aller AHURI en t’interpellant par ton propre pseudo et en te disant d’y aller à cette niche! Toi c’est une muselière qu’il faut te… Lire la suite »
Ah, l’humour de Coconne… Coconne qui pour essayer de se rattraper aux branches a fait ses petites recherches sur Wikipédia…
C’est bien Coconne, tu es une bonne Coconne… allez, couché maintenant… 😂🤣🤣
J’ai écrit [“élevés”, pas “éduqués”] parce que dans mon esprit on élève des cochons ou des poules, alors que les enfants on est censés les éduquer…
Et, oui, je confirme, c’est une bombe à retardement, tous ces gosses livrés à eux-mêmes, sans éducation sans avenir, et qui a filé du fric à leurs parents sous forme d’allocations familiales pour qu’ils les fassent? …. Nous…
Et qui dit à leurs parents que l’avortement c’est un crime et la contraception un péché?… Les curés…
Au fait, Wamytan, curé défroqué… JM Tchibaou, curé défroqué…
Bref, on n’est pas sortis de la merde… 😒
“Bref on n’ est pas sortis de la merde “… MOUHAHAHAHAHA ! Tu écris n’importe quoi qui te traverse le “coco sec” ! Surtout avec les grosses imbécilités que vous déversez tous les deux depuis un moment sur le forum ! Et c’est toi le Chapon et son croupion de copain qui parlez d’éduquer ! Toi c’est plutôt HÉ DUKONG !Espérons que la transmission de ton ADN d’usager totalement écervelé et irresponsable du net s’est arrêtée à toi et que tu es le dernier maillon de la chaîne sur Calédosphère. Quand va – t-on enfin vous virer du site, “professionnels… Lire la suite »
Tu l’as dit. Tant que ces bourrins de politiques Canaques continueront a prendre leurs communautées en otage rien ne changera.
Mais c’est leur fond de commerce, sans leur daube faisandee à vendre ils ne sont plus rien donc ils continuent.
Pour ces jeunes aux cerveaux ravagés, sacrifiés au nom de la lutte que faire!
Mais la couillonne va nous donner la solution, une fois qu’elle aura essuyé sa bave degoulinante.
Putains les bombardements reprennent à Gaza.
La courrone de prix Nobel de Trump aura pas tenue longtemps.
Naïf est en pleur
Ce que je lis entre les lignes, c’est ce que je pense depuis quelques temps: nous allons vers la sudafricanisation de la Calédonie.
Nous y sommes depuis un moment avec les squats et la délinquance.