Actualité
Patrice Faure ou la fin des Jean Moulin
Il a servi l’État, mais l’État ne sert plus la République. Ancien haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, Patrice Faure est nommé préfet de police de Paris. Fidèle d’Emmanuel Macron, il incarne une génération de serviteurs loyaux dans un régime qui ne croit plus qu’à sa propre survie. Portrait implacable de la fin des Jean Moulin.
Il a le visage tranquille des serviteurs de l’État. Né à Crest, dans la Drôme, fils de la méritocratie républicaine, passé par la pâtisserie avant l’uniforme, Patrice Faure a gravi un à un les échelons de la République. Militaire, agent du renseignement, préfet, haut-commissaire, directeur de cabinet du président. Une carrière exemplaire, droite, classique.
Mais peut-être, aussi, le symbole d’un basculement : celui d’une France qui a troqué la foi républicaine contre la docilité bureaucratique.
Avec Jean-Jacques Brot, Alain Christnacht et Thierry Lataste, Patrice Faure fait partie de la courte liste de préfets qui connaissent la Nouvelle-Calédonie jusque dans ses silences. C’est sous sa vigilance que le territoire a accompli son devoir démocratique : trois référendums, trois “non” nets, trois consultations incontestables.
Mais c’est sous la présidence de son chef, Emmanuel Macron, que ce résultat a été nié, contourné, vidé de son sens. Comme le référendum européen de 2005, celui de la Calédonie a été rangé dans la catégorie des “votes qu’on ne comprend pas”. Le pouvoir central a choisi de poursuivre le “dialogue”, c’est-à-dire d’ignorer la décision du peuple.
Patrice Faure le sait.
Il sait que cette fuite en avant a enfanté la colère de mai 2024. Parce qu’un État qui prétend aimer la démocratie mais refuse d’en assumer les verdicts prépare toujours l’émeute. Il sait que le dégel du corps électoral, simple conséquence juridique des trois référendums, a été perçu comme un “passage en force” uniquement parce que le chef de l’État n’a jamais eu le courage d’assumer la légitimité qu’il réclamait.
La République s’est affaiblie non par excès d’autorité, mais par lâcheté d’interprétation.
Patrice Faure aura donc servi la continuité d’un régime qui ne croit plus à la République, mais seulement à son maintien. Il a fait ce qu’il devait : protéger, administrer, maintenir l’ordre. Mais au bout du compte, à quoi sert l’ordre s’il ne protège plus la vérité ?
À quoi bon être fidèle à un pouvoir qui n’est plus fidèle à lui-même ?
Les préfets d’autrefois – les Jean Moulin, les Pierre Racine, les Louis Lépine – servaient une idée, pas une carrière. Leur obéissance n’était qu’un moyen de servir la nation, pas un contrat de silence.
Patrice Faure appartient à une génération de grands commis convaincus que “tenir” suffit à “sauver”. Mais tenir un mensonge, c’est déjà l’aggraver. On ne défend pas la République en protégeant ceux qui la dévitalisent ; on la trahit par excès de loyauté.
Un jour, peut-être, Patrice Faure repensera à ces mois passés dans le sillage du pire président de la Vᵉ République – cet enfant d’acteurs persuadé de jouer De Gaulle, et qui n’aura fait que rejouer Louis-Philippe. Il se souviendra d’un pays où les préfets parlaient clair et où les présidents se taisaient. Et il comprendra que la France ne s’effondre pas faute d’ennemis, mais faute de courage.
* *
*
“Vous avez fait perdre du temps à la France”, disait de Gaulle en 1957. C’est tout le drame de Patrice Faure : il aura servi la République avec loyauté, mais dans un temps qui ne savait plus ce qu’il servait.
Et c’est peut-être cela, la fin des Jean Moulin : quand la fidélité devient la forme polie de la lâcheté.



















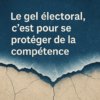
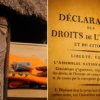























Une histoire qui en dit long…
https://lessor.org/vie-des-personnels/la-justice-suspend-la-mutation-doffice-dun-mecano-des-forces-aeriennes-de-la-gendarmerie-lanceur-dalerte/
Une histoire qui en dit court : qu’est-ce qui était reproché au juste à ce mécano par la hiérarchie militaire ?
En passant:
https://www.opex360.com/2025/11/01/la-gendarmerie-met-en-garde-contre-un-risque-dagitation-en-france-en-cas-dengagement-majeur-a-lest/#:~:text=Cette%20%C2%AB%20agitation%20%C2%BB%20pourrait%20se%20manifester,’Est%20de%20l’Europe.
“La gendarmerie met en garde…” “Plus tôt, la DRSD s’était interrogée sur le rôle de « représentants syndicaux » [sans les désigner] dans des campagnes de déstabilisation de la Base industrielle et technologique de défense [BITD]. Et de prendre l’exemple de la diffusion d’un tract qui dénonçait « l’offensive de l’industrie de l’armement française dans l’unique but de servir le profit, les intérêts capitalistes et les guerres impérialistes ».” Pour certain syndicat, se souvenir du sabotage des grenades destinées à nos combattants contre l’invasion communiste de l’Indochine, grenades fabriquées en France et qui explosaient sans latence dès leur dégoupillage. Pour les marchands de canons… Lire la suite »
C’est sûr, c’est pas des mecs d’extrême drouate qui feraient ça à leurs propres forces militaires, à leur propre pays…
Cela me fait penser aux policiers qui arrêtèrent des résistant sur réquisition de magistrats fidèles à Vichy. Ces mêmes policiers passèrent en jugement à la libération devant les mêmes magistrats qui, bien sûr, avaient retourné leur veste où ils furent sévèrement condamnés. A un inspecteur qui lui faisait remarquer qu’il n’avait fait qu’exécuter ses mandats, un magistrat lui répondit cyniquement : il ne fallait pas les exécuter. Le malheureux et zélé inspecteur qui avait commis le crime d’obéissance fut condamné à mort et exécuté.
A méditer !
Ouh la!! Attention monsieur, vous allez vexer des gens, notamment un certain Coconnet du côté de Rivesaltes, vous savez, là où il y avait un camp…
La situation politique d’aujourd ‘hui en NC est l’héritage de politiques menées en Outremer par les chefs d’Etat précédents ( cf les différents Accords antérieurs dont celui de Nouméa, dont deux se sont particulièrement montrés indignes d’occuper cette fonction et de ne servir qu’une cause : la leur. L’un confia à un certain E. Pisani le sort des habitants de notre île avec le résultat connu et le second pour ne pas avoir à régler des problèmes trop ” fastidieux “et surtout nuisibles à son image , s’est assis sans complexe sur un des principes fondateurs de notre Constitution! Le… Lire la suite »
Allons bon, v’là Mémé Coconne qui nous fait son analyse politique… LeZob, sors de ce corps!😁😆😂
Trop brouillonne, Coconne, on s’endort.
“Trop brouillonne Coconne,on s’endort ” Ben faut pas tenir ton écran à l’envers ni commencer à lire le texte par la fin ! Bon y a pas d’images et c’est vrai que tu n’en es qu’à la phase du décodage ( de la déconnade aussi mais ça c’est génétique ) dans l’apprentissage de la lecture! 🤣Demande à Oupse 2 de t’aider !🤣 AMHA si tu t’ endors c’est le muscadet ! 🤣Tu connais LES “slogans ” . ” Mon Dieu qu’allons- nous devenir ? Pour nous la question reste posée mais pour toi on a la réponse et sans hésitation… Lire la suite »
18H35 c’est l’heure de l’apéro, on sent la Coconne en forme…😁😆😂
C’est du Musso (en vinaigrette)
Pire, Musso c’est de la merde mais au moins on comprend ce qu’il écrit.😁😆😂
Coconne elle part dans tous les sens, elle tourne autour du pot, parle de Mitterrand pendant trente lignes sans jamais le nommer, elle aborde quinze sujets différents sans aller au fond d’aucun… on dirait du (mon con de) LeZob sous kétamine.
Elle en a gros sur la patate, la Mémé Coconne, apparemment, Tonton elle l’aime pas, hein? 😆😂😂
Les ravages de l’alcool, quelle tristesse.😒
“Elle part dans tous les sens” MOUAHAHAHA! T’as vu les chemins ” coutumiers” 💩de ta “réthorique”Rocky .S ? Et ne parlons pas de ton franglais, de ton jargon folklorique, de tes leçons de vocabulaire , de tes connaissances des langues mortes,des textes fondateurs du christianisme, des slogans publicitaires etc etc. Parle de Miterrand …sans jamais le nommer ” Pourquoi, après que j’ai cité son nom deux fois y a besoin de le répéter cinquante ? “Sans aller au fond d’aucun …” MOUHAHAHA T’as vu le fond de ta réflexion ,le Rocky S sur la situation économique de la NC et… Lire la suite »
Le “franglais”, Coconne, c’est quand on mélange de l’anglais au français, ce que je ne fais pas… De temps en temps je sors un peu d’anglais pour me foutre de la gueule de LeZob le wannabe.
Salam aleikoum Coconne… tu savais que “bled” c’est un mot qui fait partie du langage courant, c’est pas du “françarabe”?
“Alcool” non plus d’ailleurs…😆😂
Évite les gratons avec le muscadet à l’apéro Coconne, c’est haram.
” Le franglais Coconne c’est quand on mélange de l”anglais au français ce que je ne fais pas…” Non, en effet , toi tu fais l’inverse!🤣 “Tu savais que bled c’est un mot qui fait partie du langage courant , c’est pas du” françarabe”? Y a pas que moi visiblement !🤣 Et toi, tu savais ,le caïd. que c’était un mot d’argot emprunté par les militaires français à “l’arabe maghrébin dit également arabe occidental”? Et tu savais qu’on en a rien à cirer de ton bled ? 😂 “Evite les gratons avec le muscadet à l’apéro, c’est haram” On dirait… Lire la suite »
Correction : encyclopédie sans v car comme tout le monde le sait et comme d’ailleurs tout le monde se contrefiche, sauf Rocky S. alias le reliseur -correcteur du site, encyclopédie ne prend pas de v en effet mais un c après le y et avant le l…🤣
“Et toi, tu savais que c’était un mot d’argot emprunté par les militaires français à “l’arabe maghrébin”?
Bein oui Coconne, c’est de la culture générale, ça… On n’est pas tous des ignares comme toi, toi tu regardes la télé et tu vas sur Wikipédia, moi je lis des livres, depuis très longtemps. On n’est pas du même monde.😁
“ moi je lis des livres, depuis très longtemps”
Si Crado, l’estampillé NMB (Narcissique Malfaisant des Blogs) vient débloquer sévère à l’instant sous nos zyeux zéberlués : le mec est responsable de la déforestation du Sahara, con tribuant à la production de 99 % de la pâte à pas pied mondiale à lui tout seul.
Eh oui, Coconnet, moi je lisais des livres quand toi tu lançais des poids..
Ce qui m’intrigue c’est pourquoi tu es aussi nul à la pétanque… Sûrement parce que c’est un jeu qui demande de la précision et de la concentration.. ce qu’il est difficile d’avoir quand on est dépendant de l’alcool… 😁😆
Moi j’m’en fous demain je vais voir Patrick Bruel..euuh à l’arène du sud..euuh, na na na nèreeuuuh…🎵🎶🎶🎶🎵🎶
(Quand je pense que l’autre nain de jardin de Monconrétif me traite d’antisémite… un comble…)
Si ça se trouve je vais croiser mon con de LeZob, déguisé en rocker…😆😂😁
R S “Patrick Bruel…”
“Si ça se trouve je vais croiser mon con de LeZob, déguisé en rocker…”
https://www.youtube.com/watch?v=jhorQPIiAEk&list=RDjhorQPIiAEk&start_radio=1 ☝️☝️☝️
C’est quoi le rapport, Concon? Le fait que Gene Simmons est juif?
Donc toi tu te prends pour un rocker, un matador, un guitar hero, un grand écrivain et un homme d’action… bientôt tu vas te prendre pour un agent du Mossad…
Bientôt Pépé Concon-le-grand-informaticien va nous expliquer comment travaille le “Groupe 8200″… 😁😆😂
“bientôt tu vas te prendre pour un agent du Mossad ” Pourquoi “bientôt “et “vas te prendre “?😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Toi,tu serais un “infiltré “recruté par le FSB de Poutine, que ça ne nous étonnerait pas! Vu l’efficacité! Plus NULS qu’eux ces espions du FSB tu meurs ( de mort pas naturelle de préférence et souvent par empoisonnement, la “spécialité culinaire ” du Tsar Vladimir Poutine 1er). Déjà que tu ne te méfies pas du “manager” , alors reconnaître un agent du Mossad sous ses différentes identités ! 🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Et le rapport , “crétin du net” entre l’image que tu postes avec… Lire la suite »
[Rocky Siffredo, en direct live, reporting at the Païta Southern Arena] “Au premier rang j’aperçois une mémé croisée cochon d’Inde avec des lunettes qui trépigne d’excitation en agitant sa petite culote rose en dentelle en hurlant à pleins poumons “Patriiiiiiiiiiick!!” Je m’approche… “Alors, madame, vous faites quoi au manager?” “BOURRE-LE!!!” “La tension est à son comble ici à la Southern arena of Païta, je m’approche d’un vieillard à l’air prétentieux affublé d’un perfecto avec des santiags… “et vous monsieur, fan de Patrick?” -“Non, moi je suis fan de moi-même, je suis guitar hero écrivain, homme d’action et grand journaliste spécialisé… Lire la suite »
???????????????????????????????????????????
Y a quelqu’un qui t’a coupé le micro visiblement Rocky Siffredo ! 🫢
Du coup ton correspondant à Paris il n’a rien pu retransmettre de ta ” prestation ” en direct du concert de Patriiiiick ! Dommage! Ce sera pour le prochain concert ! Il paraît que ce sera Chantal Goya et nul doute qu’étant un de ses plus grands fans tu la rejoindras sur la scène pour des reprises avec de ses standards à la demande des spectateurs!🤣🤣🤣😂
“C‘est aujourd’hui dimaaaancheuuuh”
“Bonjour Mémé Coocoooone”
“Accrochons nous aux braaaancheeuuuhs”
“Et tétons la bonbonne…”
“Repens-toi, Coconne, et confesse tes péchés.” (Lafoyens 18/5)
Tu ferais mieux d’aller à la messe ce matin, toi…
Tu files un mauvais coton, Coconne…
Tu ne vas pas me croire, Coconne, mais “Le lapin a tué un chasseur” c’est moi qui l’ai inspiré à Chantal à l’époque où on couchait ensemble.
“ avec de ses“??? relis-toi, un peu, Coconne… tu es brouillonne, Coconne…
Laquelle d’image, Coconne? parce qu’elles ont toutes les deux un rapport, elles sont toutes les deux pertinentes… c’est juste que toi tu es stupide, et que tu as beaucoup moins d’humour que tu ne le crois.
Le fameux “effet Dunning Kruger”… dont j’attends toujours que tu me prouves que c’est un fake couronné d’un ig-Nobel, Coconne…
Tu te crois drôle, mais tu es juste conne, Coconne….
AMHA Coconne, les espions les plus nuls ce sont ceux qui ont coulé le “Rainbow warrior”…😁😆
En gros mon ” Konkong “tu restes “pertinent “dans ta “Konnerie”? T’as vu où que je” prouvais ” qq ce soit à un ” King des Kongs “? Encore moins à un lauréat du Ig -Nobel du prix du “King des Kongs” , décerné aux “Kongs” qui croient comme lui que les chercheurs qui ont ” “démontré”cet “effet Dunning kruger” ont apporté quelque chose de nouveau sur l’acquisition des connaissances chez l’être humain, de part leur comportement au sein d’un groupe en plus ! De quoi se faire tordre de rire les scientifiques et les vrais chercheurs en neurosciences du… Lire la suite »
En fait j’aime BEAUCOUP Claude Nougaro, Coconne… et “chanteur de variété” ça n’est péjoratif que pour des esprits obtus comme LeZob (qui se prend pour un rocker) et toi…
Cadeau, parce que pour moi aujourd’hui ça va être une belle journée…
Les Ablettes “Tu verras” | Archive INA (youtube.com)
J’aime Beaucoup Claude Nougaro ” Et tu crois aussi à “l’effet Dunning Kruger….” et tu penses que les espions du Rainbow Warrior sont les plus nuls, comme le prouve 🤣ton image des” Pieds Nickelés” et tu as raté ton reportage” en direct “du concert de Patriiiick à Païta comme tu nous l’as appris en image, 🤣avec celle de ton corrrespondant à Paris. 😂 Claude Nougaro se contrefiche , Konkong , de savoir que tu l’aimes BEAUCOUP ou pas! Nous aussi d’ailleurs !Il n’est plus là pour le savoir ni te chanter des reprises de ses standards à ta demande!Et” chanteur… Lire la suite »
Ta gueule Coconne, tu rumines ta rancœur, tu ne fais qu’exprimer ta frustration… Tu es tellement à fleur de peau à force de te faire mettre…. quotidiennement le nez dans ton caca que la moindre de mes assertions tu la reprends, tu la déformes et tu essaies (pitoyablement) de la retourner contre moi, ce qui est à la fois ridicule et puéril, et t’enlève à chaque fois un peu plus de crédibilité… Coconne… Effectivement ça a été un très bon début de journée, Coconne… et maintenant va cuver ton muscadet. PS: C’est bien LeZob et toi, Coconne, qui avez poussé… Lire la suite »
“Faudrait savoir, le champion des ” Konkongs ?” Ben de fait ,visiblement. justement, que ce soit, Nougaro, LedZep,Inforétif, moi,tous les acteurs de la presse spécialisée et même de celle qui ne l’est pas, de la presse people et ceux qui liraient éventuellement Calédosphère,” on” le SAIT : R[ien] À F[outre] de tes élucubrations! Le seul qui est” pitoyable et ridicule et puéril ” c’est le débile du net qui insiste avec ses imbécilités et ses réponses indigentes comme ” ta gue…le … Coconne rumines …rancoeur..le nez dans ton caca… le muscadet …etc” Et le seul qui se met quotidiennement le… Lire la suite »
“Et pousser des” cris d’orfraie” t’as entendu ça où, toi? ”
Ça fait partie du langage courant*, Coconne… enfin je veux dire pour les m’blancs qui sont un peu allés à l’école et qui ont lu quelques livres, au lieu d’aller au Startruck draguer les militaires… Coconne…😆😂
“Protester violemment ou s’opposer avec véhémence”
“L’expression “pousser des cris d’orfraie” signifie protester violemment ou s’opposer avec véhémence. Elle fait référence à des cris stridents, souvent associés à la surprise ou à l’effroi face à une situation désagréable. Historiquement, cette expression pourrait avoir été liée à la “chouette effraie”, dont les hurlements angoissaient nos ancêtres. En somme, elle évoque une réaction intense et émotionnelle face à un événement perturbant. ”
La culture générale
*(Comme “bled”, par exemple. 😁)
Tu disais, au sujet du “nez dans le caca”😁?
” Tu disais au sujet du nez dans le caca”? Moi au sujet “du ” nez dans “le” caca? Rien! 🤣 Mais au sujet de TON nez dans TON💩, j’ai tout dit,du 🌰! 😂Et quand tout a été dit et bien dit,il n’y a plus rien à dire, la preuve !😂 Et de la 💩de il n’y a pas que dans les yeux et les oreilles que tu en as, tête de 🪢🪢! Et maintenant que tu as recopié “une” des définitions d’un “DIKO ” du net de l’expression ” pousser des cris d’orfraie” en français, tu nous la recopieras… Lire la suite »
Ce qui est du “langage courant” pour les uns est ce que d’autres pourraient appeler “langage soutenu”… s’ils n’étaient de fieffés pedzouilles comme toi et LeZob… (Monconrétif est un poil plus évolué, c’est un méchant con, mais il a quand même été éduqué.) “Pousser des cris d’orfraie”, pour moi c’est du langage courant, et pour toi qui es une grosse pedzouille boucaque croisée cochon d’inde c’est du “langage soutenu”… Expression que les pécores dans ton genre n’utilisent pas, ils disent plutôt “parler fin bien, comme un zoreil”. Bref, 19 lignes d’accrobranche avec déferlement d’émojis pour essayer de noyer le poisson,… Lire la suite »
Conclusion bien [re]trouvée et qui te convient à merveille ! Quant à Gainsbarre, il y en a qui écrivrent aussi Guinsbarre voire Guinsbar ou Gainsbar car ce mot est un jeu de mots qui a fait des petits ! Tu l’écris comme tu veux , tête de 🪢!Et la biographie dudit Serge né Lucien G. on s’en fiche qu’on la connaisse ou pas! Tu vas nous fourguer aussi celle de J. Birkin? Et “cri d’orfraie”,toujours pas du “langage courant” ( tous les élèves au bac de français sauf toi le savent, du 🌰) même si pour toi ça l’est, ce… Lire la suite »
Booooooooonjooooouuuuuur Coooooocoooooooonne!!!! 😍🥰
Oui, tu as raison comme d’habitude…
d’ailleurs il y a des gens, pour écrire “Minie” ils écrivent “Coconne”, ou “vieille conne”, ou “vieille conne frustrée”… c’est vrai après tout, ici c’est Kanaky, on fait comme on veut, hein??😁😆😂
Et puis les gens qu’on n’aime pas, ou qui nous déplaisent parce qu’ils on l’AUDACE de nous contredire, on les vire… hein??
STAKI LE BLOG?? KOUTCHII!!!
“ils on”
Non, t’as pas raison, zonzon !
Oh my God!! Il a omis par distraction de de mettre le T de “ils ont”… c’est très grave, et ça veut forcément dire qu’il est analphabète, allons, chions-en une pendule tous ensemble, Concon, Coconne et Conconnet… Wéééé!
Du coup, CRÉÉÉÉTINNNNNN tu vas démissiooooonnnner de ton poste de relecteur- correcteur des fautes d’orthographe des commentaires sur Calédosphère ? C’est très grave? Ben pour toi, on aurait dit” Dukong”, vu que tu y consacres une grande part de tes commentaires! “Chions -nous une pendule tous ensemble.” Non merci,chacun sa💩!C’est pas que tu sois uniquement analphabète, c’est que tu es “très très kong ” car ce que tu viens de répondre,ahuri, à ce sujet, c’est ta spécialité,rendant futile et niais tous les échanges sur les forums!. “Concon, Coconne , Conconnet … Wééée” Youpi,plus il écrit de fois le mot ”… Lire la suite »
Une faute d’inattention, une faute de frappe, c’est véniel… toi tu fais des fautes d’accord, de vrais barbarismes dus uniquement à ton ignorance et à ta cuistrerie.
Conseil: Si tu veux donner de l’effet, ce sont les voyelles qu’il faut multiplier, pas le consonnes, comme dans “Cooooooocooooooonne” par exemple…
Tu comprends?
Ça va être une belle journée. 😆
“De vrais barbarismes”? Barbarismes : mots , expressions ou formes grammaticales qui n’existent pas dans la langue française…etc. ” ( cf Dictionnaire de français Larousse) ? Comme tes :”STAKI” LE BLOG ou “KOUTCHI ” ? Liste non exhaustive… MOUHAHAHAHA! “Toi tu fais des fautes d’accord “? Affirmatif ! 🤢 Comme quand tu utilises le mot “boucaque ” ( nom masculin, également orthographié” Boukak”, et plus, comme d’autres imbécilités lexicales et orthographiques listées dans le “Wiktionnaire” , tel celui à la “Kong” d’un certain R.Siffredo alias “le barjot” ) dans ton “ESSEPRESSION” “boucaque croisée cochon d’Inde ” et que tu écris… Lire la suite »
J’ai écrit “barbarisme” parce que si j’avais écrit “solécisme” tu aurais pété un fusible, Coconne… tu comprends, j’y vais doucement avec toi, qui veut voyager loin ménage sa monture…
Et je persiste, ““boucaque croisée cochon d’Inde”, tu es de sexe femelle jusqu’à preuve du contraire…
“Bukkake”???? 😁😆😂 Mouhahahaha!!!!😁😆😂
À mon avis ça ne t’est pas arrivé depuis trèèèès longtemps, si seulement (ce qui m’étonnerait vraiment beaucoup) ça t’est déjà arrivé… 😁😆😂🤣🤣
Cocoonne, Cocoooonne… Cocooooonne…. 😆😂🤣
“Tu es de sexe femelle jusqu’à preuve du contraire” MOUHAHAHAHA! Cette ” certitude ” quant au sexe d’une souris du clavier, DUKONG DUKONG, ( d’ailleurs, chez les rongeurs de l’espèce des souris y a pas de mâle ? ) c’est une nouvelle règle d’orthographe de ton “Bechrèlle” que tu viens d’éditer? Que tu persistes dans l’erreur aucun doute,car que” CE boucaque “soit une femelle issue du croisement d’une espèce non ifentifiée avec un cochon d’Inde, ça ne change rien, on ne dit pas UNE boucaque,donc,tu dois l’écrire cet accord au masculin!Un point [g] c’est tout! D’ailleurs,R.S alias le “boucaque du… Lire la suite »
Et allez, 35 lignes de plus de “coconneries”…
On zappe, sans intérêt… sauf: 😁😆😂
Coconne…. 😁😆 le “bukkake” non plus tu NE SAIS PAS ce que c’est… 😁😆😂😂🤣🤣
Vidéos porno Bukkake : Visages recouverts de sperme, plaisir extrême | xHamster
Mais qu’est-ce qu’elle est conne, c’est EXTRAORDINAIRE…😂🤣🤣 MOUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!😁😆😂😂🤣🤣
“Sauf que le bu…ke …etc etc.. tu ne sais pas non plus ce que c’est ” MOUHAHAHAHA! Idem : mes références ” policées” à tes ” imbécilités lexicales ” etc etc. Dur la comprenette, le “Moineau! Tu y reviens encore à tes références pornographiques scabreuses d’ado boutonneux republiant ses “blagounettes” crades piochées dans “les” et “ses” bliblothèques du net , du genre “les 100 blagues porno”les plus ” obscènes ” pour faire” rigoler” tous ses copains demeurés du lycée? 🤪🤣 C’est plus que radoter !C’est gagatter !”Fin intéressant” l’analyse de l’actualité politique et culturelle du Siffredo sur le site !🤢… Lire la suite »
C’est toi, Mémé coconne, qui as commencé à parler de “bukkake”…
demande à n’importe quel lycéen s’il sait ce qu’est un bukkake, il va te regarder d’un drôle d’air…😁😆😂
T’as qu’à pas être si conne, et cesser de me tendre des perches… Coooooconne… 😁😆😂
T’as qu’as pas être si conne et cesser de me tendre des perches Cooooonne” MOUHAHAHAHA !🤣🤣😂 “C’est toi qui as commencé à parler …”😂 HAHAHAHA ! 🤣En termes “policés 😇” j’ai “évoqué ” tes termes “non policés” et donc vulgaires que TU UTILISES régulièrement. Si je suis si “conne ” mon “Kong” , comment pourrais-je te tendre des perches involontairement alors que j’anticipe au contraire que tu vas les saisir, prouvant par là que c’est bien toi le “konkong ” et même le” king des kongs” qui ne publie que des vulgarités et des absurdités sur tous les sujets? D’autant… Lire la suite »
Booooonjooouuur Mééééméééé Coocoooonne!!! Ah bon? Alors comme ça tu as fait EXPRÈS de parler d’une spécialité culinaire japonaise pour que moi je te renvoie à une pratique sexuelle dégueulasse???!! Mouarf!!!😁😆😂 Si ÇA ça n’est pas ce que l’on appelle “se raccrocher aux branches”… 😆😂😂 C’est le sang kanak qui coule dans tes veines qui te donne cette propension à ergoter, pinailler, jouer sur les mots, user d’un double langage? Tu sais comme ces gens qui ont signé un document, puis ont dit ne pas l’avoir signé, et ont ensuite produit un autre document pour dire qu’ils retiraient leur signature d’un… Lire la suite »
“Exprès de parler du plat de nouilles japonaises ?” Et comment” Dukonkong” et pas que pour tes déviances en particulier mais ton infinie sottise en général, la preuve, qui revient encore sur ce sujet scabreux, c’est pas toi , tête de 🪢? “Si “Ça”ce n’est pas ce que l’on appelle se raccrocher aux branches ..” Ben si mon konkong, chez toi l’accrobranche c’est de l’atavisme institutionnalisé! C’est comme ton immense imbécilité, c’est ton hérédité! Qui te fait raconter des” fadaises ” comme ton interprétation “du sang qui coulerait dans mes veines ” , parce que j’ai dit” un” ( justement)… Lire la suite »
Mais oui Coconne, c’est ça*… je ne corrige pas la grosse faute, démerde toi à la chercher… mais comme je t’ai déjà expliqué: Quand on veut se la péter à phraser le français, on soigne son orthographe… question de crédibilité.
Sinon, en dessert, un gâteau à la crème, à l’anglaise… cherche “gâteau à la crème” en anglais…
*Toootally full of shit… 😆😂😂🤣
” Question de crédibilité “? La tienne de “crédibilité ” mon pauvre Rocky S., tu la limites toujours aux corrections des ” fotes d’ortograffe” et à des” mais oui Coconne c’est ça “et ça ne va pas chercher bien loin tout ça! Tous les chemins de ta” réflexion” te mènent à ton ” Bechrèlle”! 🤣Tu ne sais de nouveau pas quoi dire à propos de la mise en évidence ” de tes “konneries ” récurrentes alors tu nous ressors ta “correction ” et ton image à la” kong”? ” Comme je te l’ai déja expliqué”?🤯 Tes explications, comme celles du… Lire la suite »
Add:*full et fool c’est du niveau des blagounettes des bibliothèques du net du Rocky S. Et une,” grosse fote de grand – mère anglaise “
Asss’ salaaam aleiiiikoum Coconne!!
Tu sais ce qui est extraordinaire chez toi? C’est qu’à chaque fois que je te mets le nez dans ton caca, mongolienne, tu relèves le museau en braillant “Oué c’est pas mon nez, et c’est pas mon caca d’abord!!”😁😆😂😂🤣 “Et gna gna gna et gna gna gna….”
Et c’est “full ” of shit, you moron.😆
“Tu sais ce qui est extraordinaire chez toi? Mais on le sait tous ” Dukong Dukong” !Ce qui est extraordinaire chez moi c’est que je t’amène toujours à démontrer que tu es extraordinairement ” con”. La preuve! “Full of shit ,you moron” . Ben non mon “concon”, dans la bibliothèque du net des blagounettes les plus bêtes du net c’est devenu” fool !” Tu comprends même plus les blagues nulles de nuls comme toi ? “You moron “? C’est pas plutôt toi le “moron” qui est fin “marron?” Tu trouveras, le crétin de service du net , la signification de… Lire la suite »
Oui Coconne, c’est ça Coconne, tu as raison Coconne… Ça va aller Coconne…
“Full” c’est “full”… et “Fool” c’est “fool”… you dumb cunt…😆😆
À la station service tu demandes “Full up, please”… Pas “Fool up”…😆
The Rolling Stones – Fool to Cry (Official Lyric Video) (youtube.com)
Mais qu’est-ce qu’elle est conne, cette Coconne… c’est extraordinaire…😁😆😂
Laisse tomber “la fumette” ! Tu es “full” et complètement “fool”! On s’ en fiche de tes explications , à la station service on demande rien, on se sert !C’est complètement” kong” tout ça? Absolument ! “Tu as raison Coconne …etc. ” 100% raison en effet ! C’est extraordinaire comme tu t’obstines à paraître extraordinairement” kong ” et à y mettre – presque- de l’imagination! Parce que ta 3ème pensée du jour, c’est du niveau d’un mangeur de plat de nouilles prêtes en 5 minutes en promotion au rayon” cuisines authentiques du monde ” au supermarché de ton bled .… Lire la suite »
Tu sais qu’être têtue comme tu l’es prouve seulement que tu es conne, Coconne…😁😆😂
“Full” c’est “full”… et “Fool” c’est “fool”… you dumb fucking cunt…😆😆
“du niveau d’un mangeur de plat de nouilles ” Ça t’a inspirée le bukkake”, boucaque??😁😆 Tu fantasmes?😆😂
Et il n’y a pas de supermarché dans un bled, par définition, Coconne…😁😆
“Tu sais etc etc. …?”Toujours rien compris à ce jeu de mots de substitution pourtant aussi kong que les tiens ? Et si je te disais que ce que tu viens d’écrire est encore plus kong que ce que tu as écrit précédemment, tu vas te mettre à sangloter de désespoir, pauvre “fool” devant ton plat “full” de nouilles japonaises achetées dans le supermarché de ton bled!Et SI il y en a un dans ton bled, la commune de Nemours ( Intermarché SUPER Nemours 🤣) et même que les agents de sécurité ont repéré ta tête de 🐒chapardeur OQTS de… Lire la suite »
Hors sujet Coconne, aucun rapport, tu te raccroches aux branches, comme d’habitude.
Un bled c’est un petit village… on n’installe pas un SUPERMARCHÉ dans un petit village, Coconne…
Nemours n’est pas un petit village, au fait, Coconne… faut sortir un peu de la trim’bu, woinrue…
Sinon…. ouais… comme d’hab’, ça part dans tous les sens… “nouilles japonaises, malbouffe”… quel rapport avec la choucroute? Le vin blanc… Coconne a tout bu…😁😆
“Un bled c’est un petit village” On n’en a rien “à foutre ” de savoir ce que c’est car de toute façon toi tu ne sais pas où tu habites ! Et on n’installe pas un supermarché dans un petit village ? MOUHAHAHAHA !, Plus “kong ” que toi,on ne trouve pas ! C’est vrai que La Foa est un ” grand village”! C’est pour ça qu’il y a un supermarché! Mais pas que…ni que là- bas. Conseil: tu devrais peut -être laisser tomber ta réfèrence au mot ” bled ” et son sens plus large car c’est visiblement ça… Lire la suite »
“On n’en a rien “à foutre ” de savoir ce que c’est” … c’est bien le problème avec toi, Coconne… c’est que tu n’en n‘as rien à foutre… tout ce qui t’intéresse c’est d’avoir le dernier mot, ce qui te donne l’impression d’avoir raison… sûrement un besoin que tu as de compenser ton enfance de merde lors de laquelle on t’a tout le temps dit de fermer ta gueule… Il y en a plein des comme toi, on les rencontre dans les bistrots en France, qui parlent fort dès qu’ils ont un coup dans le nez… genre Monconrétif, exemple typique.… Lire la suite »
“Une faute d’inattention, une faute de frappe, c’est véniel…”
Une frappe numérique dans ta gueule, ce ne serait pas une faute, mon ami Crado, mais une bénédiction si ça pouvait te faire dégager définitivement de ce blog que tu détruis méthodiquement, pauvre CRETIN.
Ah tiens?! Voilà que Coconnet l’agrégé de lancer de poids parle de violence?!
Il est énervé le zorbak prétentieux qui se prend pour Moitessier quand il est à jeun et Bukowski quand il est bourré?
Et il ne sait pas faire un “É” non plus? 😁
PS: Tu as oublié la géographie… Les habitants de la Mongolie ne s’appellent PAS “les mongoliens”… 😁😆😂
“Ne s’appellent PAS les mongoliens” Ah booooonnnn?🤔 T’as enfin compris le jeu de mots? T’as mis le temps, bravo champion! 🤣 “Staki le blog”? A Georgette,la cousine de Georges, elle vient d’en hériter . Et pour fêter ça elle t’offre un verre, avec rr et au singulier, faut pas abuser, au” Ginzbar à Troyes.” “les gens qui ont l’AUDACE de nous “contredire , on les vire ,hein?” De l’AUDACE anonyme? 🤣 “Con -tredire ” comme à propos de tes recherches sur l’ ADN de ” certains natifs” de notre archipel ? 🤣 Non pas” les “gens, on ne veut virer… Lire la suite »
Add: Et débarrasser avec rr mais avec toi,que ce soit avec 1 r, 2 rr ou 3rrr, le résultat sera le même… dans une démocratie, c’est pas gagné de virer un cacatoès OQTS de Calédosphère, clandestin de Rio.
Tu délires, Coconne, je n’ai jamais discuté ici d’ADN… tu confonds sûrement… le muscadet je suppose… Et inutile de nous la jouer “je disais ça pour rigoler”, ça ne prend pas, tu as poussé des cris d’orfraie quand je t’ai traitée de mongolienne il y a peu, m’accusant de stigmatiser les habitants de la Mongolie… “On ne prête qu’aux riches”, Coconne, et tu nous as habitués à sortir tellement d’énormités, à longueur de semaine que tu ne nous feras pas croire que c’était de l’humour. De toutes façons ton “humour” est particulièrement merdique. Sinon… “gna gna gna”, “gnin gnin gnin”…… Lire la suite »
“Tu délires Coconne , le muscadet…ADN…..cris d’orfraie… mongolienne … habitants de Mongolie…on ne prête qu’aux riches…Coconne… tu ne nous feras pas croire que c’était de l’humour… … ton humour …gna gna gna gnin gnin gnin non…chiasse…vieille conne ,je zappe ” C’est une ” réponse ” ? Encore les mêmes sornettes et absurdités ? Tu te répètes , le pépère. Je “suppose” que tu penses qu’elle est AUDACIEUSE cette ” répartie” ?Et totalement” différente” de ce que tu réponds habituellement ? “Tu ne nous feras pas croire que c’était de l’humour “? Moi,je ne cherche pas à faire croire quoique ce… Lire la suite »
Boooooooonjooouuuur Cooooocooooooonne!!! Tu as encore chargé la mule hier soir? Et ce matin tu as encore la tête dans le cul? Ça porte un non, ça tu sais? Ça s’appelle “être alcoolique“. J’aime bien quand tu essaies de noyer le poisson, tu sais quand tu nous chies 15 lignes de “gna gna gna gna gna” pour ne pas aborder le vrai sujet… comme par exemple “Quoi, mais qui es-tu pour te moquer ainsi des habitants de la Mongolie?!”… parce que je venais de te traiter de mongolienne… Et, comme j’écrivais, qui t’a parlé d’ADN, Coconne? Parce que ça n’est pas… Lire la suite »
Non, en effet on n’est pas tous des ignares comme toi !🤣 C’est d’ailleurs pour ça ,konkong que tu régurgites des informations que tu n’as visiblement pas compris! “C’est de la culture générale …: Comme je te l’ai déja dit, la nouille, chez toi elle n’est ni génerale ni particulière ,elle est tout simplement inexistante! Et ben non,celui qui regarde” très visiblement ” 🤣la tv et nous a parlé de l’Eurovision,mon konkong c’ est toi ! Fin intéressant ! 😴E tcelui qui consulte régulièrement les bibliothèque du net pas forcément toutes très nettes c’est encore toi! Tu lis des livres”… Lire la suite »
“celui qui regarde” très visiblement (??) la tv et nous a parlé de l’Eurovision“… Ça, coconne ça m’étonnerait beaucoup😁, vu que je n’ai pas la télé… et que de toute ma vie je n’ai jamais regardé le concours de l’Eurovision…
Arrête la bonbonne, Coconne…😆😂😁
PS: “des informations que tu n’as visiblement pas comprisES!”, Coconne… toi c’est le Bescherelle que tu n’as pas “compris”… 😁😆😂
PS: Un seul “t” à “pacotille”, Coconne… c’est ton “érudition” qui est de pacotille, Coconne…
Décidemment t’en loupes pas une…😆😂
Tu viens voir Patriiiiiiiiiick avec moi demain?
Un seul t à pacotille ,en effet, mais comme la tienne brille de tous ses feux, au diable l’avarice, je lui mets tt! 😇🤣🤣🤣🤣
Si tu vas voir Patriiiiiiiiiiick apporte – lui des grattons, avec tt, c’est toujours l’orthographe la plus couramment utilisée, tout le monde le sait,sauf toi ! 🤣🤣
Comment que ça se fait que tu as les moyens de te payer une place à ce concert? T’es pas un fonctionnaire nanti pourtant ?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🥰
Shaaaaabat Shalom Coconne!!!
Il paraît que Patriiiiiiiiiick sera ce matin à la fête de la cochonaille à Poya, du coup je vais y aller faire un tour avec ma trottinette.
Tiens, il paraît aussi qu’ils vont faire un biopic de Daniel Guichard, si tu veux on ira le voir ensemble, au festival de courts métrages de Nakutakoin.
Bonne journée Coconne, et surtout: Un seul verre à la fois.😘
Y a des risques que même en trottinette tu n’y arrives pas à te rendre à Nakutakoin! A te lire, tu n’en es plus à qu’un seul verre à la fois ! C’est plus prudent que tu demandes à ta une Nadège de venir te chercher avec sa voiture🚓! Et le rappo[c]t de “ton” texte avec l’image?? Tiré par les poils de la couenne de ton porc ce rappor[c]t! Tu ne comprends même pas la ” subtilité” (si subtile?) de cette illustration que tu plaques sur ton commentaire niveau cour de récré du primaire ! ABRUTI [ IN] FINI de… Lire la suite »
C’est moi qui ai mentionné l’Eurovision une fois, non pas parce que je suis fan, mais parce que c’est de l’euromerde pour un certain public.
MDR… elle débloque complètement la Mémé Coconne, des fils qui se touchent, des circuits qui crament… ça sent le brûlé quand tu ouvres le capot…
L’Eurovision c’est de la chanson de type “variétés”, genre Claude Nougaro, en gros?
Ouais, c’est de la variété, en quelque sorte , de la musimerde commerciale insipide financée par ” l’Europe” avec de l’argent public pour faire un euromachin pour euroteubés. Les fans de vraie bonne musique de vrais bons groupes ne regarderont jamais ça, c’est pour un public de ploucs et de bobos qui le regarderont pour ne pas mourir d’ennui dans leur triste vie. “Nothing Else Matters”, ” Don’t You Cry”, “Highway to Hell”, “I Want It All”, pour ne citer que ceux-là, ça a trente ans et plus, ce n’est pas tombé dans l’oubli, mais la musimerde insipide de l’Eurovision,… Lire la suite »
Des “artistes” qui vivent de subventions, d’argent public, donc… ils ne sont pas des artistes, mais des fonctionnaires…
“Satisfaction” ça a 60 ans, “Born to run” 50… bref… 😉
Tiens, je te poste une photo de ce que Coconne pense être quand elle fait chier les gens sur Calédosphère:
Et ce qu’elle est réellement…. 😁😆😂
“Quand elle fait chier les gens sur Calédosphère “? MOUHAHAHAHA ! Pourquoi, ” papi konkong” il n’ y a que toi qui en aurais le droit ? “LES ” gens ou un certain Rocky le plus petit Kiki de tous les kikis , dont c’était – et c’est toujours l’objectif ” à la demande de ses fans? “🤣On est méchant[S] avec toi? 😪Pleure plus fort, je ne t’entends pas ! ” Une PHOTO “? HAHAHAHA🤣 C’est qui la “nénette “qui a posé pour cette “photo”? Et c’est qui le “photographe?”🤣 “Des artistes qui vivent de subventions publiques?” Car comme ”… Lire la suite »
Oui oui Coconne, c’est ça…
Quand tu auras des choses intéressantes à dire tu n’hésites pas, hein?
Tu viens blatérer ici… 😁😆
“Quand tu auras des choses intéressantes à dire, tu n’hésites pas , hein ?
Et toi, “ectoplasme à roulettes”, consulte ton ” Bechrèlle “pour la con- cordance des temps!
“Tu viens blatérer ici…”?
Arrête de plagier ,vieux chameau !
ABRUTI du net !
” Chanson de type “Variétés” De quel type, celui sans S ? 🤣Mais,c’est qu’il en connaît un rayon ” en gros ” sur le genre musical de l’Eurovision le Rocky .S! Pas que sur le genre musical, il publie aussi des photos de ses “artistes ” préférés en compétition , extraites de son album perso mais où ne figurera jamais Claude Nougaro,et pas seulement parce qu’il est décédé.🤣 Tu sais Rocky t’as le droit d’aimer regarder l’Eurovision … en cachette. Et que tu ne l’aies déjà ou pas -( si ce n’est toi c’est donc ton frère? ) mentionné avant,… Lire la suite »
On se contrefiche de savoir si tu as la TV ou pas chez toi ! Tu squattes le salon de tes voisins pour la regarder avec eux cette émission; de fait, ce sont eux qui ont confié ton secret aux médias de Calédosphère mais de nos jours, tu peux la regarder autrement que sur un écran de TV cette émission..🤓🤣 ” des informations …pas comprisES ” Non sans blague, j’ai encore fait une grosse faute d’accord ? Avec ou sans ES le résultat est le même : dur dur, ta comprenette🤯. “Toi c’est le Bescherelle que tu n’as pas compris”… Lire la suite »
Certes, pourrait dire XYY, mais il aura une bonne retraite…
Et comme apparemment pour certains petits esprits il n’y a que ça qui importe…
On n’a jamais demandé à un nain de jardin d’avoir de la hauteur de vue, n’est-ce pas? 😁
En tout cas il a un bel uniforme… J’entends déjà coconne glousser…😆😂😂
Ben pas besoin tu le fais à ma place! Et on t’entend de loin! De très loin même!🤣😂🤣
“On n’a jamais demandé à un nain de jardin d’avoir de la hauteur de vue n’est-ce pas “?
Ça c’est complétement vrai! Vérifié et confirmé par la présence sur ce site de “Rocky Siffredo, alias Simplet alias le nain de jardin si crado” de service dans son potty sur le site de Calédosphère!
Tu sais quand mêmeque tu es très sot,n’est- ce pas ? 🤣
Le chien qui mord sur tout ce qui bouge est toujours là. On te sent arriver de loin et tu n’es pas difficile à faire démarrer.
” Le chien qui mord sur tout ce qui bouge” Dit très finement l’internaute totalement écervelé qui interpelle un autre internaute avec animosité sans qu’il n’y ait eu un départ de discussion entre eux ! A quel sujet voulais-tu entamer une ” discussion” ,le petit roquet de service de Caléosphère? “On te sent arriver de loin” C’est en effet ce que tu viens de faire, de quelle profondeur abyssale et tous les feux de signalement allumés ! “… tu n’es pas difficile à démarrer ” C’est tout à fait toi pauvre Oupse2, le pire c’est que tu oses l’écrire !… Lire la suite »
“qui interpelle un autre internaute avec animosité sans qu’il n’y ait eu un départ de discussion entre eux” 😆😂😂🤣
C’est ce que tu fais tout le temps, Coconne!!!😆😂😂🤣
“Cest ce que tu fais tout le temps Coconne!”
MOUHHAHAHHA!🤣
Et ce n’est pas ce que tu viens de faire encore à l’instant et justement tout le temps, et de bon matin du fond de ton poulailler Konkong? Et ce pour quoi tu es venu et a décidé de rester un petit moment, as tu dit pour faire ” ch..r ” en particulier” 3 internautes? 🤣
Tu es vraiment très très sot mon pauvre Rocky Siffredo . Un petit dicton pour la route vers le bistrot: “Le vin entre et la raison sort”. 🤣
Et fais-toi raccompagner !🤣
As’ Salaaaaaam Aleiiiiiikoum Mémé Coconne!!!…
Ça va? Pas trop la tête dans le cul? Tu t’en es pris une bonne hier soir, dis? Visiblement*….
Aujourd’hui c’est vendredi, jour saint, Coconne, si tu manges le halouf c’est UNIQUEMENT avec la main droite, OK? La gauche elle est haram…
“MOUHHAHAHHA!”? “MOUHHAHAHHA!”?? Tu blatères bizarrement, chamelle… tu as pris froid? Ou tu as mal à la gorge à force de hurler bêtement sur les gens?
*et aS décidé
“Aujourd’hui c’est vendredi…”?
Et demain c’est samedi , épithète demain il pleut ?🤣
“Tu t’en es pris une bonne hier soir, dis? Visiblement ?”
MOUHAHAHAHA !( et c’est toujours ton cri de ralliement que je plagie, Rocky alias le dromadaire avec 2 r mais pas côte à côte) visiblement toi il n’y a pas qu’hier soir que ” tu t’en es pris une bonne”, on dirait que ça a été toute la nuit, et qu’il n’ y a pas que la nuit qui a été bonne!
Et pas de S à “méchant” quand ” on “écrit “on est méchant”! 🤣
La chienne qui mord sur tout ce qui bouge dit très finement l’internaute couillonne décérebree qui commence toujours ses réponses de la même façon. Elle se plaint d’agressivité non provoqué alors que c’est la championne de la spécialité qui accroche sans arret sans raison. Retour à l’envoyeur?
Autre spécialité toujours retourner les écrits par manque de répartie.
Allez la couillone, bonne branlette
” la chienne qui mord sur tout ce qui bouge ” Elle doit être sacrément hargneuse ta bébête vu que tu nous le répètes ! Elle ne s’appellerait pas Oupse2 ? Et en plus tu nous dis ” qu’elle se plaint d’agressivité non provoquée “? C’est un “Pitbull “? Faut carrément l’euthanasier, c’est interdit par la loi de laisser divaguer des bêtes comme ça! Ou alors faut lui mettre une muselière ! 🤣 Tu es encore plus ɓête qu’une bête Oupse2, mais elle, elle a l’excuse d’en être une, toi l’internaute qui n’écrit que des commentaires stupides involontairement (?) et… Lire la suite »